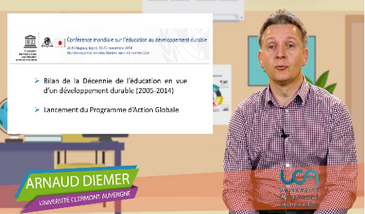En ligne depuis le 28/12/2017
5/5 (1)
Description
Arnaud Diemer, maître de conférences à l'Université Clermont Auvergne, met en évidence dans cette vidéo (9'42) la diversité des représentations en matière d'environnement et de développement durable, ainsi que la diversité des projets d'éducation à l'environnement et au développement durable qui leur sont associés. Il s'appuie pour cela sur une série d'exemples pris à travers le monde.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Mentions Licence
- Sciences sociales
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+3
- Bac+4
Objectifs de Développement Durable
- 4. Education de qualité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
DIEMER Arnaud
UCA - Université Clermont Auvergne
Arnaud Diemer, Maître de conférence, Université Clermont Auvergne
Comprendre les représentations à l'échelle nationale, européenne, voire mondiale, est une nécessité. Mais le plus important, c'est de comprendre l'émergence de ces représentations et surtout, leur histoire, les changements potentiels et puis, surtout, les obstacles. À quel moment les représentations ne sont pas possibles ou envisageables pour certaines populations ? On est revenus sur la question de l'histoire de l'éducation au développement durable et cette histoire, bien sûr, est confortée par l'éducation à l'environnement. Il est très intéressant de comprendre à travers différents cas de figure, différents pays, en quoi l'éducation au développement durable implique des changements.
Dans les études faites pour l'IFADEM, qui concernaient, en fait, la formation des maîtres d'école, on est revenu sur 5 pays d'Afrique : le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Niger et puis la RDC, la République démocratique du Congo. L'idée était de comprendre un petit peu en quoi l'éducation à l'environnement était une forme de représentation, en quoi l'éducation au développement durable provoquait un changement des représentations et en quoi les valeurs pouvaient jouer un rôle important, en quoi également l'environnement pouvait être différent de la vision qu'on pourrait avoir du développement durable et en regardant les représentations à travers des questionnaires, des enquêtes, des interviews, des méthodes telles que les focus groups, on a cherché à comprendre comment, effectivement, les enseignants, les apprenants réagissaient par rapport à ces représentations.
Si on regarde le cas par exemple du Bénin sur la question environnementale ou sur la question du développement durable, on voit bien en quoi les thématiques qui sont importantes dans le pays, la pollution, l'eau, la protection au sens général sont des thématiques très fortes. Et on le retrouve dans pratiquement tous les ministères avec une tentative d'améliorer cette relation à l'environnement. Dès qu'on parle de développement durable, on renvoie, bien sûr, à des questions d'éducation, des questions de santé, voire des questions de pauvreté. On voit là en quoi le développement durable apporte, bien sûr, une richesse, on n'est pas autolimité par la dimension environnementale. Autre élément intéressant dans cette configuration, c'est de comprendre que dans les représentations, le rôle des perceptions joue un rôle très important.
Si on regarde également aujourd'hui comment les pays d'Afrique rentrent dans le développement durable, c'est vrai que l'environnement est la première clé et beaucoup d'initiatives se rapprochent de la question environnementale. Mais l'éducation devient un enjeu. On comprend très vite que, entre la perception et les représentations, les changements de comportement passent par l'éducation et que finalement des débats sur la santé, sur la pollution, sont également des types d'enjeux qu'on retrouve dans le monde éducatif d'aujourd'hui. Alors bien sûr, les valeurs jouent un rôle très important. Dans le cas du Togo ou du Bénin, ces valeurs, bien sûr, vont jouer comme des obstacles, des facilitateurs ou, au contraire, un moyen de mieux percevoir nos représentations. On voit par exemple qu'au Togo, on insiste beaucoup sur l'éducation à la citoyenneté, le citoyen parle de développement durable, mais pas uniquement, et que finalement l'environnement devient une dimension, mais qui vient conforter certaines dimensions. Quand on regarde le Bénin, la morale joue un rôle important, autrement dit, la notion du bien et du mal est fortement introduite, même dans le développement durable, et le civisme, comment, effectivement, introduire des droits civiques dans cette configuration ?
Au final, on s'aperçoit que tous les projets que j'évoque jouent un rôle très important par rapport au développement au sens général. Si on prend le Burkina Faso, ce qui ressort beaucoup de ce projet aujourd'hui, c'est que l'éducation à la santé repose sur une véritable problématique. Un taux de mortalité de 12 % et 30 % de mortalité vient du paludisme. On peut comprendre que l'éducation à la santé et à l'hygiène soit la première cause, mais également la première finalité de l'éducation au développement durable. Et si on regarde l'enjeu de population, 40 % de la population a entre 0 et 14 ans, on comprend que le changement de comportement très tôt est nécessaire. Durant la Décennie UNESCO, la remontée des programmes d'application, de la mise en œuvre du développement durable a joué un rôle très important. Il faut rappeler que l'UNESCO a cherché à mettre en avant les bonnes pratiques. Que devait-on retrouver dans le milieu formel et informel comme bonnes pratiques en termes d'éducation au développement durable ? Et on a vu une profusion de stratégies qui venaient du terrain et qui donnaient, en fait, un retour sur les objectifs, les finalités, les compétences, les valeurs attendues ou émergentes liées à l'éducation au développement durable.
Dans un projet sud-africain qui portait, en fait, sur les problèmes socio-environnementaux, notamment liés à de jeunes enfants, ça peut-être des questions de maltraitance, voire des questions liées, effectivement, à la santé, au VIH, on a cherché, effectivement, à jouer sur une dimension forte, la dimension sociale, comment les acteurs, en tant qu'acteurs, ça peut être des ONG, des associations, des parents, des enseignants, comment mieux prendre en compte, effectivement, cette diversité liée à des questions sanitaires et sociales, et notamment environnementales ? L'enjeu était simple, responsabiliser les gens, donc développer des compétences de responsabilité, les rendre autonomes dans le choix, ça peut être le choix de voir un médecin, mais également le choix de s'éduquer, tout simplement, de changer de comportement, mais également une logique communautaire. Comment la communauté était capable, effectivement, de développer une formule d'apprentissage qui corresponde à tous.
Autre exemple : le projet japonais, lui, qui partait, en fait, d'une problématique très simple. Le taux de natalité au Japon est de plus en plus faible, le pays se pose la question de son vieillissement et donc, l'entrée du développement durable était une réflexion sur la culture, comment la tradition, comment la culture pouvait être, effectivement, un facteur déclenchant dans la démographie, dans la population, et comme on pouvait s'imprégner un petit peu de cette culture pour raviver, en fait, un dynamisme dans la population japonaise. On retrouve encore une fois ces compétences : la mise en responsabilité, la collaboration dans les projets, mais également comment éviter les obstacles ? Très souvent la culture peut être un barrage dans la diffusion des idées. Et comment l'élever en s'imprégnant de cette dimension culturelle, autrement dit, on n'est pas dans la tradition ancestrale, mais on est en quoi cette tradition peut permettre d'avancer et de comprendre les choses. Les valeurs sont très simples, la solidarité joue un rôle très important, mais également l'indépendance, il faut rendre les gens, effectivement, indépendants dans leurs choix.
Troisième projet qui est, lui, plus technique, c'est un projet allemand, Leuchtpol, ce projet fait un lien entre l'économie et l'énergie, autrement dit, on veut faire comprendre aux très jeunes c'est quoi le rapport à l'énergie, vous savez tous que très souvent notre rapport, c'est un bouton qu'on pousse et une ampoule s'allume et comprendre d'où vient l'énergie, comment elle est produite, mais comprendre aussi que tout ce qui nous environne dépend de l'énergie. Une plante, donc forcément, quand on met une semence dans un pot et que des enfants observent comment cette semence devient une plante, ça devient un projet énergétique. Et donc l'énergie n'est plus forcément ce que nous consommons, mais ce que nous voyons en termes d'évolution, nous sommes tous facteurs d'énergie dans tous nos actes de la vie et là, les compétences sont très intéressantes, c'est la coopération, comment on coopère ensemble pour comprendre cette évolution de l'énergie, cette compréhension de l'énergie, également comment la responsabilité entre l'apprenant, un jeune enfant qui va essayer de comprendre d'où vient l'énergie, joue un rôle très important et puis surtout les valeurs qu'on va inculquer parce que l'énergie ce n'est pas uniquement une question technique, c'est aussi une question sociale, savoir que des gens ne peuvent pas payer pour être connectés à l'énergie joue un rôle très important dans le facteur solidaire.
Enfin, quatrième projet, c'est un projet argentin qui pose clairement la question de l'environnement durable, de la ville durable. Très souvent la ville durable est une ville qui pense en termes de flux, en termes de métabolisme. La vision systémique est très forte, on veut savoir ce qui rentre, ce qui sort. Les flux, ça peut être des voitures, des individus, ça peut être des matériaux. L'idée, ici, c'était de comprendre en quoi la pollution a une dimension systémique et à partir de là, de comprendre en quoi cette pollution apparaît pratiquement dans tous les cas de figure. Finalement, on retrouve les mêmes compétences : comment s'engager dans une ville durable ? Sous quelle forme ? Avec qui ? Quel type d'initiative ? Je pense, bien sûr, aux quartiers qui ont aujourd'hui une forte responsabilité par rapport à ça, et puis les valeurs, la démocratie, savoir écouter, savoir s'écouter les uns les autres, pouvoir discuter et argumenter. Au final, on voit que tous ces projets, qui sont en fait les bonnes pratiques en termes d'éducation au développement durable, sont de dimension pluriculturelle, mais en même temps ont un espace pluridimensionnel, l'économique, le social, le culturel sont très dynamisants et que finalement les changements de comportement sont des choses très simples qui partent du terrain et, finalement, l'informel joue un rôle très important aujourd'hui en matière de représentation.