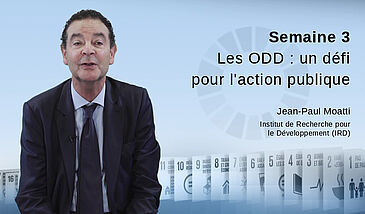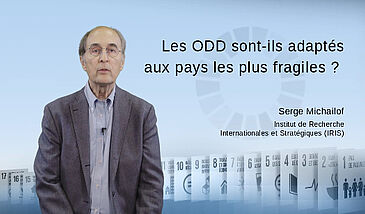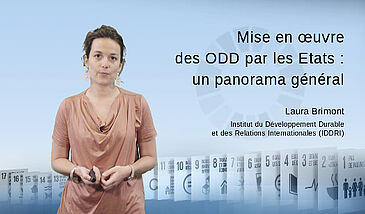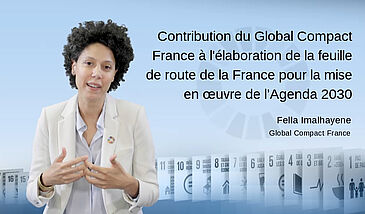En ligne depuis le 11/10/2018
0/5 (0)

Description
Julie Chabaud, responsable de la mission Agenda 21 au sein du département de la Gironde (France), aborde dans cette vidéo (9'29) l'appropriation des Objectifs de Développement Durable par les collectivités territoriales. Elle retrace tout d'abord l'historique de cette question avant de mettre en lumière les éléments qui, aujourd'hui, paraissent essentiels pour que les territoires répondent au mieux aux grands défis contemporains.
Objectifs d’apprentissage :
- Appréhender l'appropriation des ODD par les collectivités territoriales.
- Situer l’Agenda 2030 par rapport à l’Agenda 21 local.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Mentions Licence
- Science politique
Nature pédagogique
- Animation
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
Objectifs de Développement Durable
- 11. Villes et communautés durables
Thèmes
- Écologie & Action politique
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Chabaud Julie
La territorialisation des ODD : vers l'Agenda 2030 local
Julie Chabaud, Responsable de la mission Agenda 21 au sein du département de la Gironde (France)
Comment territorialiser les ODD ou comment faire que les ODD, les Objectifs mondiaux de Développement Durable, aient du sens pour un territoire et pour un projet territorial ? On a, depuis 2015, ces 17 Objectifs de Développement Durable. C'est vrai quand on est sur les territoires, on peut avoir l'impression que c'est perché, que ce sont des choses qui viennent d'en haut et que ça ne nous concerne pas beaucoup.
L'avantage au niveau des territoires, c'est qu'on a une histoire avec ses grands engagements internationaux de développement durable. À Rio, en 1992, c'était la première grande conférence, le sommet de la terre sur la prise de conscience des interdépendances entre les enjeux démographiques, sociaux, environnementaux, climatiques et plein d'autres. Cette prise de conscience, au niveau mondial, a donné lieu à une déclaration : la déclaration de Rio. Dans cette déclaration, c'était de dire "il faut faire quelque chose". Ce "il faut faire quelque chose pour le vingt et unième siècle", ça s'est appelé un Agenda 21. C'est l'agenda 21 mondial. L'Agenda 21 mondial qui, ensuite, s'est décliné dans tous les domaines et dans tous les pays. Ce qui était intéressant dans cette approche de l'Agenda 21 mondial, c'était de dire on prend conscience au niveau international de l'interdépendance des enjeux écologiques, sociaux environnementaux, économiques, etc., mais on sait bien que quand on va vouloir agir dessus au niveau international, on va agir de manière sectorielle. C'est ce qui s'est fait avec le protocole sur le climat et le protocole sur la biodiversité. Finalement, pour réussir à agir dans la complexité, dans ces liens, dans ces connexions, dans ces interdépendances, il n'y a qu'au niveau territorial qu'on peut le faire.
Dans la Déclaration de Rio en 1992 était prévu ce que l'on appelle les Agendas 21 locaux. Si on veut vraiment agir pour le développement durable en prenant en compte tous les liens, c'est au niveau local que ça va se passer. Cette invitation faite aux territoires de se saisir de grands enjeux et de voir comment, lui et tous les acteurs sur son territoire, en fonction de son histoire, en fonction de ses spécificités, peuvent agir, c'est une question que les territoires sont invités à se poser depuis 1992. En France, il a fallu un peu de temps pour que ça monte au cerveau. Ça a vraiment commencé à s'inscrire dans le paysage des collectivités françaises dans les années 2000. À ce moment-là, on a eu un fleurissement de ce qu'on appelait les Agendas 21 locaux. C'est une des démarches les plus abouties pour réussir à mener un projet territorial de développement durable. Le projet territorial de développement va définir où on va. On a les cinq finalités dans le cadre de référence nationale. Et il va définir comment on y va. On a donc une boîte à outils avec des éléments de méthodes qui sont la gouvernance, la participation citoyenne, l'évaluation, etc. On a manipulé ces éléments sur les territoires. Concrètement, le département de la Gironde est engagé dans l'Agenda 21, depuis 2004. Il anime un réseau avec toutes les collectivités en Agenda 21. Il y en a 70 en Gironde. Depuis 13, 14 ans, on apprend ensemble à essayer de faire concrètement du développement durable dans des projets stratégiques, dans des projets territoriaux de développement durable.
Ce qui est intéressant avec ce qui se passe avec les Objectifs de Développement Durable, ces 17 objectifs adoptés en 2015, c'est qu'ils viennent nous rappeler aux urgences. En gros, c'est bien. En 92, on s'était dit "ouh là là, il y a des problèmes, il va falloir agir pour le vingt et unième siècle". Ce que disent aujourd'hui l'ensemble des États, ces 194 pays qui ont signé ces 17 Objectifs mondiaux de Développement Durable et ces 169 cibles à atteindre d'ici 2030, c'est de dire : "il faut se réveiller un peu, si on attend la fin du vingt et unième siècle pour agir, ce sera trop tard". L'agenda ne doit pas être 21, l'agenda doit être 2030. Il doit être 2030 en ayant conscience des urgences, c'est-à-dire en revoyant l'ambition et ce sur quoi les projets territoriaux, les agendas 21 et assimilés avaient pu se perdre en devenant des collections d'actions. On disait : "sur la biodiversité, je fais ça ; sur la solidarité, je fais ça". Finalement, on avait un peu perdu cette logique de comment on agit vraiment à la hauteur des enjeux. L'invitation des ODD et de l'Agenda 2030, c'est de dire vous avez toute cette matière, vous savez maintenant, sur les territoires, travailler sur un projet territorial de développement durable. Maintenant, il faut les faire remonter.
Il faut qu'il y ait des impacts par rapport aux enjeux parce que la situation est grave. Parce que la situation est grave localement, même si des fois, en France, on le ressent moins — parce qu'on vit plutôt bien en France —, mais localement et mondialement. Nicolas Hulot, dans le dernier sommet pour le climat, a dit que "c'est la première fois qu'on est condamné à échouer ensemble ou à réussir ensemble". Il n'y a pas d'option. On parle de la planète. On parle de l'avenir de la planète. Ce sont des incidences qui sont maintenant. On parle des liens entre le climat et la solidarité. On parle de la biodiversité et des migrants. On parle du monde dans lequel on est et dans lequel on vit aujourd'hui. On parle de cette conscience de la complexité. On parle de la conscience des interconnexions et des liens qu'il y a entre les choses. On parle aussi de nos capacités à agir. C'est quelque chose qu'on a appris avec les projets territoriaux de développement durable, c'est que nous sommes en capacité d'agir. Les questions techniques et les questions opérationnelles ne sont pas la question. La question, c'est "est-ce qu'on y va vraiment ?"
Ce sur quoi on travaille quand on est en prise avec les urgences, ce sera sur la question de la transformation. On n'est pas uniquement sur les questions d'amélioration continue. Il ne s'agit pas de faire un peu moins pire ou d'avoir des choses à mettre en vitrine en jouant au loto des ODD. "En ODD 12, je fais telle action". Ce n'est pas la question, c'est comment agir vraiment à la hauteur des enjeux. Ça veut dire que le cadre de référence que l'on avait avec les Agenda 21, le référentiel d'évaluation qu'on avait avec les Agendas 21, il faut le reposer sur la table en disant comment revoir la boussole, au nom de quoi agir, avec ces 17 objectifs, comment revoir les manières d'agir où on a évidemment la participation de tous parce que c'est indispensable, mais en plus de l'amélioration continue, on aura aussi toutes les questions d'innovation et de transformation et ne pas avoir peur d'aller sur des questions de transformation de rupture. Il y a un résumé des ODD qui revient à dire zéro pauvreté, zéro faim, zéro carbone. Faisons des projets territoriaux dont les objectifs sont zéro pauvreté, zéro faim, zéro carbone. Pas un peu moins de pauvres, pas un peu moins de, c'est non ! À un moment donné, c'est comment renverser la table et comment le faire tous ensemble pour agir à la hauteur des enjeux. C'est vraiment l'enjeu.
Les transitions dans lesquelles nous sommes sont inévitables. Ce n'est pas au choix, elles sont inévitables, on est dedans. Par contre, la justice est une option. Quand on est acteur sur les territoires, on va construire des modes de résolution et d'actions qui vont viser cette inclusion et cette justice sociale et écologique pour tous. C'est notre mission. On va aller sur ce qu'on appelle la coresponsabilité. Il n'y a aucun enjeu sur lequel un acteur seul a la main. On va s'interroger tous sur la part que nous avons pour atteindre ces objectifs ; comment, en conscience, faire 100 % de la part que nous avons ; et comment nous aidons tous ceux qui ont une part à faire la leur. C'est comment créer un écosystème de coresponsabilité qui soit réellement à la hauteur des enjeux. C'est mon appel, c'est l'Agenda 2030 local. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus maintenant. On a énormément d'acquis et d'outils pour le faire.