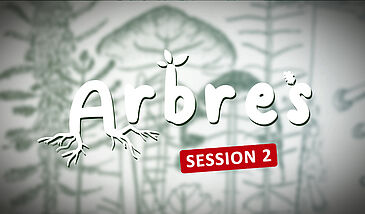En ligne depuis le 15/04/2025
4.5/5 (20)

Description
Ce parcours vous propose de découvrir les arbres, ce qu'ils sont, comment ils vivent, comment ils s'organisent et fonctionnent à différentes échelles d'espaces et de temps, et quels services ils nous rendent.
Objectifs d'apprentissage :
- Décrire les arbres et les identifier
- Expliquer comment les arbres perçoivent et interagissent avec leur environnement
- Nommer les mécanismes permettant aux arbres de s'adapter au changement climatique
- Identifier des pistes pour protéger ou déployer les arbres dans différents milieux (forêts, villes, champs)
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Sciences de la Terre
- Sciences de la vie
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Objectifs de Développement Durable
- 13. Lutte contre le changement climatique
- 15. Vie terrestre
- 3. Bonne santé et bien-être
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Connaître et reconnaître les arbres

L’arbre dans son environnement

L'arbre et les changements globaux

Les arbres : questions irrésolues et place dans l’éthique
Ce document est la transcription révisée, chapitrée et illustrée d’une vidéo du MOOC UVED « Arbres ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
Quels facteurs expliquent les aires de distribution des arbres ?
Géraldine Derroire, CIRAD
Préambule
Si je vous montre ces photos d'arbres et vous demande où elles ont été prises, vous ne saurez peut-être pas me répondre, mais vous pourrez certainement me dire que ces photos ont été prises à des endroits du monde différents. Vous aurez en effet certainement identifié que ces arbres, qui ont des physionomies très différentes, appartiennent à des espèces différentes, et que toutes les espèces d'arbres ne sont pas présentes partout dans le monde. Et vous aurez raison.
Chaque espèce d'arbre a une aire de distribution, aussi appelée aire de répartition, qui lui est propre et qui correspond à la zone géographique dans laquelle les individus de cette espèce peuvent s'établir, croître et se reproduire. Certaines espèces ont de grandes aires de distribution qui peuvent s'étendre sur un continent entier, voire sur plusieurs continents, alors que d'autres espèces ont de petites aires de distribution, une île ou un massif montagneux, par exemple. Mais qu'est-ce qui empêche les différentes espèces d'arbres de coloniser le monde entier et les cantonne à leur aire de distribution ?
Facteurs explicatifs à large échelle
À large échelle, il existe un certain nombre de barrières qui limitent l'étendue de l'aire de distribution des espèces d'arbres. Le premier type de barrières sont des barrières physiques qui forment un obstacle infranchissable et bloquent la dispersion des arbres. Il peut s'agir de chaînes de montagne ou de grandes étendues d'eau, par exemple. Pour cette raison, les îles ont généralement des taux d'endémisme très élevés.
L'endémisme est un concept qui désigne le fait qu'une espèce se rencontre exclusivement dans un lieu donné. Les Araucarias de Nouvelle-Calédonie sont un bel exemple des effets de ces barrières géographiques. Le genre Araucaria s'est diversifié sur cet archipel, qui abrite aujourd'hui 14 des 20 espèces d'Araucarias du monde.
Le deuxième type de barrières à la dispersion des espèces sont les barrières climatiques.
Une espèce d'arbre est limitée par la gamme de variables climatiques dans laquelle l'espèce est capable de survivre et de croître. Par exemple, certaines espèces ne supportent pas le gel et ne peuvent donc pas survivre dans les régions de latitudes élevées. Le régime de perturbations naturelles auquel est soumise une zone géographique peut également déterminer quelles espèces vont être capables d'y survivre et d'y prospérer. Par exemple, le feu est une perturbation naturelle courante dans les formations végétales de savane tropicale. Les espèces qu'on y trouve ont souvent développé des adaptations morphologiques qui leur ont permis de résister à la contrainte du feu. C'est le cas, par exemple, des arbres du Cerrado, une formation végétale de savane à forte biodiversité qu'on retrouve sur une grande partie du Brésil.
Ces barrières ne sont cependant pas immuables. Au contraire, elles peuvent changer dans le temps et ainsi permettre la modification des aires de distribution des espèces.
La tectonique des plaques conduit à la dérive des continents et donc à la modification des barrières géographiques. La distribution actuelle des espèces d'un même genre sur des zones géographiques très éloignées peut refléter la diversification à partir d'un ancêtre commun dont les populations se sont retrouvées isolées par une barrière géographique. Ce phénomène, qu'on appelle la vicariance, explique en partie la distribution large du genre Nothofagus, qui s'étend maintenant de l'Amérique du Sud à l'Australasie et qui existait avant la fragmentation finale du Gondwana.
Le climat a également considérablement changé à l'échelle des temps géologiques et la distribution actuelle des espèces d'arbres peut refléter l'effet des paléoclimats, c'est-à-dire des climats passés. En Europe, lors de la dernière période glaciaire, qui s'est terminée il y a environ 11 000 ans, les arbres ont trouvé refuge au sud de l'Europe. Leur aire de distribution actuelle pourrait donc dépendre de leur capacité à recoloniser le nord de l'Europe quand les températures sont redevenues plus clémentes au début de l'Holocène. Ceci pourrait expliquer le fait qu'on ne trouve pas de hêtres de manière naturelle dans le nord des îles Britanniques, même si le climat leur est favorable.
Facteurs explicatifs à échelle plus locale
Les contraintes climatiques s'exercent également à une échelle spatiale bien plus fine. C'est ce qu'on peut observer, par exemple, sous l'effet de l'altitude, qui est responsable de l'étagement de la végétation jusqu'à une altitude trop froide pour que les arbres se maintiennent. Cette altitude est appelée limite forestière ou limite des arbres, "tree line" en anglais.
Les contraintes liées au sol et à la topographie peuvent également être responsables d'une hétérogénéité de la composition floristique de la végétation à des petites échelles, de l'ordre de la dizaine de mètres. En Amazonie, les bas-fonds sont des zones au sol fertile qui deviennent humides, voire complètement inondées, en saison des pluies. Certaines espèces sont spécialistes de ces bas-fonds et présentent des adaptations à ces conditions, comme les pneumatophores qu'on observe sur ce manil-marécage de Guyane. Les pneumatophores sont des structures qui permettent aux racines de respirer quand les sols sont engorgés.
On parle de niche fondamentale pour caractériser la zone théorique où l'ensemble des conditions environnementales nécessaires à une espèce pour se maintenir sont présentes. On peut concevoir cette zone comme un hypervolume, c'est-à-dire un volume avec un grand nombre de dimensions, chacune de ces dimensions représentant une variable environnementale. On peut schématiser ça en deux dimensions, avec la zone verte sur cette figure qui représente la niche fondamentale de l'espèce considérée.
Mais l'espèce ne se retrouve pas forcément partout au sein de la niche fondamentale et peut parfois se retrouver en dehors de cette niche. On parle alors de niche réalisée, en bleu sur la figure. En effet, les limitations de dispersion peuvent restreindre la niche d'une espèce, mais la dispersion peut également accroître cette niche dans le cas où elle permet à une espèce de se maintenir dans une zone défavorable par un apport constant de graines depuis une zone favorable. Les interactions biotiques influencent aussi la niche des espèces. Par exemple, la présence d'un prédateur, dans le cas des arbres, ça peut être un herbivore ou un prédateur de graines, peut contraindre la distribution d'une espèce. Il en est de même de la compétition entre arbres, pour la lumière, par exemple. À l'inverse, les relations de facilitation permettent à une espèce d'exister en dehors de sa niche fondamentale si une autre espèce modifie les conditions environnementales.
À fine échelle spatiale, la présence et l'abondance d'une espèce peuvent changer dans le temps sous l'effet des modifications de l'environnement biotique et abiotique. C'est ce qui se passe lors de la succession forestière, c'est-à-dire les changements qui interviennent après une perturbation de la forêt. Lors de la succession forestière, les espèces pionnières, qui ont de forts besoins en lumière, colonisent rapidement en profitant de l'apport de lumière engendré par la perturbation. Avec la fermeture du couvert, ces espèces sont peu à peu remplacées par des espèces plus capables de supporter l'ombre.
Facteurs explicatifs : les humains
Pour finir, je voudrais mentionner les effets majeurs de l'humain sur la distribution des espèces. Par ses activités de plus en plus globalisées, l'humain a contribué à la dispersion des espèces d'arbres de manière intentionnelle ou accidentelle, ce qui leur a permis de coloniser des zones qui leur étaient jusqu'alors inaccessibles. Les introductions d'espèces ont modifié certaines communautés d'arbres et les relations biotiques entre les espèces qui composent ces communautés, comme on peut l'observer dans le cadre de l'invasion d'un écosystème par une espèce exotique particulièrement performante. Les changements climatiques d'origine anthropique impactent également de manière majeure les distributions des espèces. Dans ce contexte, la prédiction des aires de répartition futures des espèces grâce à différentes approches de modélisation est un enjeu de recherche particulièrement important. Les futures aires de distribution vont donc dépendre de la capacité des espèces à migrer vers des zones plus favorables et/ou à s'adapter aux conditions changeantes de leur milieu.
Contributeurs
Munzinger Jérôme
chercheur
Boura Anaïs
maître de conférences , Sorbonne Université
Pilate Gilles
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Caraglio Yves
Ingénieur chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Atger Claire
chargée d'études à Pousse Conseil
Barbier Nicolas
chargé de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Trouy Marie-Christine
maître de conférences , Université de Lorraine
Gerber Sophie
chercheuse , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lepaul-Picolet Shaan
Doctorante , Université de Bordeaux
Mariette Stéphanie
chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Derroire Géraldine
chercheuse , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Isnard Sandrine
chargée de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Moulia Bruno
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Martin Francis
directeur de recherche émérite , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Selosse Marc-André
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Frey Pascal
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Blanc Lilian
chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Legay Myriam
directrice du campus AgroParisTech de Nancy
Muller Serge
Cosquer Alix
chercheuse , Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE)
Dumat Camille
professeure , ENSAT - Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
Le Cadre Édith
professeure , Institut agro Rennes Angers
Lenne Catherine
enseignante chercheuse , UCA - Université Clermont Auvergne
Dreyer Erwin
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Maury Stéphane
professeur , Université d'Orléans
Kremer Antoine
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Heuret Patrick
chargé de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Massonnet Catherine
Chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Musch Brigitte
coordinatrice nationale des ressources génétiques forestières à l'ONF
Hallé Francis
Botaniste
Hiernaux Quentin
professeur à l'Université libre de Bruxelles