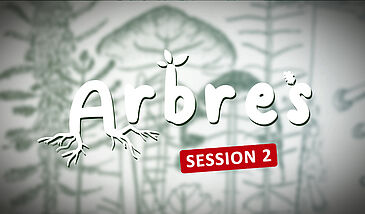En ligne depuis le 15/04/2025
4.5/5 (20)

Description
Ce parcours vous propose de découvrir les arbres, ce qu'ils sont, comment ils vivent, comment ils s'organisent et fonctionnent à différentes échelles d'espaces et de temps, et quels services ils nous rendent.
Objectifs d'apprentissage :
- Décrire les arbres et les identifier
- Expliquer comment les arbres perçoivent et interagissent avec leur environnement
- Nommer les mécanismes permettant aux arbres de s'adapter au changement climatique
- Identifier des pistes pour protéger ou déployer les arbres dans différents milieux (forêts, villes, champs)
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Sciences de la Terre
- Sciences de la vie
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Objectifs de Développement Durable
- 13. Lutte contre le changement climatique
- 15. Vie terrestre
- 3. Bonne santé et bien-être
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Connaître et reconnaître les arbres

L’arbre dans son environnement

L'arbre et les changements globaux

Les arbres : questions irrésolues et place dans l’éthique
Ce document est la transcription révisée, chapitrée et illustrée d’une vidéo du MOOC UVED « Arbres ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
Comment identifier les arbres ?
Anaïs Boura, Sorbonne Université
Je vais vous expliquer comment identifier les arbres, d'abord en vous montrant des caractères observables sur le terrain, mais aussi en vous présentant les outils indispensables à cette démarche.
- Définition d’un arbre
Tout d'abord, il convient de rappeler les critères architecturaux qui permettent de définir un arbre. Un arbre doit mesurer plus de sept mètres de haut. Si cette taille n'est pas atteinte, on parle d'arbuste. Ensuite, il doit avoir un tronc unique composé de bois. Si plusieurs tiges partent de la base de la plante, on parlera d'arbrisseau. Enfin, concernant la posture, un arbre est autoportant. Si ce n'est pas le cas, c'est une liane.
Dans tous les cas, que l'on parle d'arbres, d'arbustes, d'arbrisseaux ou de lianes, ils vont être identifiés de la même manière : en étudiant leur silhouette, leur écorce, la morphologie de leurs feuilles, de leurs fleurs ou de leurs fruits.
2. Les fleurs
En botanique, en général, on utilise les fleurs pour les identifications. Chez les arbres, les fleurs sont souvent discrètes, petites, non colorées et regroupées dans des grappes que l'on nomme des chatons, comme chez le chêne ou le bouleau, par exemple.
Chez d'autres espèces, comme chez les rosacées, la famille du pommier, du poirier ou du merisier, les fleurs peuvent être plus typiques, plus grosses, colorées, parfois avec des parfums.
Dans tous les cas, quand on étudie une fleur, on va noter le nombre de pièces florales, c'est-à-dire le nombre de sépales, le nombre de pétales, le nombre d'étamines et de carpelles. On va aussi s'intéresser à d'éventuelles soudures entre les pièces, ainsi qu'à la symétrie de la fleur.
3. Les fruits
Plus tard, dans la saison de croissance, on va aussi pouvoir avoir accès aux fruits, qui peuvent porter des informations. Les chênes produisent des glands, les érables, des samares, ces fruits ailés dispersés par le vent.
On peut également s'intéresser aux cônes femelles des conifères. Au sein de la famille des cupressacées, la famille des cyprès, les cônes sont par exemple assez petits et globuleux. Chez les pinacées, la famille du pin, ils sont beaucoup plus diversifiés, tant en termes de taille que de morphologie.
Même si ce sont les appareils reproducteurs qui sont traditionnellement utilisés pour l'identification en botanique, ils présentent quelques contraintes. Ils sont souvent situés en hauteur, et donc peu accessibles, et ils ont un caractère très saisonnier. Or, les arbres sont des structures pérennes, et il est donc intéressant de pouvoir les identifier à tout moment de l'année.
4. Les écorces
Pour cela, on peut utiliser les écorces. Certaines espèces vont montrer une écorce qui reste lisse même en vieillissant, comme chez le hêtre ou le charme. Chez le charme, en outre, on va avoir des cannelures le long du tronc, ce qui va lui donner un aspect assez irrégulier.
Chez d'autres espèces qui possèdent une écorce lisse, on peut observer de petites interruptions, que l'on appelle des lenticelles, qui vont présenter des tailles et des formes caractéristiques des espèces, par exemple chez le merisier ou le bouleau.
On va pouvoir aussi s'intéresser à la couleur. Chez de nombreuses espèces, une écorce très crevassée va se développer au cours du temps. C'est ce que l'on appelle l'écorce à rhytidome, et elle aussi présente des motifs typiques. Chez le robinier, les écorces sont profondément crevassées, avec des bandes qui vont s'entrecroiser, tandis que chez d'autres espèces, comme chez le pin, le chêne, le platane ou le marronnier, les écorces sont à écailles caduques ou non.
5. Les rameaux
En hiver, on peut aussi regarder les rameaux pour identifier les arbres. On va, dans ce cas-là, décrire leur aspect, comme par exemple une éventuelle pilosité. On peut aussi s'intéresser aux bourgeons qui sont positionnés sur ces rameaux. Chez le hêtre, les bourgeons sont très grands et fusiformes. On peut également noter la couleur. Chez le frêne, les bourgeons sont noirs. On peut aussi noter le nombre d'écailles, ou la présence, par exemple, d'un pédicelle, comme chez l'aulne.
Quand on observe les rameaux, on peut aussi avoir accès à ce qu'on appelle la phyllotaxie, c'est-à-dire à l'arrangement des feuilles autour de l'axe. Il peut y avoir deux feuilles par nœud, c'est ce qu'on appelle une phyllotaxie opposée. Chez les arbres, les érables vont présenter ce type de phyllotaxie, ainsi que des arbres de la famille des oléacées, par exemple.
Mais chez la plupart des espèces, on observe une seule feuille par nœud. C'est ce qu'on appelle une phyllotaxie alterne spiralée, comme chez le châtaignier.
6. Les feuilles
Le principal organe qu'on va regarder pour identifier les arbres, ce sont les feuilles. La première étape est de regarder si on a affaire à une feuille simple, c'est-à-dire dont le limbe est entier, non découpé, comme chez le hêtre ou le tilleul, ou si, au contraire, la marge est profondément divisée et forme de petites sous-unités, que l'on appelle des folioles, comme chez le sorbier des oiseleurs ou le robinierOn peut également noter la présence de lobes. Les lobes, ce sont des découpes de la marge de la feuille qui mesurent plus d'un quart de la largeur de la feuille. Ces lobes peuvent être rayonnants depuis la base, comme chez le platane ou l'érable, ou alors ils peuvent être situés de part et d'autre d'une nervure centrale, comme chez le chêne ou l'alisier torminal.
Si les découpes de la feuille sont plus petites qu'un quart de la feuille, on va alors parler de dents, et ces dents peuvent être aussi caractérisées. On va noter leur forme, si elles sont pointues ou rondes, si elles sont plus ou moins proches, plus ou moins régulières. Elles peuvent être aussi doubles, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une grande dent avec des petites dents, comme chez le noisetier.
On va aussi pouvoir noter la forme de la feuille, la forme de l'apex, la forme de la base, mais aussi les nervures. On peut travailler sur le nombre de nervures primaires ou les nervures secondaires, en notant leur orientation et la façon dont elles rejoignent la marge de la feuille.
7. Utilité de l’identification
On a vu toute une série de caractères qui permettent d'identifier les arbres, qui sont basés à la fois sur les appareils reproducteurs, comme les fleurs, les fruits ou les cônes femelles, et également d'autres caractères basés sur les appareils végétatifs. Mais au fait, pourquoi identifier les arbres ? L'identification est un processus qui est indispensable, que l'on parle de plantes herbacées ou d'arbres. Ça va permettre d'obtenir un nom, et ce nom, c'est la clé d'accès à une multitude d'informations qui vont permettre d'utiliser correctement les espèces qui peuvent avoir un potentiel médicinal, alimentaire ou économique. Ça va permettre de communiquer précisément sur ces espèces, de les suivre, de les étudier, de les inventorier, voire de les protéger. L'identification peut être plus ou moins précise en fonction du contexte et des besoins spécifiques. Et cette identification va pouvoir se faire de plusieurs façons différentes en fonction de votre identité.
Si vous êtes un botaniste expérimenté, vous allez mener ce qu'on appelle une reconnaissance synthétique, c'est-à-dire qu'elle est basée sur une vision globale du spécimen et que vous n'avez pas nécessairement besoin de décomposer explicitement les caractères. Tandis que si vous êtes un novice en botanique, vous allez passer par une reconnaissance analytique, qui est obligatoire tant que votre niveau d'expertise n'est pas suffisant. Vous allez donc devoir observer des caractères spécifiques et utiliser des clés d'identification.
8. Les clés d’identification
Les clés d'identification sont en général regroupées dans des ouvrages que l'on appelle des flores. Ces clés sont dites dichotomiques et imposent une démarche rigoureuse. Elles décrivent une série de caractères, et on va procéder à une élimination progressive d'options selon un ordre prédéfini par l'auteur. Ces outils traditionnels sont très puissants, mais présentent des limites. Il est par exemple difficile d'exprimer des doutes sur certains caractères. En outre, si d'autres caractères sont manquants, le processus d'identification va pouvoir être interrompu prématurément.
Avec l'essor de l'informatique, des clés numériques ont vu le jour. Elles ont l'avantage d'être multi-accès et permettent de choisir les caractères qu'on veut décrire. On peut donc intégrer des doutes, et également supprimer des caractères qui pourraient être absents. L'expérience d'identification va en plus être enrichie d'infos supplémentaires, de textes explicatifs, de définitions, d'images, de liens.
Depuis quelques années, de nouveaux outils, des outils d'identification automatique, ont vu le jour, par reconnaissance d'images, comme PlantNet ou iNaturalist. Ces outils, accessibles via smartphone, simplifient considérablement le processus d'identification. Il suffit de prendre une photographie avec son smartphone, de la soumettre aux applications, qui vous renvoient vers une ou plusieurs identifications. Bien que très pratiques, ces outils présentent des limites, qui sont basées sur la qualité et la composition des photos. Si vos photos sont floues, prises sous un mauvais angle, avec des spécimens partiels, les identifications qui sont retournées peuvent être fausses. Et si les espèces que vous observez sont rares, endémiques ou mal documentées dans la région où vous les observez, elles ne vont pas être présentes dans les bases et peuvent amener aussi à une identification erronée.
Ces outils ne remplacent donc pas l'expertise humaine pour valider une identification dans des contextes complexes ou scientifiques. Ce sont néanmoins des outils utiles comme appui ou d'initiation.
9. Conclusion
En conclusion, on vient de voir que les outils numériques facilitent aujourd'hui grandement la vie pour identifier les espèces, et particulièrement les arbres, mais l'observation directe et la pratique régulière de l'identification par l'utilisation de clés sont essentielles pour développer votre regard critique, pour affiner votre expertise et pour favoriser une meilleure compréhension de la biodiversité, indispensable à sa protection.
Contributeurs
Munzinger Jérôme
chercheur
Boura Anaïs
maître de conférences , Sorbonne Université
Pilate Gilles
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Caraglio Yves
Ingénieur chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Atger Claire
chargée d'études à Pousse Conseil
Barbier Nicolas
chargé de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Trouy Marie-Christine
maître de conférences , Université de Lorraine
Gerber Sophie
chercheuse , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lepaul-Picolet Shaan
Doctorante , Université de Bordeaux
Mariette Stéphanie
chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Derroire Géraldine
chercheuse , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Isnard Sandrine
chargée de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Moulia Bruno
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Martin Francis
directeur de recherche émérite , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Selosse Marc-André
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Frey Pascal
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Blanc Lilian
chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Legay Myriam
directrice du campus AgroParisTech de Nancy
Muller Serge
Cosquer Alix
chercheuse , Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE)
Dumat Camille
professeure , ENSAT - Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
Le Cadre Édith
professeure , Institut agro Rennes Angers
Lenne Catherine
enseignante chercheuse , UCA - Université Clermont Auvergne
Dreyer Erwin
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Maury Stéphane
professeur , Université d'Orléans
Kremer Antoine
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Heuret Patrick
chargé de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Massonnet Catherine
Chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Musch Brigitte
coordinatrice nationale des ressources génétiques forestières à l'ONF
Hallé Francis
Botaniste
Hiernaux Quentin
professeur à l'Université libre de Bruxelles