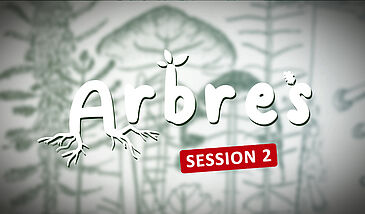En ligne depuis le 15/04/2025
4.5/5 (20)

Description
Ce parcours vous propose de découvrir les arbres, ce qu'ils sont, comment ils vivent, comment ils s'organisent et fonctionnent à différentes échelles d'espaces et de temps, et quels services ils nous rendent.
Objectifs d'apprentissage :
- Décrire les arbres et les identifier
- Expliquer comment les arbres perçoivent et interagissent avec leur environnement
- Nommer les mécanismes permettant aux arbres de s'adapter au changement climatique
- Identifier des pistes pour protéger ou déployer les arbres dans différents milieux (forêts, villes, champs)
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Sciences de la Terre
- Sciences de la vie
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Objectifs de Développement Durable
- 13. Lutte contre le changement climatique
- 15. Vie terrestre
- 3. Bonne santé et bien-être
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Connaître et reconnaître les arbres

L’arbre dans son environnement

L'arbre et les changements globaux

Les arbres : questions irrésolues et place dans l’éthique
La diversité des architectures racinaires des arbres
Claire ATGER, Botaniste et chargée d'études au cabinet Pousse Conseil
1. Diversité des racines
Les racines ne portent ni feuilles, ni bourgeons, ni appareil reproducteur. Pour le reste, il y a toujours des exceptions. Les racines échasses naissent dans l'air et non dans le sol.
Elles renforcent la stabilité de l'arbre et luttent contre le risque de basculement, comme le font les contreforts, qui sont aussi des parties racinaires. Celles des orchidées épiphytes font la photosynthèse. Heureusement pour cette plante, d'ailleurs, dont les feuilles brillent par leur absence ou presque. D’autres racines vont chercher l'oxygène hors du sol, car si les racines ne peuvent pas respirer, comme dans certains de nos sols urbains, particulièrement compactés par les engins ou le piétinement, alors les racines meurent, et l'arbre avec.
2. Fonctions des racines
Les racines des arbres savent faire beaucoup de choses, mais il faut les laisser faire, laisser à la végétation, selon ses compétences, le choix du site à coloniser. On connaît le nom des racines d'ancrage, des racines de nutrition, mais on réduit bien souvent le reste du système racinaire à de la conduction de sève, à du stockage de réserves. C'est exact, mais ce n'est pas tout. Il faut savoir inverser les paradigmes. Les racines sont de formidables bâtisseurs. Elles participent à la fabrication du sol, et les arbres sont capables de s'installer dans des zones quasiment dépourvues de substrat : presque directement sur la roche mère ou sur des sites que l'on imagine mal voués à être investis par des arbres.
Bien des régions côtières sont stabilisées grâce aux capacités des racines des arbres à fabriquer et à fixer le sol. Les arbres hémiépiphytes préfèrent, comme l'orchidée, s'installer sur un autre arbre sans le parasiter. Ils le prennent juste pour un support. Puis le système racinaire gagne le sol, et ce sont leurs racines qui traversent le milieu aérien jusqu'au sol, et non leurs tiges, qui partent du sol pour s'élever vers la canopée. Les Coussapoa produisent des drageons sur ce système racinaire et colonisent ainsi le sous-bois dans un sens inverse de celui auquel on s'attend. Les figuiers étrangleurs soudent leurs racines aériennes et deviennent ainsi autoportants, sur un système racinaire qui a fonction de tronc.
Les racines sont donc les éléments majeurs de la fabrication, de la conquête et de la structuration des milieux. Et ne pas croire que nos arbres tempérés en sont incapables. L'environnement est plus contraignant, l'opportunité plus rare et l'expression plus discrète : ce micocoulier, né il y a des années dans un melia aujourd'hui disparu, nous dévoile un tronc, faut-il l'appeler ainsi, entièrement d'origine racinaire.
3. Influence des racines dans le sol
On parle beaucoup d'association entre arbres, par soudure racinaire, de partage de réseaux de filaments de champignons, d'échange de substances, d'informations ou d'alertes. Le système racinaire largue sur l'ensemble du territoire qu'il colonise de la matière vivante et de la matière morte. Il y prélève, transforme, relargue des produits. L'arbre laisse ainsi, dans le sol, sa signature, que l'on nomme l'effet rhizosphère. La vie du sol et sa chimie sont très fortement influencées par la biomasse racinaire des arbres et de tous les micro-organismes qui lui sont associés. Le sol est vivant, c'est une véritable société, faite d'influence, de partage, de conflit entre tous les acteurs vivants autour des racines des arbres. Alors, jusqu'où l'arbre exerce cette influence ? À vrai dire, à très grande distance : parfois 90 mètres de rayon, pour le ficus étrangleur, 60 mètres de profondeur. Et les racines de profondeur peuvent jouer le rôle d'ascenseur, remontant l'eau et certains éléments minéraux rares, plus aisément capturables en profondeur, pour les redistribuer en surface. Il y a donc beaucoup à apprendre des aptitudes d'absorption et de conduction des racines de profondeur.
4. Le développement racinaire
Les apex jouent un rôle majeur dans ces processus, mais sont aussi le siège de la croissance et de l'élaboration d'un système d'axes qui les déplace et les multiplie sans cesse. Un système racinaire est très hiérarchisé. Les ressources et les capacités de croissance y sont distribuées avec parcimonie à différentes catégories morpho-fonctionnelles de racines. Un nombre restreint de racines sont pérennes, volumineuses, et forment l'infrastructure, la charpente du système, qui se déploie dans toutes les directions du sol. Dans la majorité des cas, le pivot fixe très tôt la plantule, puis explore le sol verticalement et élabore parallèlement l'ensemble du système racinaire. Les racines charpentières qui en dérivent travaillent plutôt à l'horizontale, dans les horizons de surface meubles, vivants et riches. Cette charpente, dans son ensemble, développe un grand nombre de racines caduques, dont la croissance en longueur, en épaisseur, et la durée de vie sont limitées, mais qui sont sans cesse renouvelées par la charpente en cours d'extension. Ces racines caduques colonisent le sol et élaborent un très grand nombre de racines d'exploitation hautement spécialisées dans la production du système absorbant.
Le système racinaire installe, très progressivement, étape par étape, cet ensemble dans un ordre qui lui permet d'assurer, pas à pas, des besoins physiologiques croissants de la plante entière. La plantule se fixe d'abord au sol et produit d'emblée le système absorbant. Chez l'individu un petit peu plus âgé apparaîtront les racines d'exploitation, qui, par leur seule présence, multiplieront le nombre des chevelus. Par la suite, les racines de colonisation permettront, de même, d'augmenter le nombre des racines d'exploitation, et donc des chevelus. Finalement, le jeune arbre installera en dernier un petit nombre de racines charpentières pérennes, donc coûteuses en métabolites, mais qui se déploieront dans des zones déjà investies avec succès par les différentes catégories précédentes.
5. Où se déploient les racines ?
Le plan de développement racinaire de l'arbre est donc très précis, mais il est décliné dans l'espace de manière extrêmement opportuniste, selon les ressources du milieu. Si une partie du système racinaire rencontre une zone de sol défavorable à sa croissance, alors il peut y avoir compensation, c'est-à-dire stimulation de la croissance dans une autre fraction du système, bénéficiant d'un environnement plus favorable. Et il ne faut pas perdre de vue que nous ne parlons que d'une partie de la plante : cette croissance est fortement dépendante, bien sûr, d'échanges à la fois de ressources et de régulateurs de croissance, avec la partie aérienne de l'arbre, qui subit, de son côté, ses propres contraintes. C'est pourquoi la distribution et l'extension des racines dans le sol ne sont pas prévisibles, d’où la difficulté de les évaluer sans observation directe. Il faut retenir, en tout cas, que l'extension est souvent largement supérieure à la projection de la couronne au sol ou la hauteur de l'arbre lui-même, mais pas homogène dans toutes les directions de l'espace, qu'elle est extrêmement dépendante de l'espèce, du stade de développement du sujet, et des qualités et des hétérogénéités du substrat, donc non prédictible a priori. Et c'est un problème, car nous manquons d'outils performants pour détecter la présence des racines dans le sol et suivre ainsi le développement de la plante entière in vivo. Mais fabriquer un bon sol peut être un moyen de guider les racines dans les directions qu'on souhaite les voir prendre, surtout en milieu urb
Contributeurs
Munzinger Jérôme
chercheur
Boura Anaïs
maître de conférences , Sorbonne Université
Pilate Gilles
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Caraglio Yves
Ingénieur chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Atger Claire
chargée d'études à Pousse Conseil
Barbier Nicolas
chargé de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Trouy Marie-Christine
maître de conférences , Université de Lorraine
Gerber Sophie
chercheuse , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lepaul-Picolet Shaan
Doctorante , Université de Bordeaux
Mariette Stéphanie
chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Derroire Géraldine
chercheuse , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Isnard Sandrine
chargée de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Moulia Bruno
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Martin Francis
directeur de recherche émérite , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Selosse Marc-André
professeur , MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
Frey Pascal
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Blanc Lilian
chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Legay Myriam
directrice du campus AgroParisTech de Nancy
Muller Serge
Cosquer Alix
chercheuse , Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE)
Dumat Camille
professeure , ENSAT - Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
Le Cadre Édith
professeure , Institut agro Rennes Angers
Lenne Catherine
enseignante chercheuse , UCA - Université Clermont Auvergne
Dreyer Erwin
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Maury Stéphane
professeur , Université d'Orléans
Kremer Antoine
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Heuret Patrick
chargé de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Massonnet Catherine
Chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Musch Brigitte
coordinatrice nationale des ressources génétiques forestières à l'ONF
Hallé Francis
Botaniste
Hiernaux Quentin
professeur à l'Université libre de Bruxelles