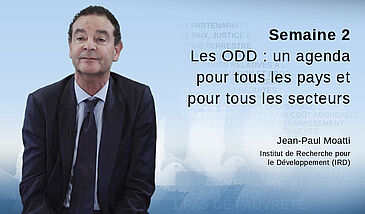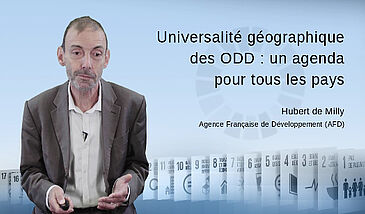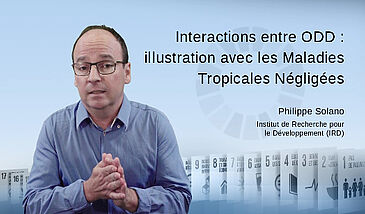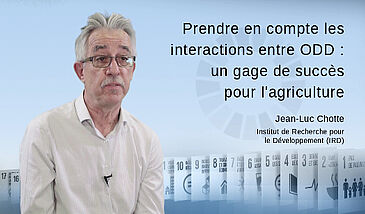En ligne depuis le 09/10/2018
0/5 (0)

Description
Anne-Sophie Stevance, chargée de mission scientifique au Conseil international pour la science (ISC), montre dans cette vidéo (9'32) la cohérence des ODD les uns avec les autres. Elle décrit pour cela les différents niveaux d'influence qui peuvent être observés puis discute de l'implication de ces travaux sur les questions de priorités d'action et d'appropriation des ODD.
Objectifs d’apprentissage :
- Comprendre la cohérence des ODD les uns avec les autres.
- Découvrir une grille d’analyse des différents types d’interactions qui peuvent exister entre ODD.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Animation
- Cours
Niveau
- Bac
- Bac+1
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
- Bac+5
Objectifs de Développement Durable
- Les 17 ODD
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Stevance Anne-Sophie
Dans un monde complexe, des interactions, des synergies, des antagonismes
Anne-Sophie Stevance, Chargée de mission scientifique à l’ICSU
Les Objectifs de Développement Durable permettent-ils de concilier développement économique, bien-être social et protection de l'environnement ? C'est la question qui occupe politiques et scientifiques depuis des décennies. L'adoption des Objectifs de Développement Durable en 2015 met en convergence un certain nombre de défis contemporains comme le développement urbain et industriel, le renforcement des inégalités, le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. C’est finalement une invitation à redéfinir le cadre même du développement. Et c'est cette imbrication des défis qui appelle à une prise de conscience à toutes les échelles de l'individu à la communauté internationale, une meilleure intégration de la connaissance et une plus grande cohérence dans les politiques publiques et privées. Dans cette vidéo, il est donc question de la dynamique interne aux ODD et des interdépendances entre des objectifs.
La question de l'intégration des trois dimensions du développement durable n'est pas nouvelle, mais son importance s'accroît. Le graphique illustre ce que beaucoup appellent la grande accélération, c'est-à-dire, en rouge, une intensification du développement socio-économique à partir de 1950, avec une accélération notamment de l'augmentation de lapopulation mondiale, de la consommation d’engrais, d'énergie, le développement des infrastructures. Et, à droite, on a des tendances similaires au niveau de la consommation des ressources naturelles et des processus biophysiques, avec l'accroissement de la conversion des terres, la consommation des ressources halieutiques ou encore les émissions de méthane et de dioxyde de carbone, avec ce même effet d'accélération et de décrochage à partir de 1950. L'impact des activités humaines sur l'environnement prend une dimension planétaire et ces interactions croissantes entre hommes et environnement qui nous invitent à reposer la question de la mise en équilibre des trois dimensions du développement durable.
Beaucoup d'analyses ont nourri les ODD, qui ont toutes pour point commun d'orienter le développement économique vers la promotion du bien-être social, sans compromettre MOOC UVED ODD – DANS UN MONDE COMPLEXE, DES INTERACTIONS, DES SYNERGIES, DES ANTAGONISMES3 l'intégrité de la biosphère et des processus naturels qui constituent le fondement de la vie et la base du développement humain. Aujourd'hui,le cas des ODD ressemble à ça, c'est-à-dire 17 objectifs, 169 cibles, 230 indicateurs de suivi, et c’est un cadre de compromis qui résulte de plusieurs années de négociations au niveau international. L'agenda 2030 reconnaît explicitement l'intégration des dimensions du développement durable dans la définition d'un certain nombre d'objectifs et de cibles. Il est souvent présenté comme indivisible. La notion d'indivisibilité et d'universalité laisse penser que le monde des ODD est un monde fait de synergies et stratégies gagnant-gagnant. Or, ça ne va pas de soi.
- Les ODD forment-ils un tout cohérent ?
- Comment les gouvernements et les acteurs abordent-ils leur mise en œuvre ?
- Comment éviter l'écueil des objectifs du millénaire pour lesquels beaucoup des progrès — par exemple, sur la réduction de l'extrême pauvreté — sont allés de pair avec une utilisation croissante des énergies fossiles ?
- Enfin, comment orchestrer la multitude d'acteurs nécessaires à la mise en œuvre des ODD ?
Pour aborder ces questions, il s'agit de connecter les ODD entre eux, de mettre chaque ODD en perspective par rapport aux autres et de s'intéresser aux interfaces. Le Conseil international pour la science et le Stockholm Environment Institute ont développé un système pour définir le niveau d'influence d'une politique sur l'autre, d’un objectif sur l'autre. Il comporte sept niveaux qui décrivent de façon empirique le niveau d'influence d'un objectif sur l'autre, et quelque part, il s'agit d'aller au-delà d'une simple description des interactions entre ODD, entre positives, négatives, voire les deux.
Côté synergie, le premier niveau est celui pour lequel la poursuite d'un objectif crée des conditions favorables à la réalisation d'un autre objectif. Par exemple, l'électrification des campagnes permet la poursuite de l'objectif de l'éducation pour tous en permettant l'étude le soir. Il s’agit des faits indirects. Le deuxième niveau, c'est l'effet de renforcement. La réalisation d'un objectif A contribue à réaliser un objectif B. Il s'agit d'une contribution directe et nécessaire. Par exemple, le développement des énergies non carbonées permet de réduire la pollution de l'air et contribuer directement à la santé des populations. Enfin, le niveau d'interdépendance le plus élevé consiste à ce qu'un objectif ne puisse être atteint sans la réalisation d'un autre. Par exemple, promouvoir l'égalité des sexes dans la participation à la vie publique va de pair avec l'éradication de toutes les formes de discrimination envers les femmes.
De la même manière, la réalisation de deux objectifs peut créer des tensions, voire des effets contradictoires. La poursuite d'un objectif peut par exemple poser des limites ou des conditions à la réalisation d'un autre. Par exemple, les mesures de protection des ressources naturelles posent des contraintes vis-à-vis des ressources économiques à des activités économiques qui sont immédiatement liées à l'exploitation de ces ressources, par exemple, les quotas de pêche. Deux objectifs peuvent entrer en conflit. Par exemple, l'accès à une alimentation suffisante et de qualité peut contrecarrer l'objectif de limitation des prélèvements en eau et le recours aux intrants chimiques. Et dernier niveau, le progrès vers un objectif peut rendre impossible l'atteinte d'un autre objectif. Par exemple, le développement de l'infrastructure peut annuler les efforts de conservation des écosystèmes dans des zones concernées.
L'application de ce cadre d'analyse à l'ensemble des cibles et des objectifs permet de faire ressortir les objectifs qui ont le plus d'influence. Et c’est ces points nodaux dans le réseau multiple des relations entre ODD qui servent de point d'ancrage pour la définition d'objectifs nationaux sectoriels, la priorisation d'actions et de moyens. Mais ce système de pointage ne suffit pas en soi, le cadre proposé permet de faire un premier diagnostic, de mettre à jour des synergies potentielles ou d'anticiper des conflits. Mais la nature d'une relation entre deux objectifs n'est pas absolue.
- Elle va dépendre du contexte géographique, du contexte socioculturel, des moyens, voire des technologies, par exemple, qui seront mis en œuvre, ou des systèmes de gouvernance qui peuvent, par exemple, engendrer des inégalités ou la marginalisation de certains groupes.
- Les effets peuvent par ailleurs être différés dans le temps. Tous les ODD n'opèrent pas sur une même temporalité. Certains vont avoir un effet immédiat, d'autres interviennent sur le temps long, par exemple, les infrastructures de transport qui ont une inertie et qui vont structurer durablement les usages ou les villes, par exemple.
- Enfin, certains effets ne sont pas linéaires et ne deviennent perceptibles que dans le temps, avec par exemple les effets rebonds.
Finalement, déconstruire les ODD, oui, mais pourquoi ? Tout d'abord, il y a un enjeu de prise de conscience et de pédagogie. Toutes les relations entre ODD ne sont pas bien connues, par exemple l'accès à l'eau et l'assainissement sur la santé. D'autres sont moins connues, comme l'impact de la transition énergétique ou l'avènement de nouvelles technologies sur l'emploi ou, par ailleurs, la biodiversité, l’impact de la biodiversité, des écosystèmes sur la cohésion sociale. Et pour que ces relations soient prises en compte dans les décisions, il faut les rendre explicites pour que la définition de priorité ne soit pas synonyme d'écueil ou de recul. Deuxièmement, il y a un enjeu d'appropriation par tous les ODD. Il s'agit de dépasser les approches purement sectorielles pour que l'agenda 2030 devienne une feuille de route commune. Ainsi, la politique de santé n'est pas seulement l'affaire du ministère de la santé, mais aussi de l'éducation, de l'aménagement, de l'environnement. Et c'est l'identification de ces co-bénéfices et ces tensions qui permet de cibler les partenariats à mettre en œuvre, d'identifier les gagnants et les perdants. Et c’est quelque part ce processus d'échange et de délibération entre experts et non-experts sur les cibles pertinentes, sur les relations entre objectifs et entre politiques qui vont créer cette vision commune et une vision commune des leviers d'action. Enfin, il y a un enjeu de cohérence et d'ambition. Notre première analyse a montré qu'il y a beaucoup de synergies potentielles entre les ODD. Il s'agit donc de cartographier les trajectoires impossibles et de revoir l'ambition et le champ des politiques existantes. Pour aller plus loin, le rapport est disponible sur le site du Conseil international pour la science.