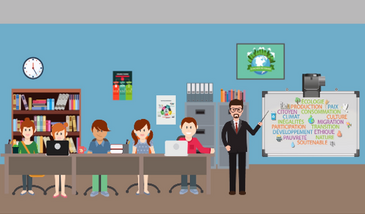En ligne depuis le 28/12/2017
4.1/5 (8)

Description
Ce MOOC 2E2D est complémentaire au MOOC « Environnement et développement durable » produit et coordonné par UVED en 2015. Ce premier MOOC portait sur les connaissances de base, les fondamentaux du domaine et était à destination particulièrement des étudiants pour favoriser le continuum bac-3/bac+3.
Le deuxième MOOC qu’UVED propose porte quant à lui sur les compétences. Il est prioritairement à destination des enseignants du primaire au supérieur et se veut plus opérationnel. La dernière semaine du MOOC « Environnement et développement durable » introduisant ces questions, ce MOOC 2E2D assure donc une forme de continuité permettant aux enseignants d’éduquer à l’E2D et d’intégrer le développement durable dans leur projet d’école.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Mentions Licence
- Sciences de l'éducation
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+1
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
- Bac+5
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Remise en contexte historique de l'éducation au DD (5…

Les fondements didactiques de l'éducation au DD (5 vidéos)

Les outils didactiques de l'éducation au DD (11 vidéos)

Les représentations en vue d'une EEDD (5 vidéos)

Les démarches pédagogiques en EEDD (17 vidéos)
Les finalités d'une éducation au développement durable
Francine Pellaud, Professeur à HEP Fribourg (Suisse)
En 150 ans, l'être humain a provoqué, par ses activités et l'augmentation de sa démographie, des bouleversements tellement importants au niveau des équilibres naturels de notre planète, que des penseurs tels que le prix Nobel de chimie Paul Crutzen en 1995 déjà n'hésitaient pas à définir le XXème siècle comme le début de l'anthropocène, mettant ainsi les effets des activités de l'homme sur la nature au même niveau que ceux des temps géologiques. Parallèlement, Ken Robinson, dans son plaidoyer en faveur de la créativité, nous rappelle que les enfants qui sont aujourd'hui à l'école seront encore en activité professionnelle en 2065. Là, au milieu, il y a nous, enseignants, formateurs, professeurs, formateurs de formateurs. Quel est notre rôle face à l'explosion des connaissances scientifiques et techniques et de tous ces changements ultrarapides qu'elles engendrent ?
En visant une action responsable, nourrie par la compréhension de la complexité, la clarification des besoins et des valeurs, et le développement d'une créativité dévolue à une pensée prospective, l'éducation en vue d'un développement durable nous offre des pistes de réflexion pour penser ce nouveau rôle. Loin d'une nouvelle discipline de plus, l'éducation en vue d'un développement durable peut, au contraire, apporter des clés pour permettre l'acquisition de compétences fondamentales, tout en faisant appel aux connaissances disciplinaires que l'on peut retrouver dans les programmes. Elle peut donc contribuer à donner un contexte, et donc du sens, au savoir abordé, et ainsi alléger le travail des enseignants. Mais pour cela, il est nécessaire de comprendre ce que propose, philosophiquement et concrètement, cette éducation.
Tout d'abord, éduquer en vue de développement durable ou au développement durable, pour le développement durable, ou encore à l'environnement et au développement durable, suivant les terminologies adoptées par les différents protagonistes qui se penchent sur ce sujet, n'est pas à confondre avec l'enseignement de ce concept. La composante éducative y est essentielle. D'une part, parce qu'elle nous éloigne du quoi enseigner en termes de connaissances, question qui ne peut avoir de réponse définitive tant les champs thématiques liés à ce concept sont vastes. Ensuite, parce qu'elle nous rappelle que l'éducation s'éloigne de l'instruction et ne peut être simplement inculquée ou transmise. Elle doit être vécue à travers des valeurs discutées et clarifiées, afin de devenir le moteur d'une action responsable.
Ces premières réflexions nous ont poussés à définir l'éducation en vue d'un développement durable comme une manière d'insuffler, et j'insiste sur ce terme, insuffler un changement d'état d'esprit qui doit nous permettre de voir plus loin, d'anticiper sur l'avenir, et finalement d'agir en conséquence. Car, comme nous le rappelle une citation attribuée à Einstein, on ne peut pas régler le problème avec l'état d'esprit qui l'a créé. Comme le relève parfaitement l'architecte et caricaturiste Ironimus, dans ses dessins humoristiques, nos habitudes, notre culture, nos paradigmes nous empêchent de penser l'innovation et nous entraînent souvent à reproduire les mêmes erreurs.
Ce changement d'état d'esprit doit nous aider à parvenir à sortir de ces systèmes dans lesquels nous évoluons pour non plus seulement faire mieux, mais entrer dans le faire autrement. Par exemple, nous n'avons cessé d'améliorer la performance des moteurs et le niveau de pollution que la combustion des hydrocarbures provoque. Pourtant, l'utilisation de la voiture continue à figurer parmi les facteurs principaux de l'augmentation de l'effet de serre. Pourquoi ? Simplement parce que la population mondiale a augmenté en même temps que son pouvoir d'achat et qu'il y a de plus en plus de véhicules en service. Ce simple constat nous montre bien les limites de l'amélioration.
Penser autrement, ce serait abordé la problématique dans son ensemble, c'est-à-dire en identifiant les besoins de déplacements qu'ils soient professionnels ou privés, pour tenter de trouver des solutions locales à ce problème global, et ceci, en tenant compte non seulement des incidences écologiques, mais également sociales, et bien sûr de la viabilité économique de ces solutions. Ce n'est qu'à ce prix que l'on permettra à nos élèves, futurs ingénieurs, politiciens, économistes, décideurs du monde ou simples citoyens de demain, d'entrer dans une pensée prospective innovante et créatrice, riche d'une réflexion éthique, appuyée sur des connaissances issues tant des sciences humaines que naturelles, des mathématiques, que de la philosophie, car c'est là que réside notre plus grande responsabilité.
Tous les dirigeants du monde ont été des élèves et des étudiants. À nous de leur donner les moyens de penser un monde où le respect de la vie sous toutes ses formes serait la norme. Pour y parvenir, certaines prérogatives pédagogiques et didactiques sont à mettre en place. Tout d'abord, afin de favoriser le développement de la flexibilité et de la plasticité de notre cerveau, l'élève doit être mis dans des situations qui lui permettent de tisser des liens. Si certains élèves vont être tout à fait capables de le faire dans n'importe quelle situation d'enseignement, une pédagogie interdisciplinaire tournée vers la problématisation et l'investigation va grandement favoriser le développement d'une pensée systémique en même temps qu'analytique. C'est la raison pour laquelle nous faisons souvent appel à la pédagogie de projet qui, en permettant d'aborder des problématiques complexes, donne un véritable sens aux connaissances multiples qui, immanquablement, vont apparaître.
Cette approche systémique de problématiques complexes est à la base de tout le développement de la pensée complexe, telle que je l'ai définie dans mon ouvrage "Pour une éducation au développement durable", ou des habitudes supérieures de la pensée, comme les définit Conklin, dans son ouvrage "Stratégie pour développer la pensée critique et créative". En travaillant de cette manière, en proposant aux élèves et aux étudiants des sources d'information différentes, reflétant des points de vue parfois opposés, nous leur permettons également de développer un esprit critique, capable de différencier les faits des opinions, et de démasquer les stratégies de manipulation telles que nous pouvons les observer dans les publicités ou d'endoctrinement utilisées tant par les politiques que par les agents économiques.
Vous l'aurez compris, l'éducation en vue d'un développement durable vise l'éducation d'un citoyen complet, responsable, capable de prendre des décisions argumentées dans toutes les situations de la vie. Sans chercher elle-même à endoctriner, elle vise l'autonomie de pensée et l'apparition d'individus dont l'éthique autorise le développement de sociétés plus humaines, plus équitables, et respectueuses de l'autre dans toute sa diversité.