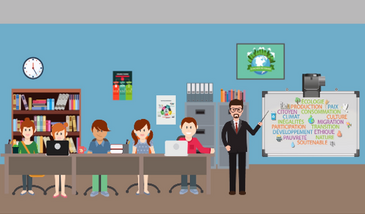En ligne depuis le 28/12/2017
4.1/5 (8)

Description
Ce MOOC 2E2D est complémentaire au MOOC « Environnement et développement durable » produit et coordonné par UVED en 2015. Ce premier MOOC portait sur les connaissances de base, les fondamentaux du domaine et était à destination particulièrement des étudiants pour favoriser le continuum bac-3/bac+3.
Le deuxième MOOC qu’UVED propose porte quant à lui sur les compétences. Il est prioritairement à destination des enseignants du primaire au supérieur et se veut plus opérationnel. La dernière semaine du MOOC « Environnement et développement durable » introduisant ces questions, ce MOOC 2E2D assure donc une forme de continuité permettant aux enseignants d’éduquer à l’E2D et d’intégrer le développement durable dans leur projet d’école.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Mentions Licence
- Sciences de l'éducation
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+1
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
- Bac+5
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Remise en contexte historique de l'éducation au DD (5…

Les fondements didactiques de l'éducation au DD (5 vidéos)

Les outils didactiques de l'éducation au DD (11 vidéos)

Les représentations en vue d'une EEDD (5 vidéos)

Les démarches pédagogiques en EEDD (17 vidéos)
Émergence de l'éducation au développement durable
André Giordan, Professeur à l'Université de Genève
L'intérêt de l'homme pour la nature est très ancien. On pourrait citer pêle-mêle des philosophes, des écrivains, des penseurs, des poètes. Dans l'Antiquité par exemple Pline l'Ancien ou Saint-Augustin, plus près de nous, Giordano Bruno ou Campanella ou Ronsard, et bien sûr le XVIIIème siècle qui fut une époque particulièrement significative où Rousseau en Suisse Romande fut l'un des chantres majeurs. Certains dysfonctionnements étaient bien sûr déjà dénoncés depuis l'Antiquité : les pollutions urbaines ou les nuisances, comme le bruit et l'insalubrité, dans les cités romaines ou les embouteillages, ou le smog dans les grandes villes européennes au XVIIIème, XIXème siècle.
L'idée d'environnement est plus récente par contre, son émergence ne fut pas immédiate. On pourrait mettre en avant deux dates symboliques : 1872, 1972. 1872, c'est le triomphe de l'industrie moderne. Parallèlement, une idée fait son chemin, celle de protection de la nature. Elle est symbolisée par la création du célèbre Parc Yellowstone sur le territoire des Indiens Crow qui est décrit comme une merveille de la nature. Et puis en parallèle la naissance d'un ensemble d'associations pour conserver la faune, la flore sauvage d'une part, les sites et monuments d'autre part. Parmi les plus prestigieux, on peut citer le Sierra Club ou l'Audubon Society aux États-Unis, la National Trust en Grande-Bretagne, la Société zoologique d'acclimatation en France. En parallèle toujours, les jardins botaniques qui fleurissent en Suisse Romande. 1972, c'est la première conférence internationale organisée par l'ONU qui se tient à Stockholm. Le document final en 26 points constitue une sorte de complément à la Déclaration des Droits de l'Homme. L'article premier proclame "Tout homme a droit à un environnement de qualité et le devoir de le protéger pour les générations futures". Entre temps donc un siècle durant laquelle la Terre a connu le plus formidable développement économique et démographique, et surtout une exploitation acharnée des ressources énergétiques.
Dans la population, un sentiment se propage, du moins dans les milieux assez formés, "Ne va-t-on pas trop loin ?" Ce sentiment sera largement partagé par le grand public à l'occasion de plusieurs événements que commencent à populariser les médias. Citons quelques dates : 1962, "Printemps silencieux", le livre de Rachel Carson, un biologiste qui trace un sombre tableau de l'environnement gravement pollué à l'époque par un produit chimique, le DTT. 1967, la célèbre marée noire d'un super pétrolier, le Torrey Canyon, sur les côtes anglaises, qui va infester la Bretagne. 1965-1968, l'émergence progressive de ce qui deviendra le scandale des Minamata, qui date en réalité de 1953, qui est un scandale lié aux productions liées au mercure qui va bien sûr être pris par les poissons et qui va ensuite contaminer les pêcheurs.
C'est dans ce contexte que, en tant que professeur de biologie à l'époque en France, je vais introduire dans les cours, sans tenir compte des programmes, ce qui va me faire quelques problèmes, des différents thèmes d'environnement comme le tri des déchets, l'épuisement des ressources, les grandes pollutions planétaires, la déforestation qu'on appelait à l'époque les pluies acides, la réduction de la biodiversité qu'on appelait à l'époque la disparition des espèces et puis les mauvaises qualités de l'eau et de l'air, et surtout le danger nucléaire.
L'idée de l'environnement sera renforcée dès 1973 avec le choc pétrolier, premier choc pétrolier qui entraîne une prise de conscience du gaspillage. La même année, plusieurs textes vont jouer un rôle important, notamment le rapport "Halte à la croissance" du Club de Rome, qui met en avant bien sûr la croissance zéro, croissance toujours pas prise en compte aujourd'hui. Et puis la même année encore donc l'essai de l'américain Schumacher, "Small is beautiful", qui apporte une réelle vision du monde. On va mettre l'accent sur le petit et plus toujours sur le grand. On arrive à 1974 où l'UNESCO en relation avec le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, va tenter d'impulser, de faire naître cette éducation relative à l'environnement.
Le point de départ officiel c'est la conférence de Belgrade en 1975. La France doit bien sûr être représentée, comme toutes les conférences de l'UNESCO. Malheureusement le ministre de l'époque, les grands chefs d'administration ne comprennent pas son intérêt et on va chercher de partout un représentant. Alors comme je m'étais fait repérer dans mes classes, on va développer des questions d'environnement, on va me proposer d'être le représentant français à cette conférence internationale. Cette conférence va développer les objectifs d'éducation relative à l'environnement, comme on le disait à l'époque, qui était de former une population mondiale, consciente, préoccupée de l'environnement et des problèmes qui s'y rattachent, une population qui ait connaissance, qui ait des compétences, qui ait l'état d'esprit, des motivations et le sens de l'engagement et permette de travailler individuellement et collectivement, résoudre les problèmes actuels et empêcher que s'en pose de nouveaux. C'est la charte de Belgrade. C'est une charte dans laquelle je suis pas mal intervenu dans la mesure où on mettait trop l'accent à l'époque sur les connaissances et j'ai essayé d'introduire des compétences, et surtout l'état d'esprit.
L'UNESCO justement me repère pour ces idées un petit peu innovantes, à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique, et me propose de diriger la première recherche pilote dans les écoles, c'est la recherche INRP, Institut National de Recherche Pédagogique, Unesco-PNUE, qui est une grande entreprise d'éducation qui va concerner 2 000 élèves de 25 écoles primaires et secondaires. Cette étude, qui a duré 4 ans, sur 30 thèmes différents, vont développer toute une série de points pédagogiques qui sont encore très présents aujourd'hui, par exemple partir des problèmes vécus par l'apprenant : aménagement d'espaces, pollutions, nuisances. On va développer, ce qui était nouveau à l'époque, les investigations, telles que les enquêtes, les premières analyses systémiques, et des simulations.
En même temps, ces projets développés n'étaient plus simplement des projets académiques puisqu'ils débouchaient sur des activités concrètes : des expositions pour informer les élèves ou les parents ; des interventions, alors c'était vraiment nouveau, auprès des autorités locales ; la réalisation de matériel à partir de produits de récupération et surtout encore plus nouveau et qui posait quelques problèmes, des contre-projets, notamment un contre-projet d'autoroute ou un contre-projet d'aménagement d'un espace pour la municipalité. Les résultats de cette première recherche seront publiés dans une première collection de documents pour la formation des enseignants, elle s'appelle "Série documentation environnementale", dont on a fait un grand nombre de numéros qui ont été réalisés ensuite en relation avec un spécialiste d'écologie qui était Christian Souchon.
On arrive à 1977, la conférence intergouvernementale de Tbilissi dans le prolongement de Belgrade. Cette conférence, j'y interviens en participant à la délégation française, mais surtout l'UNESCO me confie ensuite en nègre de rédiger le rapport des conclusions. Cette conférence va être suivie pendant 10 ans de toute une série de conférences régionales, dont la conférence d'Helsinki, en Europe et puis on finit évidemment par la conférence intergouvernementale de Moscou en 1987, 10 ans plus tard. Et pour tous ces documents, comme j'étais une des rares personnes à l'époque qui se motivait sur les questions d'environnement, on m'a confié la rédaction des textes.
Parallèlement en France j'ai eu la chance aussi d'être consultant pour la première exposition portant sur l'environnement au Centre Georges Pompidou, qu'on appelle Beaubourg. 1981, je suis nommé professeur à l'université de Genève, je fonde le Laboratoire de Didactique et d'Épistémologie des Sciences. Et dans ce cadre, en 1982, je montre le premier cours en Europe de formation d'éducation de l'environnement. Toujours dans ce cadre, plusieurs thèses vont être passées, dont celle de Francine Pellaud, qui va ensuite être mon assistante et qui va m'accompagner pour développer beaucoup de travaux en liaison avec l'éducation à l'environnement.
C'est aussi dans ce cadre que va être organisée la première conférence européenne d'éducation à l'environnement, ainsi que plusieurs colloques. Toujours dans ce cadre, une autre recherche avec une autre assistante, Lise Hadler, qui s'appelle la recherche Gerirade, qu'on a montée en relation avec les universités de Caen, d'Amsterdam et de Kiel, sur les problèmes de communication liés à la catastrophe de Tchernobyl. Ces recherches déboucheront sur des outils pour apprendre l'éducation à l'environnement. Certains sont bien connus aujourd'hui, comme l'analyse systémique, la pragmatique, la modélisation ou l'éducation des valeurs qui vont être diffusées par deux bouquins qui s'appellent "Éducation pour l'environnement" à l'époque, développé chez Zéditions.
L'idée de développement durable est plus récente, elle a été consacrée par 182 états lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro en 1992, encore appelé Sommet de la planète Terre, c'est l'agenda 21. Mais cette idée vient d'un rapport qui avait été écrit par un Premier ministre norvégien, Madame Brundtland, appelé "L'avenir à tous" rédigé en 1987. C'est ce texte qui a servi de base à cette discussion au sommet de Rio. Ce texte mettait en avant trois composantes, plus simplement l'environnement souvent encore pensé sous l'angle naturel, mais des sciences humaines à travers la société et l'économie.
À ces trois composantes par la suite, avec Francine Pellaud, nous avons rajouté une quatrième composante qui était l'éthique. Ce sommet de Rio justement mettait en avant le développement durable qu'on appelait en anglais "sustainable development", qu'on a traduit justement par ce terme développement durable, qui n'est peut-être pas bien choisi. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'était une demande aussi des pays en voie de développement qui souhaitaient avoir un développement et non pas simplement être protégés de toute évolution. Cette idée de développement durable va s'installer médiatiquement encore plus fortement lors d'une décennie, 2005-2014, développée toujours pas les Nations Unies, par le biais de l'UNESCO qui était considérée comme l'agence leader.
Ceci nous a conduit à repenser évidemment les questions éducatives, notamment repenser les objectifs, refonder les stratégies pédagogiques et surtout travailler aussi sur les soubassements de la pensée, ceux sur lesquels je peux agir et qui parfois créent des problèmes, ce qu'on appelle dans le jargon "les paradigmes". Repenser les objectifs, ça veut dire ne plus rester simplement à l'idée de l'environnement sous le terme de nature au sens large, mais introduire des questions de société, des questions économiques, et des questions de culture. Ça impliquait évidemment de revisiter la maîtrise d'information, ça impliquait d'introduire plus fortement l'analyse systémique et la pragmatique et d'accompagner l'ensemble par la question des valeurs. Puisqu'en matière de développement durable, il y a des questions de choix à faire, ce qui implique évidemment des valeurs derrière, à quoi je tiens vraiment.
Ceci nous a conduits bien sûr à développer l'analyse systémique en travaillant sur des questions très concrètes comme à la Guadeloupe, la question du chlordécone qui était utilisé sur les bananeraies, polluant qui ensuite va infester évidemment les mers proches et les poissons, les crustacés et introduire des difficultés auprès des populations locales. Mais c'était aussi l'occasion de travailler à l'époque sur la vache folle. On se posait la question, comment se fait-il que ces vaches étaient obligées de manger des nourritures carnées ? Et en travaillant sur l'analyse systémique on voyait comment était organisé le système économique pour comprendre comment les agriculteurs étaient conduits à utiliser ces fourrages virtuels disons-nous.
Nous sommes amenés aussi à développer la problématique qui est non pas seulement la résolution des problèmes, mais surtout arriver à poser des problèmes. Ensuite, à partir des problèmes posés, essayer de trouver des solutions. Malheureusement les solutions en matière d'environnement n'existent pas, il faut penser plutôt optimum, solutions alternatives et les mettre en scène, les mettre concrètement sur le terrain, ce qui impliquait de faire une étude du changement. Beaucoup de sujets ont été utilisés à l'époque, dont certains sont restés célèbres comme le travail que nous avons fait sur le jus d'orange où on essaye de voir un petit peu à travers l'analyse systémique, qui devenait l'écobilan, de voir les conséquences de ce beau geste convivial quand on offre un jus d'orange quand on reçoit quelqu'un. Ce beau geste conduit évidemment à des inconvénients puisque le jus d'orange n'est pas fabriqué en Europe, il vient du Mexique ou du Brésil. Les oranges sont pressées là-bas, elles sont concentrées, transportées et ensuite rediluées ici en Europe, et ensuite il faut les mettre en place dans les supermarchés, ce qui entraîne évidemment pour un seul litre de jus d'orange, des pollutions de litres d'eau ou des pollutions en matière de matière ou d'espace. C'est le même travail qu'on avait fait aussi sur la récupération d'aluminium qui était quelque chose en pointe à l'époque sur les canettes d'aluminium. Bien sûr la récupération d'aluminium diminue la dépense énergétique, évitait l'épuisement de la matière, et les mines de bauxite, mais malgré tout on continuait à avoir des problèmes au niveau des décharges parce qu'on n'arrivait pas à tout recycler. Le recyclage était important, mais l'industrie ne pouvait pas suivre derrière, ce qui amenait des pollutions en Afrique, et aussi des effets sur la santé puisque la récupération d'aluminium dégage, malgré tout, des dioxines et des métaux lourds.
À travers cette refondation des outils pédagogiques, il fallait sortir évidemment des écogestes. Il ne suffisait pas d'éteindre la lumière, d'apprendre aux élèves à couper l'eau quand ils se lavaient les dents ou de trier simplement les déchets, mais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière et pour cela on a monté des projets, des défis, on a fait une pédagogie qui prenait en compte les conceptions des élèves pour tenter de les transformer et là ça nous a conduits à dépasser le constructivisme pour aller vers une pédagogie qu'appelle désormais allostérique. Ça nous a amenés bien sûr à développer l'interdisciplinarité, mais plutôt aller vers la transdisciplinarité, c'est-à-dire de mettre les disciplines au service des projets, d'essayer de déboucher sur des actions, non pas simplement des choses académiques, mais des actions concrètes sur le terrain, de travailler évidemment sur les valeurs et de travailler évidemment sur tout ce qui est derrière ces sujets.
Et là ça nous a conduits progressivement à travailler ce qu'on appelle les paradigmes, c'est-à-dire nous interroger sur des évidences ou débusquer un raisonnement intime. 1 + 1 ne fait pas toujours 2 en matière d'environnement, ça peut faire plus 100 000 si les gens s'associent pour faire des actions positives, ou moins 10 000 si les gens sont en conflit. Ça nous a amenés évidemment à repenser l'idée qui sont aujourd'hui évidentes parce qu'on pensait à l'époque que s'il y avait un gagnant, il y avait forcément un perdant. Or maintenant on sait qu'on peut-être gagnant-gagnant. Ça nous a amenés évidemment à penser aussi que le bon et le mauvais ne s'opposaient pas forcement. Les élèves me demandaient "est-ce que l'ozone est bon ?", tout dépend évidemment de son usage et de son implantation. En haute atmosphère l'ozone est très bon puisqu'il arrête les rayons ultraviolets, en basse atmosphère c'est un hyperoxydant, donc c'est mauvais pour les poumons. Donc ça nous amenait constamment à nous interroger sur la solution pour passer plutôt vers une idée d'optimum ou éventuellement nous interroger sur l'idée d'un indicateur de richesses puisqu’on sait très bien qu'aujourd'hui tout ce qui est santé ou tout ce qui est bonheur n'est pas pris en compte dans le PIB.
Ainsi, il ne suffisait plus de rester au tri des déchets, mais d'essayer d'aller derrière les mots. Le tri des déchets c'était aussi un beau geste éventuellement pour démarrer et motiver les élèves, mais il était intéressant de voir ce qu'il y avait derrière les déchets. Or on s'aperçoit aujourd'hui que les déchets c'est une mine de richesses puisqu'on sait très bien qu'une tonne de téléphones mobiles contient 3,5 kg d'argent, 340 grammes d'or, 140 grammes de palladium, 130 kilos de cuivre, ce qui fait une valeur estimée combinée de 10 000 euros ou 12 000 francs suisses. Mais en même temps il était est aussi intéressant de voir que les déchets sont là pour des raisons économiques, pour des raisons de consommation : qu'est-ce qu'on peut faire pour les éviter ? Et là ça conduit à avoir des réflexions sur éventuellement le partage des biens ou éventuellement une économie solidaire.
En résumé, on voit que l'éducation au développement durable permet d'appréhender la complexité du monde dans ses différentes dimensions, scientifiques bien sûr, mais aussi éthiques ou citoyennes. Et surtout ça impliquait de comprendre les enjeux à travers un moyen de devenir un citoyen responsable. Et là aujourd'hui on est dans une nouvelle dynamique qui peut être intéressante, que les Nations Unies ont encore mise en avant puisqu'ils ont pensé après l'Agenda 21 de développer un agenda 2030.