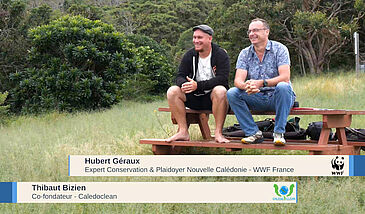En ligne depuis le 09/02/2022
3.8/5 (18)

Description
Tchico Souffou, chargé d'opération construction de la mairie de M'Tsangamouji à Mayotte, discute dans cette vidéo du rôle des collectivités locales pour un développement durable dans les Outre-mer. Il rappelle les spécificités de ces territoires puis montre les documents cadres et les priorités pour l'action. Son collègue Matthieu Lhoste, directeur des travaux et de l'entretien, illustre cela par l'exemple de la lagune d'Ambato.
Objectifs d'apprentissage :
- Appréhender les spécificités énergétiques et écologiques des territoires d'Outre-mer.
- Identifier les documents cadres et les priorités d'action pour les collectivités locales en matière de développement durable.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Niveau
- Bac
Objectifs de Développement Durable
- 15. Vie terrestre
- 17. Partenariats pour la réalisation des objectifs
Thèmes
- Écologie & Action politique
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Souffou Tchico
chargé d'opération construction de la mairie de M'Tsangamouji à Mayotte
Lhoste Matthieu
directeur des travaux et de l'entretien de la mairie de M'Tsangamouji à Mayotte
Institutions secondaires
Vers un développement durable dans les Outre-mer : le rôle des collectivités locales
par Tchico Souffou, chargé d'opération construction et Matthieu Lhoste, directeur des travaux et de l'entretien (Mairie de M'Tsangamouji, Mayotte)
Cette intervention a pour objectif de discuter du rôle des collectivités locales permettant d'accompagner la transition écologique et énergétique des territoires ultramarins. Ici, il s'agit d'illustrer l'exemple de Mayotte.
1. Le contexte de Mayotte
Mayotte est composée de la Grande-Terre et de la Petite-Terre. Elle connaît une forte croissance démographique et aussi une vague migratoire, ce qui explique la faiblesse des revenus des habitants. Ces faiblesses-là expliquent le nombre de logements insalubres et indignes, et ce nombre de logements insalubres et indignes est le plus élevé des DOM. Pour faire un petit récapitulatif du contexte énergétique de Mayotte, on connaît une forte croissance démographique. Qui dit forte croissance démographique dit augmentation de la consommation de la population. Consommation, bien évidemment, énergétique. Aujourd'hui, le contexte énergétique de Mayotte, c'est que Mayotte dépend à 98 % d'une énergie fossile qui est le pétrole. Dedans, on peut voir que 58 % représente le transport, 38 % représente la production d'électricité et 12 %, on peut voir par exemple l'éclairage public. Parmi ces pourcentages-là, on peut constater que si on fait un zoom sur la partie production d'électricité, les habitants, la population, donc, consomme plus de 50 % de la production énergétique d'électricité. Dans ce sens-là, il faut directement agir. En tout cas, c'est le premier facteur sur lequel la population doit agir.
2. Les actions des collectivités pour l’énergie et le climat
L'idée, c'est aussi de dire : on va mener des actions. En tout cas, c'est le rôle des collectivités locales, de mener des actions en faveur du développement durable. Parmi ces actions-là, on peut voir que pour la partie sensibilisation, on a pas mal d'associations qui font ce rôle-là. Et ça marche, pour l'instant, très bien. Il faut les encourager. Les collectivités, le Département et l'État doivent encourager ces associations-là à mener des actions pour pouvoir favoriser et accompagner ce développement durable des territoires. On peut voir également comment, dans le cadre des projets d'aménagement et de construction, intégrer la partie développement durable. Comme on sait que la partie transports est très représentative en matière de consommation, il faut agir sur ce volet-là, le volet mobilité et transport.
3. Le PCAET
Parmi les documents cadres qui permettront d'accompagner le développement durable des territoires, on peut retrouver la programmation pluriannuelle de l'énergie. On peut retrouver ce document-là dans chaque territoire appelé ZNI, zone non interconnectée, donc chaque zone non interconnectée doit élaborer sa propre stratégie liée à la programmation pluriannuelle de l'énergie. Là, on va retrouver Mayotte, qui élabore sa stratégie. Et dans sa stratégie, on a les collectivités, les EPCI, les communautés de communes et les communautés d'agglomération qui élaborent ce qu'on appelle le Plan climat air énergie territorial.
Parmi ces actions du plan climat, on va retrouver plusieurs thématiques, en fonction du territoire, bien évidemment. On va retrouver la partie mobilité, parce qu'on sait qu'à Mayotte, c'est l'un des premiers facteurs sur lesquels il faut agir. On va retrouver la partie énergie. On va retrouver la partie aménagement et construction durable, sans oublier cette partie agriculture et pêche.
À Mayotte, étant donné qu'on dépend à 98 %, toutes énergies confondues, la majorité des produits sont importés. Il faut arriver à un système d'autosuffisance et développer l'agriculture durable.
Le Conseil départemental élabore son propre plan à l'échelle départementale. Mais chaque collectivité, chaque communauté de communes, à Mayotte, il y en a cinq, et chaque communauté de communes, chaque communauté d'agglomération doit élaborer sa stratégie du Plan climat air énergie territorial.
4. Le protection de l’environnement : exemple de la lagune d’Ambato
En matière de protection de l'environnement, on sait que Mayotte détient l'un des plus beaux lagons des DOM et de France. Il faut agir dans ce sens-là afin de protéger ce lagon et l'écosystème marin. Au-delà de l'autosuffisance énergétique et alimentaire, ces notions impliquent une pression sur le milieu naturel. Il va donc falloir concilier, à Mayotte, l'autosuffisance, notamment au niveau de l'agriculture, avec la protection des milieux naturels.
Sur la lagune d'Ambato, des actions de restauration et de protection du site ont été engagées dès 2005 avec un arrêté protectoral de protection de biotope qui a été renouvelé au mois de mai 2020. Qu'est-ce que cela implique derrière ? Cela implique une démarche partenariale entre des associations locales de protection de la nature, comme Gepomay ou Jardin de M'tsangamouji, la DEAL, donc les services de l'État, mais également les services du Département et la commune, pour agir de concert sur cet écosystème spécifique d'une superficie d'environ 4 hectares. Trois types d'actions ont été engagés. Tout d'abord, des actions de sensibilisation auprès du grand public et notamment des écoliers pour leur permettre de prendre connaissance de la faune et de la flore spécifiques à ce milieu. Il faut savoir que c'est un site de nidification du crabier blanc, qui est une espèce classée en danger critique d'extinction, et également d'autres espèces végétales endémiques. Le crabier blanc avait abandonné la nidification sur ce site en 2016, et grâce à ces différentes actions, nous avons pu observer trois couples de crabiers blancs qui sont revenus depuis 2019 suite à la restauration du milieu naturel.
Cela implique des actions de lutte contre les pratiques illégales, que ce soit au niveau des cultures, mais aussi au niveau de l'habitat. Il ne s'agit pas de détruire directement les cultures et l'habitat, mais il s'agit de trouver des solutions avec les habitants pour baisser progressivement la pression sur le milieu naturel et rentrer dans une optique d'aménagement durable bénéfique à tous.