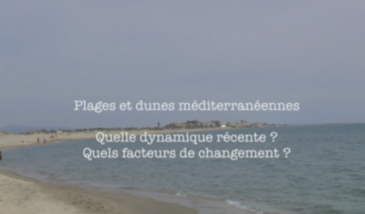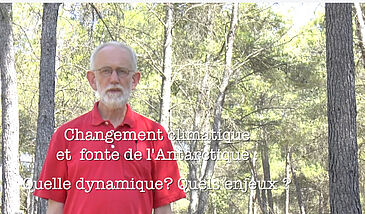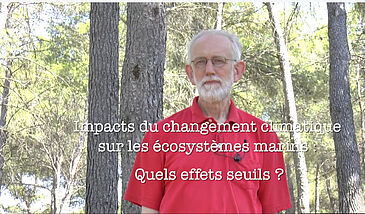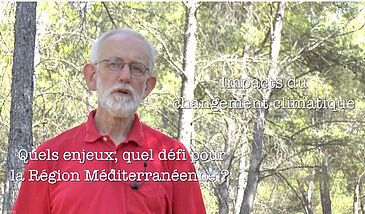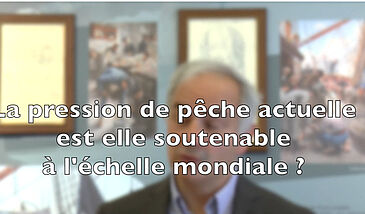En ligne depuis le 01/05/2016
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Philippe Cury, écologue, directeur de recherche à l'IRD, pour la série vidéo : "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"
(Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 14. Vie aquatique
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
CURY Philippe
Philippe Cury, Directeur de recherche, IRD, Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Quels impacts des activités humaines sur les écosystèmes marins ?
Les océans mondiaux subissent de plein fouet tous les changements globaux. C’est-à-dire, on a souvent l’habitude de parler de changement climatique - bien sûr que ces changements climatiques affectent la productivité des écosystèmes marins, par un accroissement de température des eaux, par aussi une acidification des océans, et par toutes sortent de modifications et de bouleversements qui affectent les écosystèmes marins - mais vous savez, il y a d’autres changements induits par les activités humaines, qui sont la surexploitation par la pêche, et puis aussi les pollutions.
Vous avez un engin de destruction massive de la biodiversité marine qui s’appelle le chalut. Le chalut, c’est un engin je dirais préhistorique, c.-à-d. un engin qui consomme beaucoup d’énergie fossile, qui n’est pas sélectif, et donc on ramène à bord des tas de biodiversité, une biodiversité absolument fantastique que finalement on n’utilise pas, puisqu’on la rejette ; on la rejette en mer la plupart du temps, bien que maintenant il y ait de nouveaux dispositifs pour ne pas la rejeter en mer, mais le résultat est identique, c’est-à-dire que cette biodiversité a été détruite.
Pour en revenir à ces changements globaux, en réalité, ils entrent en interaction les uns avec les autres. Si on fragilise une population, une population de poissons par exemple, on s’aperçoit que le niveau d’abondance de ces populations diminue. Ajouter un autre facteur qui va les impacter les fragilise encore plus, parce qu’on observe des synergies entre ces facteurs.
Quand on regarde un bilan au niveau je dirais mondial, on a aujourd’hui, selon les Nations Unies, à peu près 30% des stocks qui sont surexploités. C’est-à-dire qu’on prélève beaucoup plus que ce qu’on devrait, on prélève plus que les « intérêts » c.-à-d. le renouvellement de la population, mais aussi le capital. Donc on observe des populations qui sont de plus en plus affaiblies numériquement.
Une grande étude mondiale a récemment montré que – vous savez, il y avait tous ces grands prédateurs, toutes ces morues, ces mérous, ces merlus, tous ces groupes de poissons - tous ces grands prédateurs ont été diminués d’à peu près 70%. Donc au niveau mondial, on sait que ces poissons sont à un niveau d’abondance de 30% de ce qu’ils étaient. Donc 70%, ils ont diminué en abondance de 70%.
Ça, c’est important. C’est important parce qu’on s’aperçoit que ces poissons là maintenaient une dynamique de stabilité des écosystèmes marins.
Sous les effets de la surexploitation, ces écosystèmes sont en réalité modifiés dans leur fonctionnement. Le fait de surexploiter les gros poissons, de changer la composition des écosystèmes, çà les rend beaucoup plus vulnérables au changement climatique, et ça modifie finalement leur composition.
Alors je vais vous donner un exemple. Quand on surexploité la Morue au Canada, cette Morue qui était très abondante et qui finalement stabilisait l’écosystème, elle a diminué en abondance. Cette surexploitation a amené l’abondance à un niveau extrêmement faible puisque l’espèce est devenue presque rare dans le milieu –on a eu une diminution de 95% de l’abondance de cette Morue.
Quand cette morue s’est en quelque sorte effondrée, on a vu l’émergence de nombreuses espèces comme le Hareng, des petits poissons qu’on appelle petits poissons « fourrage », des espèces pélagiques. Alors ces poissons se sont multipliés, bien sûr ils étaient de moindre valeur commerciale, mais ils ont, je dirais, colonisé le milieu, et ont proliféré. Alors ça a modifié le comportement, le fonctionnement de l’écosystème, parce que ces poissons se sont mis à manger des œufs et larves des morues, ce qui a empêché la Morue de reconquérir finalement l’écosystème.
Donc, ce dont on s’aperçoit, c’est que quand on modifie une des composantes de l’écosystème – et ça c’est le fait, je dirais, de la surexploitation qui souvent cible des espèces de haute valeur commerciale, on modifie de façon souvent durable le fonctionnement de l’écosystème. C’est ce qu’on appelle aussi, en écologie, une cascade écologique. C’est-à-dire que dès que vous modifiez une des composantes de l’écosystème, il faut s’attendre à des surprises - et des surprises on en a je dirais de plus en plus, avec ce schéma de surexploitation des écosystèmes mondiaux – d’émergence de certaines espèces.
En Namibie, en Afrique australe, on a surexploité ces beaux poissons –les merlus, les beaux poissons… –, puis après on a surexploité ces petits poissons dont je parlais juste à l’instant, donc les sardines et les anchois. Il y avait des stocks absolument très abondants de sardines et d’anchois, qu’on a surexploités… et, la nature ayant horreur du vide, se sont mises à proliférer
des méduses.
Aujourd’hui l’écosystème namibien, et ce depuis une vingtaine d’années, produit des méduses. Cela, c’est ce qu’on appelle en écologie un changement de régime. C’est-à-dire que les méduses se sont mises à envahir l’écosystème namibien, et aujourd’hui vous avez dix, vingt, trente millions de tonnes de méduses. Et ces méduses – qui font partie du plancton, en réalité – sont des compétiteurs ou des prédateurs d’œufs et larves de poissons. Donc cela empêche aussi les populations de poissons de retrouver des niveaux d’abondance tout simplement acceptables pour la productivité des écosystèmes marins.
Donc vous le voyez, la surexploitation n’est pas seulement baisse d’abondance d’une espèce, c’est aussi un jeu d’interactions entre différentes espèces, et une modification parfois extrêmement durable de la productivité des écosystèmes marins.