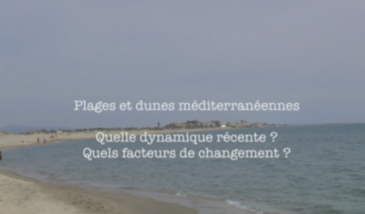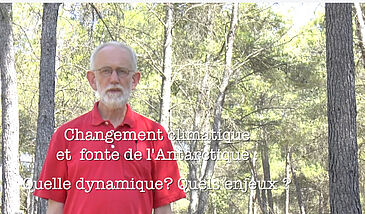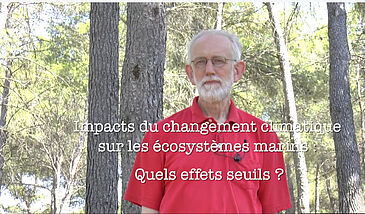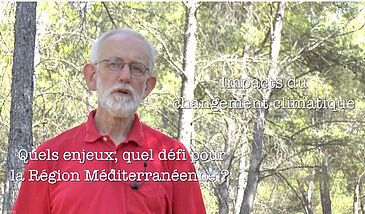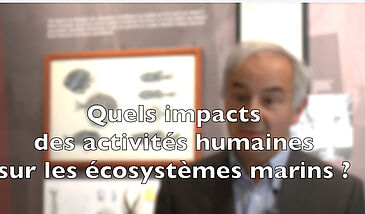En ligne depuis le 01/05/2016
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Philippe Cury, écologue, directeur de recherche à l'IRD, pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"
(Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 14. Vie aquatique
Thèmes
- Alimentation
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
CURY Philippe
Philippe Cury, Directeur de recherche, IRD, Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
La pression de pêche actuelle est-elle soutenable à l’échelle mondiale ?
Aujourd’hui, les océans sont pleinement exploités. Il n’y a pas d’endroit où l’on ne pêche pas. Vous avez les dernières évaluations de l’effort de pêche, c’est-à-dire le nombre de bateaux, le nombre de pêcheurs, le nombre de moyens qui sont mis pour capturer les poissons : ces nombres sont beaucoup trop grands. Aujourd’hui on a à peu près quatre fois trop d’effort de pêche. Celui-ci était en réalité assez modéré jusque dans les années 1980, et puis tout d’un coup, depuis 1980, on assiste à une explosion de cet effort de pêche – ce nombre de pêcheurs, ce nombre de bateaux – au niveau mondial. Au niveau mondial – il y a des pays où cet effort de pêche a explosé, notamment en Asie, en Afrique – aujourd’hui, il est quatre fois trop important.
Vous avez par exemple un engin de destruction massive de la biodiversité qui s’appelle le chalut. Alors le chalut c’est quoi ? C’est un engin qu’on traine sur le fond, et qui racle tout ce qui est présent. Ça peut être toutes sortes de végétaux, d’animaux, des mollusques, et puis bien sûr ça prend les poissons. Alors après vous montez tout ça sur le pont et puis vous sélectionnez ce que vous voulez. Mais on voit que les rejets, c.-à-d. que tout ce qui ne va pas être commercialisé est rejeté en mer, et ces rejets sont parfois extrêmement importants. On estime qu’au niveau mondial - alors vous savez, les prises mondiales déclarées c’est à peu près 80, 90 millions de tonnes -, vous avez (alors ça, c’est une donnée extrêmement difficile à se procurer) 10, 20, 30, 40 millions de tonnes qui sont rejetées en mer. C’est-à-dire une quantité absolument incroyable de biodiversité, d’animaux qui sont morts, et qui retournent – alors on pourrait dire, ça retourne dans le cycle du vivant –en réalité ça retourne au fond de la mer et ça sédimente ; donc ça n’est pas vraiment une mortalité utile pour le fonctionnement des écosystèmes.
Au niveau des ressources marines, on assiste à de la surexploitation. Cette surexploitation, elle se traduit comment ? Elle se traduit que depuis les années 1980, malgré une demande en poisson qui n’a jamais cessé d’augmenter depuis les années 1950– puisque vous savez que dans les années 1950 on consommait quelques dizaines, une vingtaine de millions de tonnes de poisson, aujourd’hui on consomme 80 millions de tonnes de poissons sauvages, qui sont pêchés en mer. Pourquoi ? Parce que notre appétit pour les poissons n’a pas arrêté d’année en année de s’accroître.
Dans les années 1950, on consommait 8-9 kg par habitant (par an) et on était trois milliards, et on aujourd’hui 20 kg par habitant alors qu’on est sept milliards. Donc vous voyez que la pression sur les ressources marines est devenue absolument gigantesque, dû à notre appétit féroce pour ces poissons qui je le rappelle sont des poissons sauvages. Ç’est-à-dire que ce n’est pas de l’élevage : ça ne peut pas être contrôlé, c’est comme si en milieu terrestre on mangeait du lion ou des gazelles etc. Alors vous voyez cette pression qu’on met sur les océans. Quand on revient à cet effort de pêche, on s’aperçoit que depuis les années 1980 les captures en réalité se sont stabilisées. Elles se stabilisées non pas parce qu’on gère bien les ressources et qu’on les exploite de façon durable, mais parce que l’effort de pêche n’a pas cessé d’augmenter - et cependant les captures n’ont pas augmenté. Donc ça c’est un signe de la surexploitation au niveau mondial.
La pêche, vous savez, c’est une activité de prélèvement de ressources sauvages, c’est notre dernière activité à une échelle industrielle. Mais dans de nombreuses zones, cette activité là n’est pas contrôlée, ou est très peu contrôlée, ou mal contrôlée. Donc le résultat, c’est que c’est une pêche sauvage. Et ce dont on s’aperçoit au niveau mondial, c’est qu‘il n’y a rien de pire, au niveau mondial ou au niveau local, que le laisser-faire. Le laisser-faire revient inéluctablement, avec toutes les pêcheries que je connais où il n’y a pas de gestion – soit des engins de pêche, soit de l’accès, soit par des quotas – et bien termine inéluctablement au fait que les poissons disparaissent, et que les pêcheurs disparaissent aussi.