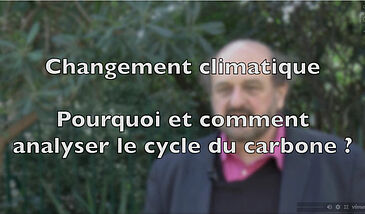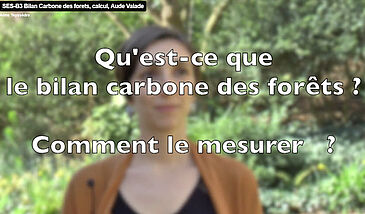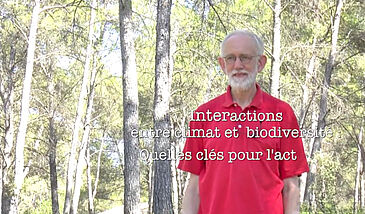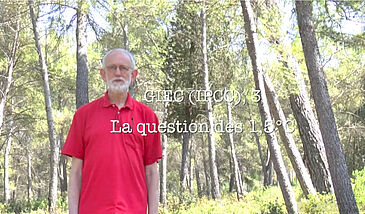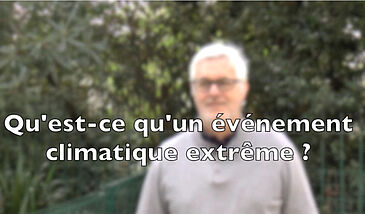En ligne depuis le 25/06/2017
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Hervé Le Treut, Directeur de l'Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"
(Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 13. Lutte contre le changement climatique
Thèmes
- Atténuation, Adaptation & Résilience
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
LE TREUT Hervé
Hervé Le Treut, climatologue, Directeur de l’IPSL (2017)
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Le problème climatique : Quelle prise de conscience par les scientifiques ? Par les sociétés ?
Le problème du changement climatique est un problème plus récent que ce qu’on pense souvent. On cite souvent Arrhenius, au début du 20e siècle, qui avait fait des calculs montrant que si on doublait la quantité de CO2 dans l’atmosphère on aurait un réchauffement de 5°C. A l’époque d’Arrhenius, c’était une perspective extrêmement lointaine. D’ailleurs Arrhenius voyait plutôt ça comme une bonne chose, qui pourrait nous protéger des âges glaciaires, dans quelques milliers d’années.
Le fait que ces problèmes climatiques vont nous affecter de manière très proche, très rapide, c’est une conscience qui s’est développée dans les années d’après guerre. On s’est rendu compte d’abord que le CO2 avait toute chance de rester en grande partie dans l’atmosphère, l’océan et la surface continentale étant incapables de les reprendre au rythme qu’il fallait. Et dans les années 1960-70, le premier observatoire de la composition de l’atmosphère, qui est sur le volcan de Mauna Loa à Hawaï, a permis de montrer qu’il y avait effectivement une augmentation dans l’atmosphère du CO2.
Donc le problème du réchauffement climatique, cela d’abord été un problème de réchauffement de la Planète : les gaz à effet de serre (GES) réchauffent. On peut aussi avoir un problème de refroidissement, puisque ce qu’on appelle les aérosols, les petites particules de poussières qu’on met dans l’atmosphère on plutôt tendance à la refroidir, en réfléchissant le rayonnement solaire. Et pendant un temps, la compétition entre ces deux effets –réchauffement contre refroidissement – a posé problème. Mais on s’est rendu compte très vite que les poussières précipitent en l’espace de quelques semaines, donc qu’elles ne s’accumulent pas dans l’atmosphère, au contraire des GES qui peuvent rester des décennies voire plus – voire des siècles – dans l’atmosphère, et qui eux vont s’accumuler.
D’ailleurs on observe assez clairement que, juste après la deuxième guerre mondiale, quand a commencé la phase d’industrialisation rapide, les émissions de polluants dans l’atmosphère, de gaz, de particules, on voit d’abord un refroidissement dans la première décennie, comme si les aérosols refroidissaient la Planète, et puis ensuite on voit un réchauffement qui prend le dessus progressivement et qui est toujours là, avec des aller-retour qui sont ceux de la variabilité naturelle du climat.
Alors la question qui s’est posée tout de suite, c’est « Est-ce que c’est dangereux ? ». Et les premières études qui ont vraiment montré que le climat pouvait changer, changer dans des proportions importantes, qui pouvaient être en ampleur l’équivalent d’une transition Glaciaire-Interglaciaire, c’est à la fin des années 1970. Le premier grand rapport, coordonné par Jules Charney en 1979, a été un rapport à l’Académie des sciences américaine. Donc c’est vraiment dans les années 1970-80 qu’on a commencé à analyser les conséquences possibles du changement climatique, d’abord grâce à des calculs de modélisation.
Les premiers changements observés, eux, sont venus dans les années 1990. C’est depuis les années 1990 qu’on commence à avoir des résultats, en termes d’observation, qui sont ceux anticipés par les modèles dans les années qui précédaient. Donc on est face à un problème finalement très récent, et les changements qu’on attend sont des changements à venir.
Aujourd’hui, on a ces premiers symptômes, on peut prendre ça comme des symptômes. Les changements réels, ceux qui nous font peur, sont des changements qui sont plutôt pour les prochaines décennies. Mais on a déjà engagé cet avenir là, puisqu’on a déjà émis ces gaz à effet de serre, qui vont rester longtemps dans l’atmosphère. Alors il y a des études pour essayer de développer des technologies pour aller chercher ce CO2 ou ces autres GES dans l’atmosphère. Pour le moment ce n’est pas conclusif. On n’a pas du tout les échelles qu’il faudrait : on peut peut-être reprendre des millions de tonnes de carbone, mais certainement pas des milliards, comme ce que l’on émet annuellement. Donc on est confronté à ce problème qui a une dynamique très récente et face à laquelle on n’a pas encore développé les
outils qu’il faudrait pour réagir.
On est au contraire dans une situation qui a évolué très rapidement. Les émissions de gaz à effet de serre sont beaucoup plus rapides maintenant qu’il y a quelques années : on est passé d’un milliard de tonne par an au début des années 1950, à six ou sept dans les années 1990 -au moment où on a réuni tous les chefs d’État à Rio pour essayer de mettre fin à ces émissions-, et aujourd’hui à dix milliards de tonnes de carbone par an. Tout ça se stocke dans l’atmosphère et on a une nécessité, qui est maintenant une nécessité brutale, celle d’arrêter de manière immédiate, de manière rapide, ces émissions de GES.