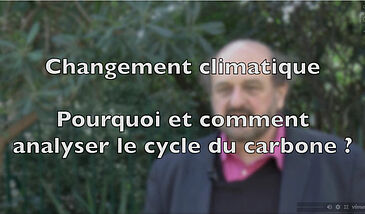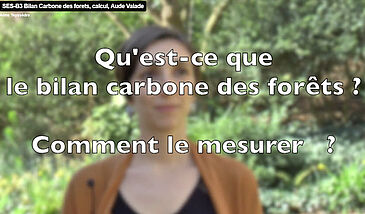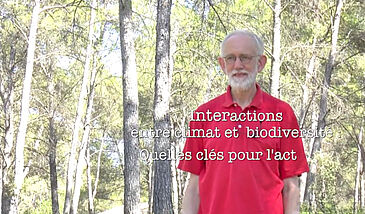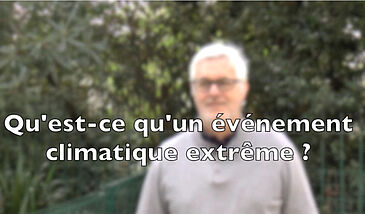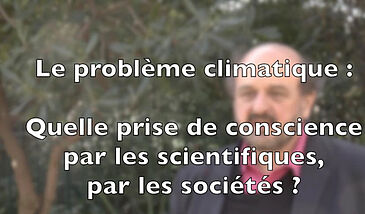En ligne depuis le 09/03/2020
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Wolfgang Cramer, Directeur de Recherche à l'IMBE, pour le projet web Nexus Clés ("SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé": www.su-ite.eu/nexus-videos-cles/plan/ ).
[Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique? ]
Conception et coordination de ce projet web, réalisation des vidéos : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 13. Lutte contre le changement climatique
Thèmes
- Atténuation, Adaptation & Résilience
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Cramer Wolfgang
Directeur de recherche à , IMBE
La question des 1,5°C
Question-clé à Wolfgang Cramer, Directeur de recherche à l’IMBE,
Exposé transcrit et adapté par Anne Teyssèdre, 2020
Sur la fameuse question du 1,5°C, il faut d’abord comprendre qu’au moment de la COP 21 à Paris, en 2015, il y avait une reconnaissance particulièrement forte des gouvernements pour les anciens résultats du GIEC. Les premiers résultats avaient montré qu’au-delà d’un réchauffement de plus de 2°C (par rapport à l’état pré-industriel), le risque d’une hausse du niveau de la mer était tellement important que certains pays, dans le Pacifique et ailleurs, risquaient de perdre complètement leur territoire. Ceci, et d’autres arguments, ont amené la COP 21 à établir l’Accord de Paris.
L’objectif de cet accord, conclu en 2015, était évidemment de baisser les émissions de gaz à effet de serre à un point tel que le réchauffement climatique ne dépasse pas 2°C par rapport à l’ère préindustrielle - et idéalement 1,5°C serait encore mieux. Donc la question était déjà : qu’est-ce que cela ‘donne’ de rester à 1,5°C ou à 2°C? Et dans un deuxième temps : est-ce que c’est possible ? Parce que même avant 2015, il y avait de gros doutes sur la possibilité, même avec une réduction maximale des gaz à effet de serre, de rester en dessous des 2°C. Les travaux lancés en 2015, pour le Rapport de 2018, ont montré qu’effectivement c’est possible.
Il est encore possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui permettent de maintenir le réchauffement planétaire inférieur à 2 °C. C’était un peu une surprise pour beaucoup de collègues, mais il faut reconnaître qu’il y a plusieurs éléments dans cette analyse qui méritent d’être regardés de plus près.
Le premier est : est-ce techniquement possible de transformer une société depuis son état actuel, avec beaucoup de gaspillage, beaucoup d’émissions de gaz à effet de serre, vers une société neutre au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Cela, c’est à la population au sens large et aux gouvernements, ainsi qu’aux industries, d’établir, en prenant cela comme but, si l’on peut y arriver techniquement.
Le deuxième élément, c’est : si on veut cela, est-ce qu’on est « sociétalement » capable de changer ses comportements, de vivre carrément autrement pour parvenir à cette neutralité (comme on l’appelle) des émissions de gaz à effet de serre, avec une augmentation de température limitée à 2°C pour 2050 ou 1,5°C pour 2030. Ceci est une question sociétale, ce n’est pas une question scientifique, physique ou biogéochimique. Du côté physique de l’atmosphère, on a bien pu établir que si l’on atteint cette neutralité du carbone - c’est-à-dire si l’on ne fait pas plus d’émissions de GES que l’on en capte en même temps (par l’agriculture ou par d’autres activités) -, si on y arrive en 2030, on pourra effectivement limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.
Mais bien sûr, si l’on demande aux producteurs d’énergie ou de transport de ne rien changer dans notre comportement et de nous fournir les mêmes services, on n’arrivera pas à cet objectif de neutralité du carbone, ce n’est pas possible. Parce qu’on n’a pas suffisamment développé les technologies au niveau des ressources renouvelables pour assurer cette neutralité de carbone. Donc on peut dire que sur le plan social, pour la société, il y a de grosses questions sur la possibilité de limiter le réchauffement 1,5 °C, mais physiquement et techniquement c’est possible.
Ensuite on se pose la question : à quel point pourra-ton limiter le réchauffement mondial à l’horizon 2050 ? Est-ce qu’on peut arriver à 1,8° ou 2°, ou 2,5°C ? Ou, ce qui semble bien plus probable aujourd’hui, à (bien) plus que 3° ou 4°C de réchauffement ? Et là, la question se retourne aussi vers la société. Si on ne fait rien, si on continue à consommer comme c’est le cas aujourd’hui, si on n’opère pas une transformation sociétale –vers une société qui consomme moins d’énergie-, on ne pourra pas limiter le réchauffement. Le rapport spécial sur les 1,5°C a mis sur la table une clarté qui n’existait pas avant.