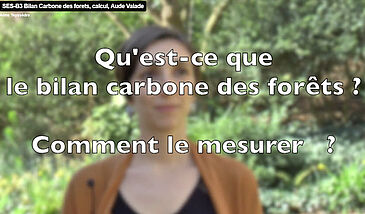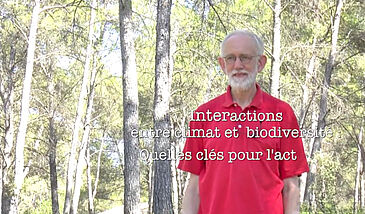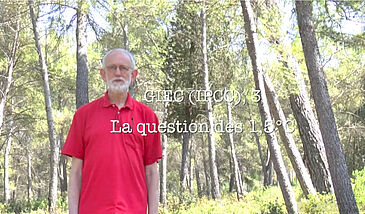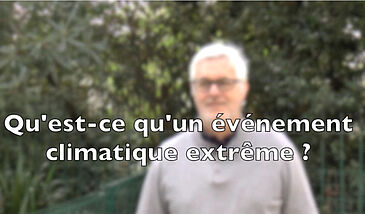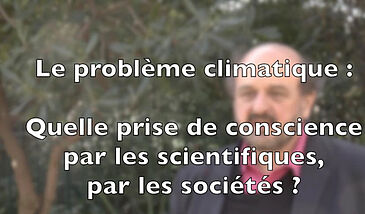En ligne depuis le 26/06/2017
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Hervé Le Treut, Directeur de l'Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"
(Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 13. Lutte contre le changement climatique
Thèmes
- Atténuation, Adaptation & Résilience
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
LE TREUT Hervé
Hervé Le Treut, climatologue, Directeur de l’IPSL (2017)
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Changement climatique - Pourquoi et comment analyser le cycle du carbone ?
L’action des hommes sur le climat via les GES met en jeu des cycles, qui sont le cycle du Carbone par exemple, et ceux d’autres éléments chimiques, qui sont des cycles qui conditionnent la durée de vie de ces problèmes et leur manifestation dans le temps.
Alors la compréhension du cycle du Carbone s’est faite petit à petit, tout au long de la deuxième partie du 20e siècle. Le CO2 qui est émis par la combustion du charbon, du pétrole, du gaz naturel est un CO2 qui va d’abord dans l’atmosphère ; il est repris par les océans – ça on le sait depuis longtemps – mais il n’est pas repris complètement par les océans.
Pendant beaucoup d’années, alors qu’on savait reconstituer ce qui est émis dans l’atmosphère initialement - parce qu’on a une idée du commerce du charbon, du pétrole, du gaz, alors on sait à peu près ce qu’on échange et ce qu’on brûle - ce qui rentre dans l’océan a été beaucoup plus difficile à évaluer. Donc il y a eu un développement de recherches très importantes, qui ont été favorisées par les satellites. Les satellites permettent de récupérer des informations données par des bouées, qui peuvent dériver, qui peuvent monter et descendre dans l’océan, donc on a maintenant une bonne connaissance de ce qui se passe dans les océans et on sait que l’océan capte un quart de ce qui est émis seulement - ça suffit pour rendre les océans capables d’abîmer le corail, car plus acides. Mais il y a une moitié qui reste dans l’atmosphère – on sait mesurer aussi ce qui s’en va dans l’atmosphère. Puis un dernier quart dont on s’est finalement rendu compte qu’il devait être repris par les continents, par la végétation.
L’analyse du cycle du Carbone est devenue au fil du temps un sujet de recherche en soi, qui mobilise des équipes, qui est un des thèmes majeurs de nos disciplines, qui fait appel à des mesures au sol – il y a maintenant des réseaux de mesure au sol qui sont extrêmement développés -, qui fait appel aussi de plus en plus à de l’information satellitaire. Et les motivations sont doubles. Il s’agit bien sûr d’abord d’essayer de comprendre ce qui va se passer dans le futur et de développer des scénarios qui soient cohérents. Il s’agit aussi de surveiller la Planète, de la surveiller en étant capable de savoir si les intentions affichées par les différents Etats vont être suivies d’effet, donc d’avoir une capacité à faire une sorte de police des émissions de GES.
Alors je n’ai parlé que du Carbone, mais il y a beaucoup d’autres éléments qui participent à cette biogéochimie de la Planète : on peut parler du Phosphore (P), on peut parler de l’Azote (N). Donc toutes ces études qui correspondent à la fois à des GES actifs mais aussi à des composantes qui sont celles de la vie sur la Planète -et qui déterminent la végétation, donc la photosynthèse, la biodiversité, …- toutes ces études ont pris une place énorme. Et c’est un pendant de toutes les études physiques qui ont été faites au début pour comprendre le climat dans ses aspects un petit peu plus liés à la chaleur et à l’eau – qui étaient les deux éléments des premières études climatiques.