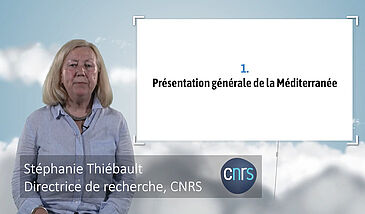En ligne depuis le 02/11/2023
5/5 (1)

Description
Benoît Laignel, professeur à l'université de Rouen Normandie, présente dans cette vidéo, les travaux du GIEC Normandie. Il montre que les effets du changement climatique sont déjà perceptibles en Normandie, et qu'ils devraient s'amplifier au cours des prochaines décennies. Il termine en soulignant l'intérêt de cette expertise scientifique locale pour la sensibilisation et l'aide à la décision.
Objectifs d'apprentissage :
- Savoir qu'il existe, au niveau régional, des sources d'information scientifique en lien avec l'évolution du climat et leurs impacts
- Identifier ce qu'il est possible de modéliser, au niveau local, quand on parle d'impacts du changement climatique
- Comprendre ce que peuvent apporter, sur un territoire, de telles connaissances scientifiques
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Science politique
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+1
- Bac+2
Objectifs de Développement Durable
- 13. Lutte contre le changement climatique
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Laignel Benoît
Professeur , Université de Rouen Normandie
Le changement climatique : une réalité en Normandie
Benoît LAIGNEL, Professeur à l'université de Rouen Normandie
Ces dernières années, plusieurs groupes d’experts régionaux d’études sur le changement climatique ont été créés. L’objectif est d’apporter des connaissances sur le changement climatique et ses conséquences à l’échelle régionale et sur cette base de massifier les actions sur les territoires. L’exemple pris ici est celui du travail mené dans le cadre du GIEC normand.
1. Le changement climatique en Normandie : températures
Le réchauffement climatique est une réalité en Normandie. Quand on applique les anomalies de température en comparant la période actuelle avec la période de 1951 à 1980, on constate sur toutes les stations météorologiques normandes des anomalies de température entre +0,6 et +0,8°C. Une autre méthode est de tracer des tendances et de les tester statistiquement. Quand on l’applique, on constate que toutes les stations montrent des élévations de température entre +1,2 et +2°C depuis 1970.
Du côté des projections, quand on compare la carte en bleu, qui représente les températures moyennes en Normandie, avec les autres cartes, vous voyez une évolution vers des couleurs chaudes, jaune et rouge, avec le scénario RCP 2.6 en haut et le scénario RCP 8.5 en bas, qui sont les scénarios optimiste et pessimiste (figure ci-dessous). Ceci témoigne d’un réchauffement climatique compris entre +0,7 et +4,1°C, suivant les scénarios ou les secteurs que l’on regarde.
2. Inondations et ressource en eau
Un autre impact est celui des inondations, en lien notamment avec l’augmentation des précipitations intenses. Sur les cartes ci-dessous, on voit une évolution vers des couleurs de plus en plus bleues qui témoignent d’une augmentation entre +2 et +10 % de l’intensité des précipitations. Cela va conduire à une augmentation du ruissellement, des crues de rivières et des remontées de nappes dans certains secteurs, et, de facto, à une augmentation de la fréquence et de l’intensité des inondations, de l’érosion des sols, de la turbidité des cours d’eau et des coulées boueuses.
Quand on combine ces précipitations intenses qui vont donner des crues au niveau des rivières littorales avec l’élévation du niveau des mers comprise entre 40 centimètres et 1,10 mètre ainsi que les tempêtes, on va aller vers une augmentation de la fréquence et de l’intensité des inondations dans les estuaires, liées à des phénomènes de blocage de l’écoulement des cours d’eau, une augmentation de la fréquence et de l’intensité des inondations dans les zones côtières, et également une accélération du recul du trait de côte.
Pour illustrer ces phénomènes de blocage de l’écoulement des cours d’eau, une simulation a été réalisée sur l’estuaire de Seine sur la boucle de Rouen. On observe les zones inondées, en orange, avec des points rouges qui correspondent aux sites SEVESO qui seront régulièrement inondés. Il faut donc percevoir le changement climatique comme un accélérateur du multirisque, puisqu’il va conduire à une augmentation des risques industriels, des risques sanitaires, économiques et sociétaux.
En ce qui concerne les ressources en eau, les projections indiquent une diminution du débit moyen annuel des cours d’eau sur le bassin de la Seine entre -10 et -30 %. Une diminution de la recharge des nappes par les précipitations qui va entraîner un rabattement du niveau de celles-ci entre 1 mètre et jusqu’à 10 mètres en Normandie.
Il y a également un problème de dégradation de la qualité de l’eau l’hiver, en lien avec une augmentation de la turbidité, et l’été, en lien cette fois-ci avec une diminution des volumes d’eau, qui dilueront moins les éléments qui se trouvent dans cette eau, ce qui entraînera des problèmes d’oxygénation et des pollutions potentielles par surconcentration d’éléments chimiques. Il faudra notamment surveiller les rejets de stations d’épuration, qui devront être recalibrées en lien avec la diminution des volumes d’eau dans les cours d’eau. Ceci sous-entend donc des problèmes de disponibilité eneau à certaines périodes, et donc des périodes d’économie et de restriction plus nombreuses et plus longues.
3. Santé
Un autre impact important concerne la santé. Les inondations vont conduire à des impacts physiques, des impacts psychologiques post-traumatiques, et des impacts sur la qualité de l’eau. Les vagues de chaleur se ressentent déjà en Normandie, puisque, si on prend l’exemple de la canicule de 2019, c’est une surmortalité de plus de 10 % par rapport à la moyenne nationale. On constate également, et ceci va aussi augmenter, les maladies cutanées, les maladies oculaires. On a aussi des insectes qui ne devraient pas être présents, comme ce moustique tigre, qui peuvent conduire à des maladies infectieuses. La pollution atmosphérique sera exacerbée par le changement climatique, avec des problèmes de surmortalité et de pathologies chroniques, puis également la présence de plantes envahissantes avec des pollens allergisants.
4. Agriculture
Un autre exemple concerne l’évolution de l’agriculture, avec le plafonnement des rendements en blé tendre qui est déjà constaté dans l’Orne et dans l’Eure, dans le sud de la région, et qui est expliqué par la Chambre d’agriculture par le changement climatique pour moitié, avec une augmentation du stress hydrique et thermique. On illustre ci-dessous le problème de stress thermique, avec une augmentation du nombre de jours supérieurs à 25°C entre avril et juin, qui est qualifié de nombre de jours échaudants où on constate des problèmes de maturation et de remplissage des grains.
Un autre phénomène est lié aux pluies intenses, qui conduisent déjà à une dégradation des sols et à une dégradation des cultures.
5. Biodiversité
Le dernier exemple est celui des impacts sur la biodiversité. Il existe une espèce emblématique pour la Normandie qui est le hêtre. Quand on compare ces deux cartes (ci-dessous), on voit qu’à l’horizon 2100, on a une diminution du hêtre, voire même une disparition (en blanc) au sud de la région, et une probabilité d’occurrence de 30 % (en bleu) dans tout le reste de la région.
6. Conclusion
L’objectif du GIEC normand a été de faire un état des connaissances sur le changement climatique et ses conséquences à l’échelle de la Normandie pour sensibiliser et former les décideurs et les populations de ce territoire. Plus de 80 actions de sensibilisation ont été menées depuis 2021, et c’est plus de 10 000 personnes qui ont été touchées.
L’objectif final est de faire évoluer les politiques publiques et privées pour massifier l’action pour lutter contre et s’adapter au changement climatique, et donc réfléchir collectivement pour prendre les mesures les plus appropriées pour ce territoire. Ceci suppose un projet global de territoire qui intègre les innovations, la sobriété sur l’énergie, les ressources en eau et sur toutes les ressources, et qui intègre également les risques.