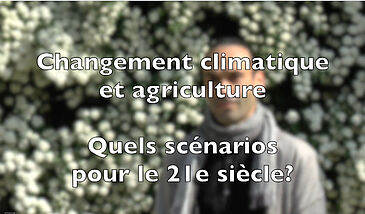En ligne depuis le 21/08/2017
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Luc Abbadie, Professeur d'Ecologie à l'Université P. et M. Curie, Directeur de l'IEES-Paris, pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé" (Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Abbadie Luc
professeur émérite , Sorbonne Université
Luc Abbadie, professeur d’Écologie à Sorbonne Université Sciences
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Quels principaux impacts de l’agriculture sur les sols ?
Les principaux impacts des activités humaines sur les sols sont évidemment de nature agricole, en tout cas en ce qui concerne les impacts directs. J’évoquerai aussi les impacts indirects avec le changement climatique.
Quand on se met à travailler un sol… Qu’est-ce qu’on fait avec le labour ? On rend un sol meuble, ce qui permet aux racines de la plante cultivée de s’installer correctement, et puis on accélère le fonctionnement des microorganismes parce qu’on permet à l’oxygène de circuler dans le sol. Donc si vous accélérez le fonctionnement des microorganismes, ils vont accélérer la dégradation de la matière organique –puisque c’est là qu’il vont trouver leur énergie et les éléments nécessaires à leurs synthèses- et donc vous avez une baisse progressive du stock de matière organique.
Ça c’est le premier résultat, absolument général : dès qu’on met un sol en culture, on diminue le stock de matière organique. Aujourd’hui on considère, qu’à l’échelon planétaire, ce phénomène a apporté une contribution significative –et continue à apporter une contribution significative- à l’augmentation des gaz à effet de serre. Pas seulement du CO2 d’ailleurs, vous pouvez avoir du N2O aussi produit par des sols agricoles en cas de mauvaise gestion de la fertilisation azotée. Et donc on considère aujourd’hui qu’on a une baisse générale de la fertilité des sols, par le biais de cette perte de matière organique.
Évidemment, il n’y a pas que la perte en matière organique qui est une image de la dégradation des sols, qui est un des processus de dégradation des sols. Au niveau mondial, il y a un autre processus qui est important, c’est la salinisation des sols –la question des sols salés.
On a des sols qui sont salés naturellement -c’est lié à la nature du sous-sol rocheux- et puis on a des sols qui sont salés suite à une irrigation.
Alors le processus est assez facile à comprendre. Quand vous amenez de l’eau par irrigation, vous amenez de l’eau bien sûr, mais vous amenez aussi des sels dissous –on n’irrigue pas avec de l’eau pure ! On irrigue avec de l’eau « naturelle », entre guillemets, donc qui contient différents éléments minéraux. L’eau s’évapore, ou elle transpirée par les plantes, mais les sels, eux, ne s’évaporent pas. Donc avec le temps ils s’accumulent, et à un moment donné vous allez franchir un certain niveau d’accumulation, les sols vont devenir des sols salés - c’est-à-dire incompatibles avec la survie d’un grand nombre de plantes.
C’est un processus vraiment répandu à l’échelle mondiale, surtout dans les régions arides, parce qu’évidemment c’est là qu’on fait l’irrigation la plus importante. L’ordre de grandeur, c’est à peu près 20% des sols du monde qui sont touchés par la question de la salinisation.
La troisième grande catégorie de dégradation des sols, c’est l’érosion. Alors là encore, l’érosion est extrêmement liée à la nature de la végétation : si celle-ci est pérenne ou non pérenne, si le sol est couvert ou pas en permanence. C’est lié également à la nature du sol, plus ou moins argileux… C’est très lié aussi aux pratiques agricoles. On voit encore trop souvent, y compris dans nos pays, des gens qui labourent dans le sens de la pente –c’est plus facile. Ça, évidemment, pour stimuler l’érosion, on ne fait pas mieux ! On connaît depuis des lustres la méthode, même parfois depuis des millénaires –il s’agit de labourer suivant les courbes de niveau, par exemple.
L’érosion, c’est quand même aujourd’hui une bonne partie de la perte de fertilité, puisque ce qui est érodé, ce sont des particules notamment argileuses liées à la matière organique. C’est le lessivage –l’entrainement à l’extérieur des parcelles cultivées, à l’extérieur du sol- des éléments nutritifs solubles, comme le Potassium (K), le Phosphore (P), l’Azote (N), qui du coup vont se transformer en polluants, vont générer des phénomènes d’eutrophisation… Bref, l’érosion est une perte de ressource et c’est aussi une source de pollution. Parce que par exemple des pesticides, des herbicides, qui sont associés soit à la matière organique, soit carrément aux particules argileuses, et bien vous les exportez, dans les cours d’eau par exemple, et donc vous exportez la pollution des particules agricoles vers l’ensemble du système.
Donc l’érosion est un facteur qui joue très fortement, notamment en milieu tropical, parce qu’encore une fois on a ces sols sableux qui manquent de cohésion, et puis on a des climats avec des pluies très fortes, violentes, orageuses, fréquentes, et cela ça entraîne évidemment ce processus de perte de sol.
Finalement, le bilan global sur la qualité du sol à l’échelon planétaire, il y a vraiment des raisons de s’en inquiéter. Certains considèrent aujourd’hui cette perte généralisée de matière organique, de fertilité du sol -cette dégradation du sol-, en gros, comme la troisième grande préoccupation environnementale, après le changement climatique et la crise de la biodiversité. Donc cela devient un problème sérieux.
Il y a des solutions, très souvent d’ailleurs basées -encore une fois- sur l’usage du vivant.
Maintenant il faudrait accélérer un peu la mise en œuvre des solutions et pratiques agricoles différentes, pour limiter cette dégradation générale.
Un point qu’il ne faut pas oublier, je l’ai dit tout à l’heure, c’est que pour la matière organique du sol, l’âge moyen est entre 100 ans et 1000 ans. Cela veut dire que pour reconstituer un potentiel qui a disparu, il faut un certain temps ! Donc il vaudrait mieux éviter la dégradation.