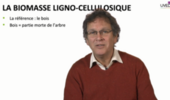En ligne depuis le 28/09/2015
3.8/5 (14)

Description
Amener les apprenants à mieux comprendre les grands enjeux du 21ème siècle en matière de transition énergétique ainsi que les moyens d'exploiter les différentes sources d'énergies renouvelables (soleil, vent, eau, chaleur du sol, biomasse), tel est l'objectif du MOOC "Énergies renouvelables".
La vocation de ce cours en ligne, réalisé et coordonné par l'Université Virtuelle Environnement et Développement durable (UVED) en partenariat avec l'Université Perpignan Via Domitia (UPVD), est de renforcer les connaissances générales d'un large public sur la question des énergies renouvelables, d'accroître les capacités d'implication des personnes dans les grandes décisions relatives à la production et/ou à l'utilisation d'énergies renouvelables et de susciter l'émergence de nouveaux projets.
Xavier Py, Professeur à l'Université de Perpignan Via Domitia, en est le référent scientifique. 32 experts-scientifiques, issus de 15 établissements différents, sont impliqués dans ce projet.
Deux niveaux de difficulté sont proposés selon les contenus de ce parcours : le niveau "Débutant" s'adresse aux apprenants de niveau Bac à Bac+3 (Licence), tandis que le niveau "Approfondi" est plutôt destiné aux apprenants de niveau Master et +.
Domaines
- Energies renouvelables
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Mentions Licence
- Physique
- Sciences pour l'ingénieur
Niveau
- Bac+1
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
Thèmes
- Finitude des ressources
Types
- Parcours thématique

Energies renouvelables : la transition énergétique (8 vidéos)

Energies Renouvelables : l'énergie solaire (7 vidéos)

Energies Renouvelables : l'énergie éolienne (8 vidéos)

Energies Renouvelables : l'énergie hydraulique (9 vidéos)

Energies Renouvelables : les énergies marines (10 vidéos)

Energies renouvelables : géothermies (12 vidéos)

Energies renouvelables : la biomasse (11 vidéos)

Energies renouvelables : le mix énergétique (9 vidéos)
Production d’hydrogène par voie biologique
Lucile CHATELLARD, Doctorante – INRA
1. Contexte
Le dihydrogène que l'on appelle plus communément hydrogène est un gaz qui possède un pouvoir énergétique important, supérieur à la majorité des énergies que l'on utilise actuellement, ce qui fait de lui un vecteur énergétique d'intérêt. Sa faible densité a permis de l'utiliser dans les transports aériens comme les dirigeables mais son explosivité lui a valu une mauvaise réputation, cloisonnant son utilisation à la chimie industrielle. Actuellement, il n’est utilisé comme vecteur énergétique que dans l'aérospatiale comme carburant pour propulser les fusées et ponctuellement dans certains sous-marins militaires. Aujourd'hui, grâce à l'évolution des technologies et des outils en matière de sécurité, la filière hydrogène connaît un regain d'intérêt et c’est en tant que carburant pour les piles à combustible que l’hydrogène est voué à être utilisé dans un futur proche, comme par exemple pour les transports automobiles. Mais bien que ces applications tendent à se démocratiser, sa production de masse doit être développée pour répondre aux besoins énergétiques de la population.
2. Biophotolyse de l’eau
Dans cette filière en émergence, des technologies de production d'un hydrogène vert sont particulièrement intéressantes à mettre en œuvre notamment par l'utilisation de micro-organismes. On distingue trois types de procédés de production de bio hydrogène par voie biologique. Le premier est la biophotolyse de l'eau. Il est réalisé par les micros algues ou des cyanobactéries, des organismes photosynthétiques qui, en présence de lumière, vont lyser les molécules d’eau pour produire et stocker des nutriments nécessaires à leur croissance. Si, après croissance, le milieu est carencé en soufre, ces micro-organismes vont utiliser leurs réserves en produisant par la même occasion du bio hydrogène. Cependant, ce procédé présente certains inconvénients. Tout d'abord il est indispensable d'apporter une source lumineuse et les surfaces de production doivent être maximales pour optimiser le contact entre les photons et les cellules photosynthétiques, ce qui augmente le coût du procédé. De plus, de l’oxygène est produit lors de la photosynthèse et cette molécule inhibe de manière irréversible les hydrogénases qui vont produire l’hydrogène. Enfin, l’hydrogène ne peut être produit qu’en seconde partie de culture, on a donc besoin de deux étapes : une pour la culture et une seconde en carence de soufre ce qui ajoute une forte contrainte au procédé.
3. Photo-fermentation
Le deuxième procédé biologique nécessite également une source lumineuse. Il est réalisé par des bactéries pourpres non sulfureuses du type Rhodobacter. En présence de lumière et en carence d'azote cette fois-ci, les bactéries vont dégrader les acides organiques tels que l'acétate et le butyrate pour produire de l'hydrogène, c'est ce que l'on appelle la photo-fermentation. Ce procédé connaît les mêmes contraintes que précédemment : besoin de lumière, de surfaces importantes et c'est un procédé qui doit se dérouler également en deux étapes. Mais le principal avantage est que les bactéries photo-fermentaires présentent des rendements supérieurs car elles utilisent un spectre de longueur d'onde plus important que les micros algues ou les cyanobactéries.
4. Fermentation sombre
Le troisième procédé est la fermentation sombre qui s'oppose aux deux précédents qui avaient besoin de lumière. L'avantage de ce type de production est que les matrices qui vont servir de substrat aux micro-organismes peuvent être complexes. En effet, les biomasses utilisées vont des fractions fermentescibles des ordures ménagères aux effluents industriels en passant par les résidus agricoles. Au cours de la dégradation anaérobie de la matière organique, différents micro-organismes, essentiellement des bactéries du genre Clostridium, utilisent un métabolisme pouvant produire de l'hydrogène avec en parallèle une production d'acétate et de butyrate. Les populations microbiennes utilisées pour réaliser la fermentation sombre à partir de substrat complexe doivent être très variées pour augmenter les chances de dégradation de la biomasse ce qui peut générer de l'instabilité dans les procédés. En général, des bactéries non productrices d'hydrogène sont aussi présentes dans le milieu et vont soit reconsommer directement l'hydrogène au cours de leur métabolisme, soit utiliser un autre métabolisme pour produire d’autres molécules. L'enjeu des recherches réalisées actuellement est de contrôler les différentes populations microbiennes en jouant soit sur l'apport de micro-organismes clefs dans le milieu, soit sur les paramètres opératoires des bioréacteurs (température ou pH).
5. Conclusion
Les méthodes biologiques de production d'hydrogène se révèlent être des procédés idéaux car respectueux de l'environnement avec des rendements limités certes mais intéressants. Pour améliorer ces rendements, il est possible d'envisager l'association des procédés biologiques comme le couplage de la fermentation sombre, de la photo-fermentation et de la biophotolyse.
Les procédés biologiques ne peuvent répondre seuls à une production d'hydrogène vert mais constituent une solution intéressante pour des applications locales, notamment à partir de déchets.
Contributeurs
BRESSON Jacky
SCHMITTBUHL Jean
VAITILINGOM Gilles
PY Xavier
PRADILLON Jean-Yves
MAYER Didier
COLLOMBAT François
OLIVES Régis
GIBAND David
Professeur d'Urbanisme et Aménagement du Territoire , UPVD - Université de Perpignan Via Domitia