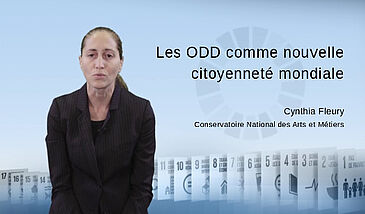En ligne depuis le 16/09/2022
5/5 (1)

Description
Patrick Caron, directeur de Mak'It (Université de Montpellier), discute dans cette vidéo (9'47) de la situation à mi-chemin des Objectifs de Développement Durable. Il présente les facteurs qui expliquent notre tendance à remettre à plus tard les transformations nécessaires, et esquisse quelques pistes pour dépasser cela.
Objectifs d'apprentissage :
- Comprendre la situation à mi-chemin par rapport à l'atteinte des ODD
- Identifier des exemples de controverses freinant la progression vers l'atteinte des ODD
- Identifier des leviers pour ne plus remettre à demain la transformation de nos sociétés
- Comprendre le rôle du chercheur et de la science pour l'atteinte des ODD
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+2
Objectifs de Développement Durable
- Les 17 ODD
Thèmes
- Les défis
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Caron Patrick
chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
L'Agenda 2030 pour le développement durable est une fantastique innovation et un fantastique accord pour nous projeter dans le futur. C'est une utopie au sens du rêve, mais au sens de la transformation, surtout, et de la transformation du monde à entreprendre. D'ailleurs, le titre dès le départ le dit bien.
1. La situation à mi-chemin
Quand on y regarde de plus près, aujourd'hui, en 2022, on est à la moitié du chemin entre 2015, l'année où l'accord a été scellé, et 2030, la cible d'atteinte des 17 Objectifs du développement durable. Pour autant, on est très loin du compte. Je pense que je n'aurais pas beaucoup de peine à vous le prouver. Les chiffres circulent, les évidences circulent, nous le savons tous, nous ne sommes pas du tout sur la trajectoire qui nous permette de rester en dessous de 1,5 ou 2 degrés d'augmentation de la température. Nous ne sommes pas du tout sur la trajectoire qui nous permette de conserver la biodiversité et d'éviter l'extinction de cette biodiversité. Nous ne sommes pas du tout sur les trajectoires qui nous permettent de résoudre les problèmes alimentaires, les problèmes de pauvreté, les problèmes de conflits. Je pourrais passer l'ensemble des Objectifs du développement durable en revue, mais je pense que vous en conviendrez assez facilement avec moi, et l'état actuel de crise liée aux conflits n'est pas en train du tout d'y répondre. Par rapport à cela, les appels politiques sont de plus en plus nombreux. Par exemple, le Secrétaire général des Nations unies, considérant que l'alimentation était l'un des points d'entrée principaux pour atteindre l'ensemble des Objectifs, a convoqué l'année dernière, en 2021, un sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires, non pas sur l'alimentation, sur les systèmes alimentaires pour atteindre l'ensemble des objectifs du développement durable. Nous voyons aussi, quand nous observons ce qu'il se passe dans un tel sommet, ou tout ce qu'il se passe dans les politiques nationales ou au niveau local à quel point nous sommes démunis lorsqu'il faut prendre des décisions qui sont faites d'arbitrages et d'injonctions contradictoires à résoudre. Tout cela se traduit par une démotivation, en particulier des plus jeunes, le « bla-bla-bla », par une perte de confiance dans la capacité à atteindre ces Objectifs. Pourtant, il ne faudrait absolument pas baisser les bras. Nous n'avons pas le choix, c'est la seule avenue vers le futur, que d'arriver à atteindre ces Objectifs et à rendre notre planète et notre humanité durables.
2. De nombreuses controverses
La première chose qu'il faut garder à l'esprit, ce sont les interdépendances entre ces objectifs et les cibles. Qu'il s'agisse d'injonctions contradictoires, on ne peut pas dans le même temps résoudre les problèmes d'énergie pour tous et lutter contre le changement climatique tout en consommant autant et en assurant la croissance. Qu'il s'agisse de synergies, c'est-à-dire penser les problèmes d'alimentation en même temps que ceux de pauvreté ou de santé. Qu'il s'agisse des effets levier, par exemple l'alimentation comme levier pour l'atteinte de l'ensemble des Objectifs du développement durable, ces interdépendances sont à l'origine de nombreuses controverses. Mais comment faire en sorte que ces controverses puissent se traduire in fine par des accords et par des processus qui mettent en cohérence ces différents Objectifs de chacun avec les enjeux du développement durable à l'échelle planétaire, à la fois pour atteindre chacun des Objectifs, mais également entre ces différents Objectifs ? Nous avons là un sacré beau chantier. En particulier, non seulement d'un Objectif à l'autre ou pour atteindre les différentes dimensions d'un Objectif, mais également entre ce qu'il se passe au niveau local, généralement considéré comme l'échelle où on doit mettre en place ces processus de développement durable, et ce qu'il se passe au niveau global. Par exemple, une agriculture qui soit respectueuse de la biodiversité et qui soit génératrice d'emplois au niveau local peut très bien être complètement désastreuse en termes de conséquences pour le changement climatique au niveau global. L'inverse serait tout à fait possible.
Donc, comment réinventer ces processus de médiation, cette construction des accords ?
On a bien un Objectif du développement durable, le numéro 17, qui fait référence aux partenariats, mais il est d'autant plus compliqué que les sujets dont on traite, justement parce qu'ils sont bloquants, sont extrêmement polarisés. Je pourrais citer l'usage des pesticides ou des insecticides, les organismes génétiquement modifiés, les questions de conflit d'intérêts liés à l'industrie du tabac ou des boissons sucrées et génératrices de problèmes de malnutrition. Voilà, tous ces sujets, nous le savons bien, opposent parfois jusqu'au conflit. Donc, mettre en place ces processus de médiation et d'arbitrage est extrêmement important.
3. Dépasser la procrastination
C'est bien comme cela que nous pouvons comprendre et expliquer les processus de procrastination, avec des transformations qui sont très difficiles à mettre en œuvre souvent, qui sont financièrement coûteuses, qui peuvent être politiquement risquées. Il nous faut, en tant que scientifiques, renseigner ces barrières et ces obstacles, qu'il s'agisse de controverses, celles que j'ai évoquées tout à l'heure, qu'il s'agisse de mieux comprendre ce que sont ces sentiers de dépendance, c'est-à-dire cette difficulté en raison des investissements, des coûts, des risques, de la difficulté à investir, à changer nos pratiques, nos comportements et notre action, qu'il s'agisse des asymétries de pouvoir qui sont grandissantes dans certains secteurs et qui ne favorisent pas la mise en place d'accords, j'ai cité l'industrie du tabac tout à l'heure, qui en est un excellent exemple, ou qu'il s'agisse de conflits d'intérêts, asymétrie de pouvoir et conflits d'intérêts étant très souvent liés. Pour rendre plus difficile encore la chose, nous sommes très souvent, et c'est malheureusement une qualité qui nous est attachée, plutôt sur un mode de réactivité et de réponse aux crises quand les médias, quand le politique, quand le grand public s'en emparent, plutôt que de proactivité et d'anticipation des crises. Et nous oublions très souvent la question des transformations opérées dès lors qu'elle ne devient plus urgente. On le voit avec la question alimentaire, on a oublié de temps en temps la sous-nutrition d'une grande partie de la population dès lors qu'il n'y avait pas crise pour la redécouvrir dès lors qu'il y a crise. Et puis, pour finir, il y a la faiblesse des institutions multilatérales aujourd'hui. Malgré cet accord splendide en 2015, nous voyons aujourd'hui un délitement et un effritement de cette capacité à gouverner et à contraindre au niveau multilatéral par rapport à ces enjeux de durabilité.
4. La place du chercheur et de la science
Pour finir, quelle peut être la place de la science dans tout cela et de la science en société ? La science, ce sont bien sûr des technologies, mais elle a aussi pour mission de faire la pensée par le GIEC, par l'IPBES dans le domaine de la biodiversité, la pensée et l'agenda par le HLPE dans le domaine de l'alimentation. Elle doit aussi construire des métriques et des indicateurs pour nous permettre de comprendre et de suivre ce qu'il se passe, de tracer des processus par rapport à des questions qu'on ne se posait pas avant, comme le changement climatique. Et puis, plus généralement, elle doit comprendre et décrypter ce qui se joue dans ces processus complexes, dans ces transitions qui ne s'opèrent pas, ce qui bloque et ce qui permettrait, du coup, de poser les bases d'accords à construire. Pour le scientifique, l’enjeu est de s'impliquer avec d'autres catégories d'acteurs dans des exercices de prospective pour imaginer les futurs possibles. C’est aussi former les jeunes à traiter des questions qu'on ne traitait pas auparavant. C'est assurer que la connaissance soit bien un enjeu de développement durable, un bien public, qu'il faut pouvoir partager et mobiliser pour construire ce futur. Enfin, c’est s'investir dans des dispositifs de recherche-action qui permettent de construire ces solutions.