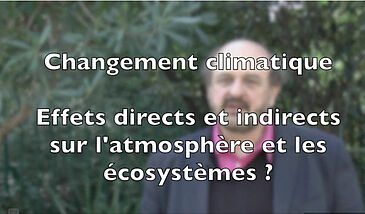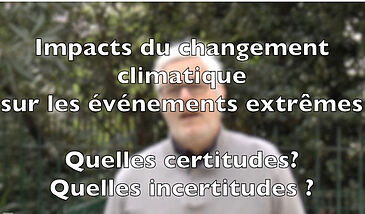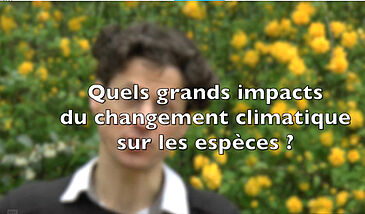En ligne depuis le 26/06/2017
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Hervé Le Treut, Directeur de l'Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé" (Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 13. Lutte contre le changement climatique
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
LE TREUT Hervé
Hervé Le Treut, climatologue, Directeur de l’IPSL (2017)
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Le changement climatique : Quelles caractéristiques ? Quels grands enjeux ?
Depuis la deuxième guerre mondiale, les pressions humaines sur notre environnement sont multiples. On peut citer la démographie : nous sommes plus nombreux. On est aussi en train d’utiliser de l’énergie sous des formes que l’on avait jamais connues : on utilise du charbon, du pétrole, du gaz naturel de manière intense. On utilise aussi l’agriculture, qui a pris une place énorme pour nourrir la population. Donc les actions que l’on a sur notre environnement prennent des formes très diverses.
Pour ce qui est du climat, la forme la plus importante c’est bien sûr l’énergie libérée lors de la production de gaz à effet de serre (GES). Alors tout ce qui est usage du charbon, du pétrole, du gaz naturel, des combustibles fossiles, relargue dans l’atmosphère des quantités très grandes de CO2. Il y a d’autres gaz à effet de serre : méthane, N2O, qui sont liés à l’agriculture. Il y en a qu’on a amené de manière directe dans l’atmosphère, qui n’existaient pas avant, comme les CFC (chlorofluorocarbones). Tout cela produit progressivement un changement de la planète qui se fait à un rythme accéléré.
On émettait il y a 50 ou 60 ans, au début des années 1950, peut être 1 milliard de tonnes de Carbone par an dans l’atmosphère ; maintenant c’est 10 milliards. Donc on va de plus en plus vite dans ces émissions, qui se stockent dans l’atmosphère.
Ce qui a fait la spécificité de ce problème de gaz à effet de serre, c’est leur effet cumulatif (effet différé). Le CO2 reste dans l’atmosphère environ un siècle. Alors il faut comprendre : la moitié du CO2 est reprise de manière très rapide par les sols et l’océan ; l’autre moitié, elle, reste longtemps. Alors il y a plusieurs facteurs qui déterminent cette durée. C’est entre autres la capacité de l’océan, d’une partie de l’océan, à reprendre ce qui reste. Il y a, au bout d’un siècle, la moitié de ce CO2 qui est encore présente dans l’atmosphère – la moitié de ce qui n’a pas été repris initialement ; et puis, au bout de milliers d’années, il y a toujours une partie qui reste et dont on peut penser qu’on aura beaucoup de mal à s’en séparer.
Donc les gaz à effet de serre impactent de manière cumulative l’atmosphère sur des durées extrêmement longues. C’est vrai donc pour le CO2 ; c’est vrai pour N20 avec pratiquement les mêmes échelles de temps ; c’est vrai pour les CFC avec des échelles de temps éventuellement plus longues ; c’est vrai pour le méthane (CH4) avec une échelle de temps plus courte – de l’ordre d’une décennie. Tous ces gaz là engagent le futur d’une manière importante.
Alors on est confronté à ce problème : on a changé le climat de la planète, il va réchauffer la Planète. Ce réchauffement, on le craint surtout par des conséquences qui nous concernent nous, qui concernent la biodiversité. La Planète s’en sortira, ce qui s’en sortira peut-être moins facilement, c’est d’une part notre capacité à maintenir toute cette variété d’écosystèmes dont on dépend – on est des animaux nous aussi ; et puis l’autre part, tout ce qui fait la capacité à vivre d’une manière pacifique sur une planète où on va être de plus en plus nombreux. L’enjeu difficile, c’est le caractère injuste du réchauffement climatique.
Ce changement est produit par des gaz à effet de serre (GES) qui sont surtout émis actuellement dans les pays qu’on dit du Nord, c’est-à-dire ceux de l’OCDE pour faire simple ; il y a aussi la déforestation qui s’ajoute à cela. Mais les conséquences sont réparties par les vents, les gaz à effet de serre se mélangent à la surface de la Planète et il y a des régions plus vulnérables. Ces régions plus vulnérables sont surtout des régions de climat intertropical, ce sont des zones où on a des événements météorologiques dangereux, des sécheresses, des cyclones qui peuvent être amplifiés ou rendus plus sévères, plus difficiles, par le changement climatique et par le réchauffement de la Planète.
Donc on a une inégalité, une injustice climatique, qui est une des conséquences majeures que l’on peut avoir dans le futur – celle d’augmenter les risques de conflits, toutes les difficultés qu’on a déjà entre des territoires qui sont très pauvres et d’autres qui sont beaucoup plus riches.