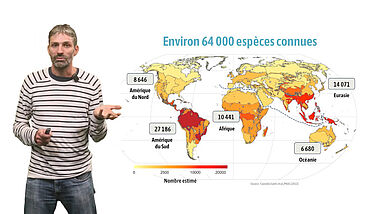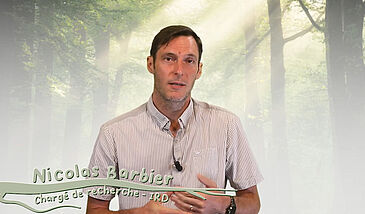En ligne depuis le 03/03/2025
0/5 (0)
Description
Sophie Gerber, Stéphanie Mariette et Shaan Lepaul-Picolet (UMR Biogeco, INRAE -Université de Bordeaux) discutent dans cette vidéo de l'hétérogénéité génétique au sein des arbres. Après une remise en perspective historique et philosophique de cette idée, elles mettent en évidence et discutent des résultats des travaux de recherche conduits sur le sujet.
Objectifs d'apprentissage :
- Expliquer pourquoi les arbres ont souvent été perçus comme des mosaïques génétiques
- Donner les résultats des principaux travaux scientifiques ayant étudié la diversité génétique au sein des arbres
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+3
- Bac+4
Objectifs de Développement Durable
- 15. Vie terrestre
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Gerber Sophie
chercheuse , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Mariette Stéphanie
chargée de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Lepaul-Picolet Shaan
Doctorante , Université de Bordeaux
Ce document est la transcription révisée, chapitrée et illustrée d’une vidéo du MOOC UVED « Arbres ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.
L’arbre est-il une mosaïque génétique ?
Sophie Gerber (INRAE), Shaan Lepaul-Picolet (Université de Bordeaux), Stéphanie Mariette (INRAE)
1. Remise en contexte
Certaines personnes, des scientifiques, des biologistes, des botanistes, des écologues, des philosophes ou même des écrivains, considèrent l'arbre comme une entité hétérogène, et en particulier depuis le XXe siècle, comme une mosaïque génétique. L'arbre a été et est encore souvent considéré comme composé de parties ayant chacune sa propre autonomie, sa propre composition génétique qui différerait des parties avoisinantes.
Comme sur cette figure, où le corps de l'arbre est composé d'une multitude de couleurs représentant une forte variabilité génétique. Cette vision d'un arbre est opposée à la vision habituellement accordée aux animaux, par exemple à nous, individus humains, plus proche de l'arbre représenté ici majoritairement en rouge.
Nos expériences de généticiens des populations et de philosophes des arbres nous suggèrent que cette différence est à questionner. Nous vous proposons ici, pour commencer, une sélection de citations qui va du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui et qui témoigne de cette vision particulière de l'arbre.
• "Un arbre n'est pas un être simple mais un être collectif, une association d'individus vivant en commun." (Un texte de 1892)
• Et un texte beaucoup plus récent, de 2018, dans "Science & Vie" : "Chaque branche développe son propre génome."
Mais pourquoi les arbres sont-ils si souvent considérés comme des entités hétérogènes, comme nous le constatons dans cette série de citations ?
2. Eléments d’explication
D'une part, les plantes sont abordées, bien souvent, de façon utilitaire. Les plantes sont intéressantes pour l'humain car elles sont alimentaires, elles fournissent différents matériaux, elles ont des propriétés aromatiques, médicinales, des qualités ornementales. Pour être utilisées, elles sont découpées en général, leurs parties sont mises à profit, et les arbres n'y échappent évidemment pas.
D'autre part, les végétaux possèdent des caractéristiques biologiques particulières Leur croissance est qualifiée de modulaire. Des modules, ou unités, sont répétés lors de la croissance. Ces unités expriment une certaine forme d'autonomie. La répétition des modules dans le corps des plantes leur procure une croissance indéterminée. Au contraire, le corps des mammifères est fini, déterminé, bien délimité.
De plus, la cellule végétale possède la propriété de totipotence. Elle est capable de redonner une plante entière. Et si la cellule porte une mutation nouvelle, elle pourrait donc la propager à l'intérieur de l'individu, dans la population.
Ainsi, à travers le temps, les arbres ont été perçus comme des entités hétérogènes, sans unité véritable, contrairement à d'autres organismes vivants, comme les mammifères, qui présentent une individualité clairement définie par des frontières physiques et une continuité génétique. Si on prend un cheval, chaque partie de son corps participe d'un tout fini et homogène formant une unité biologique claire et indivisible. Mais, pour les arbres, cette conception est plus difficile à appliquer car ils peuvent se fragmenter, se multiplier par des parties, et même régénérer de nouvelles structures autonomes à partir de boutures ou de greffes.
Dans ces conditions, quand peut-on considérer qu'on a affaire à individu, et où cet individu s'arrête-t-il ?
3. Les apports de la génétique
Avec l'avènement de la génétique au XXe siècle, l'individualité génétique est devenue indissociable de l'unité génétique, un principe selon lequel un individu est unique et identifiable par un patrimoine génétique stable. En d'autres termes, pour être qualifié d'individu biologique, selon le paradigme de la génétique, un organisme doit avoir un génome homogène, identique dans toutes ses parties et stable dans le temps. Par exemple, l'utilisation des traces ADN en criminologie ou dans la recherche de paternité repose sur l'hypothèse d'une information génétique cohérente à partir de n'importe quelle partie d'un corps humain.
Mais, dans le monde végétal, les propriétés particulières qui ont précédemment été évoquées semblent ne pas s'aligner avec cette idée d'unité et d'homogénéité. Cette perception des arbres comme des entités fragmentées a donc orienté la recherche vers une quête de variabilité génétique intra-individuelle. En effet, depuis quelques années, de nombreux travaux de biologie moléculaire ont été menés afin de chercher la variabilité génétique dans les parties de l'arbre et de détecter des différences significatives, ce qui nous amène à l'exploration de cas concrets en génétique.
S'intéresser à l'hypothèse de mosaïque génétique revient donc à s'interroger sur le polymorphisme de l'ADN, support de l'information génétique chez un individu donné. Comment font les généticiennes et généticiens pour cela ? Il s'agit, pour ces scientifiques, d'échantillonner du matériel sur différents tissus végétaux et à différents endroits, comme illustré sur cette diapositive.
Des bourgeons, des feuilles ou encore du cambium, tissu situé sous l'écorce de l'arbre, sont prélevés chez le même individu. Ces différents tissus sont ensuite broyés. L'ADN en est extrait, puis, pour détecter ses mutations, il est séquencé avec des techniques de séquençage à haut débit, c'est-à-dire des techniques qui peuvent produire beaucoup de données de séquences pour un même échantillon d'ADN. Ces données sont ensuite traitées par des algorithmes bio-informatiques qui vont pouvoir révéler la présence de ces mutations somatiques, comme sur cette diapositive, où les échantillons 1 et 4 diffèrent des échantillons 2 et 3.
4. Résultats
Deux groupes d'auteurs se sont intéressés aux mutations somatiques chez des chênes Quercus robur, chênes pédonculés, respectivement âgés de 234 et 100 ans, Napoléon et un dénommé 3P.
Sur Napoléon, la comparaison a été faite entre un échantillon de feuilles situées à la base de l'arbre et un échantillon de feuilles situées en haut, révélant 17 mutations entre les deux. Pour 3P, une analyse similaire a révélé 46 mutations. Ces nombres absolus sont à relativiser avec la taille du génome de près de 750 millions de paires de bases chez le chêne.
Un autre exemple de résultat de la littérature concerne le peuplier Populus trichocarpa, peuplier de l'ouest. Dans ce cas, en prélevant des échantillons sur deux rejets d'un peuplier vieux de 330 ans, des auteurs ont révélé un peu moins de 100 mutations somatiques. Là aussi, à comparer avec les 500 millions de paires de bases que compte le génome de Populus trichocarpa.
Les travaux de génétique révèlent donc bien des mutations somatiques chez les espèces étudiées jusqu'alors. Mais ces mutations sont à relativiser à la diversité génétique détectée entre individus dans les populations, diversité qui est bien plus élevée.
5. Conclusion
Nous avons vu que depuis des siècles, les arbres sont plutôt assimilés à des entités hétérogènes. Considérer un arbre comme un individu devient alors problématique, selon la définition de l'individualité sur des bases génétiques. Les études de biologie moléculaire actuelle tendent à montrer que si la variabilité intra-individuelle existe effectivement chez les arbres, celle-ci reste assez marginale et ne remet pas fondamentalement en péril leur homogénéité génétique. Deux questions se posent alors.
• En cherchant à identifier la variabilité génétique intra-individuelle, n'a-t-on pas surinvesti l'idée que l'arbre serait fondamentalement hétérogène ?
• Et, par voie de conséquence, n'a-t-on pas extrapolé l'idée que cette variabilité intra-individuelle pourrait permettre aux individus de s'adapter aux brusques changements environnementaux ?