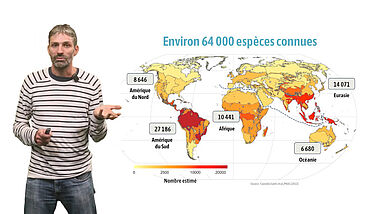En ligne depuis le 13/01/2023
0/5 (0)

Description
Nicolas Barbier, chargé de recherche à l’IRD, expose dans cette vidéo (7'32) les enjeux liés à une meilleure connaissance de la structure et du fonctionnement des arbres. Il met en lumière une diversité de modèles, d’outils et de méthodes permettant d’appréhender cela.
Objectifs d'apprentissage :
- Comprendre les enjeux liés à une meilleure connaissance de la structure des arbres
- Identifier les modèles, les outils et les méthodes permettant de comprendre la structure des arbres
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Sciences de la vie
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+3
- Bac+4
Objectifs de Développement Durable
- 15. Vie terrestre
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Barbier Nicolas
chargé de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Décrire la structure et le développement des arbres
Nicolas Barbier, Chargé de recherche à l’IRD
L'arbre est un organisme qui se construit sur lui-même, tout en perdant certaines de ses parties, des feuilles, des branches, au cours de sa vie. Il croît à la fois en hauteur, c'est la croissance primaire, et en épaisseur, c'est la croissance secondaire, selon différentes modalités, en fonction des espèces et du climat. Comprendre l'édification, depuis la graine jusqu'à la mort, est un défi conceptuel tant les arbres peuvent atteindre des dimensions importantes et une structure en apparence complexe, établie sur des pas de temps dépassant souvent la durée de vie d'un homme. Cela pose deux défis majeurs : comment mesurer, caractériser la structure d'un arbre que l'on observe, comprendre comment cette structure s'est établie au cours du temps, et les processus biologiques qui en sont à l'origine.
1. Observer la structure des arbres
À partir de la structure d'un arbre à un moment donné, l'examen attentif de sa morphologie et de son anatomie peut permettre de retrouver son histoire passée. Comme on le voit sur cette photo, l'artiste Giuseppe Penone, dans une de ses œuvres connues, illustre ce fait en retrouvant la structure de l'arbre juvénile à l'intérieur du tronc.
1.1. Les cernes
Bien connues également du public, les cernes de bois permettent d'étudier rétrospectivement la dynamique de la croissance secondaire de l'arbre. C'est le principe de base de ce qu'on appelle la dendrochronologie. En fait, on relie des régularités structurelles, visibles dans l'anatomie du bois, à une temporalité. Et par extension, cela permet de comprendre, par exemple, comment l'arbre a réagi aux climats passés.
1.2. Les cicatrices
On peut également utiliser les marqueurs de la croissance primaire, comme des cicatrices de bourgeons qui sont indiquées sur les photos ci-dessous, qui reflètent une pause dans l'allongement des axes et délimitent ce que l'on appelle des unités de croissance. D'autres cicatrices, visibles sur l'écorce, ou la formation de fourches peuvent indiquer la position des parties reproductives, qui ont disparu au moment de l'observation. Chez le hêtre, par exemple, dont l'écorce est fine et lisse, on peut retrouver sur le tronc de l'arbre âgé des cicatrices de feuilles que l'arbre portait quand il était jeune. Elles délimitent des accroissements annuels.
Hors des zones tempérées, où la pause hivernale donne le tempo pour tous les arbres, il peut s'avérer difficile d'associer une temporalité aux régularités structurelles observées.
Les cernes de croissance, par exemple, même s'ils sont visibles, ne sont pas toujours annuels. Il est ainsi plus compliqué de reconstituer le développement de l'arbre a posteriori.
1.3. La phénologie
La constitution d'un observatoire phénologique, par drone ou à l'aide de caméras, voire à partir de jumelles, depuis le sol, fournit alors une solution pour dater les événements dont on retrouvera plus tard les cicatrices. Ces photos d'un même arbre en forêt guyanaise montrent que l'on peut facilement, depuis le ciel, détecter des jeunes feuilles ou des périodes sans feuilles. On voit même une partie de la couronne, qui semble désynchronisée par rapport au reste.
2. Modéliser la structure des arbres
Mais ces suivis seront limités par le recul des observations, tandis que l'approche dendrochronologie permettra de retrouver l'histoire de l'arbre sur des décennies. Les proportions entre les différentes parties de l'arbre sont également porteuses d'informations sur son fonctionnement et les contraintes biophysiques qui façonnent son architecture. Comme on le voit dans ces schémas de Léonard de Vinci au XVe siècle, il remarquait déjà qu'à chaque ramification, des branches filles conservent la surface de la section de la branche mère. C'est un peu comme si le tronc et les branches ne servaient que de tuyaux amenant l'eau des racines aux feuilles.
Notons cependant que l'analogie avec un système de tuyaux ne tient pas tout à fait, car le bois de cœur finit par ne plus être conducteur en vieillissant.
2.1. La Pipe Model Theory
Dans les années 1960, la théorie du "Pipe Model", le "Modèle de tuyaux", schématise cela, comme on le voit sur le dessin, en représentant une continuité hydraulique pour chaque feuille, jusqu'aux racines. Les feuilles mortes laissent un vestige non conducteur dans le bois. En fait, il existe également des contraintes mécaniques qui imposent une structure permettant d'éviter la rupture, notamment sous l'effet du vent. Il faut donc des mesures précises, à la fois au niveau de l'anatomie et de la géométrie des axes, pour arriver à relier plus finement structure et fonctionnement.
2.2. Les relations allométriques
De même, les forestiers utilisent les relations de proportionnalité entre les différentes parties de l'arbre pour quantifier la ressource exploitable. Des relations dites allométriques lient ainsi le diamètre du tronc à la hauteur de l'arbre ou à son volume. Ces relations permettent de construire des abaques pour estimer une variable d'intérêt, comme le volume de bois exploitable, par exemple, à partir de mesures plus faciles à prendre sur le terrain, comme le diamètre du tronc ou la hauteur de l'arbre. Au-delà de la constitution d'abaques, la théorie métabolique établie par West en 1999 cherche à interpréter la valeur des coefficients allométriques pour lier la structure de la plante à son fonctionnement ou à son métabolisme. On voit qu'il y a une analogie claire entre le système respiratoire ou sanguin des animaux et la ramure des arbres. Pour les uns comme pour les autres, le métabolisme est contraint non pas par la surface extérieure de l'enveloppe corporelle mais par la structure fractale ramifiée du réseau.
3. Intérêt des approches tridimensionnelles
Ces quelques exemples illustrent l'intérêt d'arriver à décrire précisément la structure tridimensionnelle des arbres en termes de proportions, de volume, de surface, d'angles, de ramifications, de topologies, etc. Le LiDAR a permis de grandes avancées sur ces questions. Il s'agit d'une technique par laquelle un scanner, positionné au sol, ou sous un drone ou un avion, émet et reçoit des impulsions laser en très grand nombre. Les échos produits permettent de déterminer la structure des objets visibles avec un grand niveau de détail. On voit ici différents exemples d'arbres tropicaux mesurés depuis le sol ou par drone. À cette étape, il ne s'agit encore que d'un nuage d'échos laser qu'il faudra encore interpréter, si possible automatiquement.
4. Conclusion
Mieux comprendre la croissance des arbres, voire la modéliser et la prédire, permettra d'avancer sur des questions cruciales. Il est tout d'abord fondamental de pouvoir documenter le fonctionnement et les stratégies de vie et de survie des arbres, et ainsi explorer la diversité et l'évolution du vivant. Avec la problématique du changement global, il est de plus en plus nécessaire de mesurer précisément le rôle des forêts dans le cycle du carbone et les autres grands cycles biogéochimiques. On peut également mettre en place des outils d'analyse rétrospective permettant de retourner dans le passé pour étudier la réponse des arbres aux perturbations ou aux variations du climat, ainsi que des outils d'analyse prospective permettant de prédire la croissance future d'un arbre en fonction de son environnement. Dans le cadre de la gestion de l'arbre comme ressource forestière, ou en milieu urbain, cette compréhension et ces modèles permettent d'avoir une évaluation plus précise de la ressource et du risque, donc d'aider à la décision.