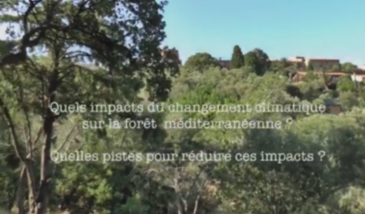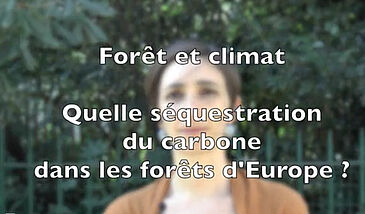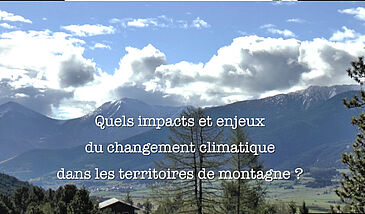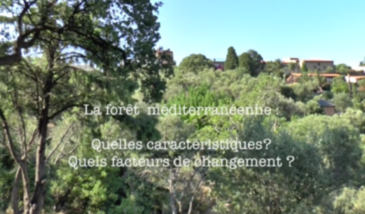En ligne depuis le 11/09/2017
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Aude Valade, climatologue, chercheuse à l'IPSL, pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé" (Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 15. Vie terrestre
Thèmes
- Ecosystèmes et biodiversité
- Enjeux Climat/Biodiversité
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Valade Aude
climatologue et chercheuse à l'IPSL
Aude Valade, climatologue, chercheuse à l’IPSL (2017)
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Forêt et climat - Quelle gestion des forêts en Europe depuis le XVIIIe siècle ? Avec quels effets sur le climat ?
Historiquement, en Europe, la gestion forestière a beaucoup évolué. Entre 1750 et 1850, le bois était la principale source d’énergie et de matériaux en Europe. Donc pour construire, pour se chauffer, pour cuisiner, c’était la principale source d’énergie. La gestion forestière était assez intensive. Les forêts qui étaient utilisées par les humains étaient composées essentiellement de taillis – c’est-à-dire quand on a des repousses à partir des souches. Donc c’était des forêts assez jeunes et en taillis. On avait principalement des forêts décidues, donc feuillues…
On avait principalement des forêts de feuillus, et on avait aussi une diminution de la superficie forestière car elle était fortement utilisée. A partir de la révolution industrielle, donc autour de 1850, on a eu un changement complet d’usage du bois par les hommes, puisqu’avec l’utilisation du charbon, puis ensuite du pétrole, avec la révolution industrielle, les forêts ont été progressivement abandonnées. On a eu un fort exode rural et donc, avec la déprise agricole, les forêts ont repris leurs droits, et on a eu de l’afforestation finalement, du reboisement, sur une grande partie de l’Europe.
On a eu aussi un autre phénomène assez important : ce qui a été replanté a été planté majoritairement en résineux, et même certains feuillus de forêts qui sont restées des forêts ont été convertis en résineux. Donc aujourd’hui, en Europe, on a environ 34% de feuillus, alors que c’était plus de 70% en 1750.
Entre 1850 et 2010, on estime qu’on a eu un gain de surface boisée en Europe d’environ 386 000 Km2. C’est vraiment un reboisement à grande échelle et important, et qui continue aujourd’hui. Aujourd’hui la forêt française, par exemple, continue à augmenter en superficie.
Donc si on fait le bilan, entre 1750 et 2010, on a une augmentation de la surface forestière d’environ 10%, on a également une augmentation de la part des forêts sous gestion humaine qui passe à 85% aujourd’hui, et on a une augmentation forte de la part des conifères dans la distribution des essences en Europe. Ces trois facteurs ont un impact sur les échanges entre la forêt et le climat, que je vais détailler l’un après l’autre.
L’augmentation de la surface forestière et la conversion des feuillus et résineux augmente le stockage de carbone – puisque les résineux poussent plus vite que les feuillus, ils stockent plus rapidement du carbone. En revanche, l’augmentation de la part des forêts gérées a conduit à une augmentation des prélèvements, entre 1750 et 2010, qui a conduit à une libération de carbone dans l’atmosphère importante. En termes de carbone, le bilan de cette période est un effet réchauffant, par le prélèvement de carbone dans la forêt, alors qu’en 1750 on avait des stocks plus importants parce qu’on avait plus de forêts naturelles.
Le deuxième effet de ces différentes pratiques de gestion sur le climat est lié à l’albedo. L’albedo, ça correspond à la réflexion du rayonnement solaire sur les arbres. Là, l’effet est principalement dû à la conversion des feuillus en résineux. L’effet de la conversion des feuillus en résineux sur l’albedo –l’interception du rayonnement solaire- est lié à deux facteurs. Il y a le fait qu’en été, un feuillu et un résineux n’ont pas le même potentiel de réflexion de la lumière. Un résineux est plus sombre, donc il absorbe plus de lumière. Il va finalement réchauffer un petit peu plus l’atmosphère proche. Il y a un deuxième effet, plus important dans les zones d’Europe du Nord, qui est l’effet dû à la neige. Les feuillus durant l’hiver sont nus, ils n’ont pas de feuilles et donc n’interceptent quasiment pas de rayonnement solaire. Donc avec les surfaces enneigées, qui sont blanches, en albedo maximal, un maximum du rayonnement solaire est renvoyé vers l’espace. Il y a un effet plutôt refroidissant. En revanche avec les conifères, qui gardent leurs aiguilles l’hiver, la neige est cachée, et donc le rayonnement solaire est finalement absorbé par les arbres au lieu d’être réfléchis par la neige. On a donc un effet plutôt réchauffant de la conversion des feuillus en conifères.
Un troisième effet est lié au cycle de l’eau dans la forêt. C’est-à-dire que la conversion de feuillus en conifères va diminuer l’évapotranspiration, donc va diminuer l’humidité autour des arbres et donc la capacité de l’atmosphère à évacuer la chaleur. Donc c’est encore un effet plutôt à tendance réchauffante de la conversion des feuillus en conifères.
Donc au final, en faisant une étude sur la période 1750 - 2010 pour l’Europe, on a trouvé que la gestion qui a été réalisée sur cette période historique a conduit à un faible réchauffement de l’atmosphère et non à un refroidissement. Cet effet est faible et met surtout en avant le fait que la gestion forestière n’a pas un effet sur le changement climatique comparable à celui des émissions de carbone fossile de tous les secteurs de l’économie.
Dans les régions tropicales, les processus et les mécanismes en œuvre sont très différents, à la fois d’un point de vue écologique –puisque la question de l’albedo avec la neige évidemment ne se pose plus du tout- donc cela va surtout être le cycle de l’eau qui va interagir avec le climat, au niveau de la gestion forestière. La gestion forestière est évidemment très différente, également. On a principalement des forêts primaires, des forêts naturelles, et on a un phénomène de déforestation à grande échelle, pour principalement le développement de l’agriculture.