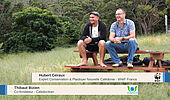En ligne depuis le 10/01/2022
3.9/5 (35)

Description
Les territoires français d'Outre-mer doivent aujourd'hui relever plusieurs défis, touchant aussi bien les aspects écologiques, économiques ou sociaux. Cet ensemble de vidéos permet de mieux comprendre ce besoin de développement durable dans les Outre-mer, et il vise à montrer que des personnes et des acteurs sont déjà engagés autour de ces questions, et ce sur tous les territoires ultramarins.
Objectifs d'apprentissage :
- Comprendre la diversité des points de vue qui existent quand on parle de développement durable dans les Outre-mer.
- Découvrir les 17 Objectifs de Développement Durable.
- Comprendre les caractères universels et indivisibles des 17 Objectifs de Développement Durable
- Appréhender les enjeux de développement durable les plus saillants pour les Outre-mer.
- Découvrir des personnes et des structures, dans tous les Outre-mer, engagées pour l'atteinte des Objectifs de Développement Durable.
- Comprendre l'importance des partenariats et de la coopération dans la mise en place de projets de développement durable.
- Comprendre les freins et les leviers pour la mise en place, par les différents acteurs du territoire, de projets de développement durable.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Cours
- Entretiens et témoignages
Niveau
- Bac
- Bac+3
Objectifs de Développement Durable
- 1. Pas de pauvreté
- 10. Inégalités réduites
- 11. Villes et communautés durables
- 17. Partenariats pour la réalisation des objectifs
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Introduction : Points de vue sur le Développement durable dans…

A la découverte des 17 Objectifs de Développement Durable

Les ODD dans le contexte des Outre-mer : 4 enjeux prioritaires

Exemples d'initiatives pour relever le défi du développement…

Conclusion : La mobilisation de tous les acteurs pour l'action…
Vers un développement durable dans les Outre-mer : le rôle des collectivités locales
par Tchico Souffou, chargé d'opération construction et Matthieu Lhoste, directeur des travaux et de l'entretien (Mairie de M'Tsangamouji, Mayotte)
Cette intervention a pour objectif de discuter du rôle des collectivités locales permettant d'accompagner la transition écologique et énergétique des territoires ultramarins. Ici, il s'agit d'illustrer l'exemple de Mayotte.
1. Le contexte de Mayotte
Mayotte est composée de la Grande-Terre et de la Petite-Terre. Elle connaît une forte croissance démographique et aussi une vague migratoire, ce qui explique la faiblesse des revenus des habitants. Ces faiblesses-là expliquent le nombre de logements insalubres et indignes, et ce nombre de logements insalubres et indignes est le plus élevé des DOM. Pour faire un petit récapitulatif du contexte énergétique de Mayotte, on connaît une forte croissance démographique. Qui dit forte croissance démographique dit augmentation de la consommation de la population. Consommation, bien évidemment, énergétique. Aujourd'hui, le contexte énergétique de Mayotte, c'est que Mayotte dépend à 98 % d'une énergie fossile qui est le pétrole. Dedans, on peut voir que 58 % représente le transport, 38 % représente la production d'électricité et 12 %, on peut voir par exemple l'éclairage public. Parmi ces pourcentages-là, on peut constater que si on fait un zoom sur la partie production d'électricité, les habitants, la population, donc, consomme plus de 50 % de la production énergétique d'électricité. Dans ce sens-là, il faut directement agir. En tout cas, c'est le premier facteur sur lequel la population doit agir.
2. Les actions des collectivités pour l’énergie et le climat
L'idée, c'est aussi de dire : on va mener des actions. En tout cas, c'est le rôle des collectivités locales, de mener des actions en faveur du développement durable. Parmi ces actions-là, on peut voir que pour la partie sensibilisation, on a pas mal d'associations qui font ce rôle-là. Et ça marche, pour l'instant, très bien. Il faut les encourager. Les collectivités, le Département et l'État doivent encourager ces associations-là à mener des actions pour pouvoir favoriser et accompagner ce développement durable des territoires. On peut voir également comment, dans le cadre des projets d'aménagement et de construction, intégrer la partie développement durable. Comme on sait que la partie transports est très représentative en matière de consommation, il faut agir sur ce volet-là, le volet mobilité et transport.
3. Le PCAET
Parmi les documents cadres qui permettront d'accompagner le développement durable des territoires, on peut retrouver la programmation pluriannuelle de l'énergie. On peut retrouver ce document-là dans chaque territoire appelé ZNI, zone non interconnectée, donc chaque zone non interconnectée doit élaborer sa propre stratégie liée à la programmation pluriannuelle de l'énergie. Là, on va retrouver Mayotte, qui élabore sa stratégie. Et dans sa stratégie, on a les collectivités, les EPCI, les communautés de communes et les communautés d'agglomération qui élaborent ce qu'on appelle le Plan climat air énergie territorial.
Parmi ces actions du plan climat, on va retrouver plusieurs thématiques, en fonction du territoire, bien évidemment. On va retrouver la partie mobilité, parce qu'on sait qu'à Mayotte, c'est l'un des premiers facteurs sur lesquels il faut agir. On va retrouver la partie énergie. On va retrouver la partie aménagement et construction durable, sans oublier cette partie agriculture et pêche.
À Mayotte, étant donné qu'on dépend à 98 %, toutes énergies confondues, la majorité des produits sont importés. Il faut arriver à un système d'autosuffisance et développer l'agriculture durable.
Le Conseil départemental élabore son propre plan à l'échelle départementale. Mais chaque collectivité, chaque communauté de communes, à Mayotte, il y en a cinq, et chaque communauté de communes, chaque communauté d'agglomération doit élaborer sa stratégie du Plan climat air énergie territorial.
4. Le protection de l’environnement : exemple de la lagune d’Ambato
En matière de protection de l'environnement, on sait que Mayotte détient l'un des plus beaux lagons des DOM et de France. Il faut agir dans ce sens-là afin de protéger ce lagon et l'écosystème marin. Au-delà de l'autosuffisance énergétique et alimentaire, ces notions impliquent une pression sur le milieu naturel. Il va donc falloir concilier, à Mayotte, l'autosuffisance, notamment au niveau de l'agriculture, avec la protection des milieux naturels.
Sur la lagune d'Ambato, des actions de restauration et de protection du site ont été engagées dès 2005 avec un arrêté protectoral de protection de biotope qui a été renouvelé au mois de mai 2020. Qu'est-ce que cela implique derrière ? Cela implique une démarche partenariale entre des associations locales de protection de la nature, comme Gepomay ou Jardin de M'tsangamouji, la DEAL, donc les services de l'État, mais également les services du Département et la commune, pour agir de concert sur cet écosystème spécifique d'une superficie d'environ 4 hectares. Trois types d'actions ont été engagés. Tout d'abord, des actions de sensibilisation auprès du grand public et notamment des écoliers pour leur permettre de prendre connaissance de la faune et de la flore spécifiques à ce milieu. Il faut savoir que c'est un site de nidification du crabier blanc, qui est une espèce classée en danger critique d'extinction, et également d'autres espèces végétales endémiques. Le crabier blanc avait abandonné la nidification sur ce site en 2016, et grâce à ces différentes actions, nous avons pu observer trois couples de crabiers blancs qui sont revenus depuis 2019 suite à la restauration du milieu naturel.
Cela implique des actions de lutte contre les pratiques illégales, que ce soit au niveau des cultures, mais aussi au niveau de l'habitat. Il ne s'agit pas de détruire directement les cultures et l'habitat, mais il s'agit de trouver des solutions avec les habitants pour baisser progressivement la pression sur le milieu naturel et rentrer dans une optique d'aménagement durable bénéfique à tous.
Contributeurs
Ferdinand Malcom
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Trottmann Charles
directeur du département des Trois Océans , AFD - Agence française de développement
Hierso Daniel
président d'Outre-Mer Network
Merckaert Jean
Directeur Action Plaidoyer France Europe à Secours Catholique-Caritas France
Moatti Jean-Paul
Professeur Emerite , Université Aix-Marseille
Severino Jean-Michel
Waisman Henri
Marniesse Sarah
AFD - Agence française de développement
PELLAUD Francine
Haute École Pédagogique de Fribourg (Suisse)
Ndour Yacine Badiane
Solano Philippe
Chotte Jean-Luc
Tribollet Aline
directrice de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
de Pracontal Nyls
président du groupe Outre-mer du comité français de l'UICN
Zammite Jean-Michel
directeur des Outre-mer , OFB - Office Français de la Biodiversité
Hermet François
Université de La Réunion
Briolin Sara
présidente de Femmes en Devenir
Martin-Prével Yves
directeur de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Roch Jérôme
directeur régional - Guadeloupe , ADEME
Demenois Julien
chargé de mission "4 pour 1000" , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Chignoli Claire
ingénieure "économie circulaire et déchets" , ADEME
Gaspard Sarra
professeure , Université des Antilles
Perche Mélanie
coordinatrice du REGAL Réunion
Devakarne Jaëla
coordinatrice d'Isopolis
Jacob Vincent
chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Reboul Lucile
Goût Nature
Law-Weng-Sam Betty
USEP Nord Réunion
Brunette Cléa
Assistante de projet au sein d'Unite Caribbean
Ozier-Lafontaine Harry
directeur de recherche , INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Comier Annick
maire de la commune de Fonds-Saint-Denis en Martinique
Douine Maylis
médecin chercheur au Centre d'investigation clinique Antilles-Guyane
Edant Caroline
cheffe de projet Biodiversité , AFD - Agence française de développement
Charles Mahé
coordinateur technique du Secrétariat de l'initiative Kiwa
Dangles Olivier
directeur de recherche , IRD - Institut de Recherche pour le Développement
Souffou Tchico
chargé d'opération construction de la mairie de M'Tsangamouji à Mayotte
Lhoste Matthieu
directeur des travaux et de l'entretien de la mairie de M'Tsangamouji à Mayotte
Géraux Hubert
expert "Conservation & Plaidoyer Nouvelle-Calédonie" , WWF France
Bizien Thibaud
cofondateur de Caledoclean
Daniel Justin
professeur , Université des Antilles