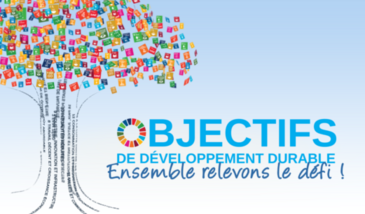En ligne depuis le 08/10/2018
3.7/5 (12)

Description
En septembre 2015, les 193 États membres des Nations-Unies ont adopté 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) à atteindre d’ici à 2030. Ils se sont ainsi engagés à améliorer de manière significative les situations climatiques, environnementales, sociales et économiques aujourd’hui rencontrées à travers le monde. L’enjeu est de trouver collectivement, nationalement et internationalement, des solutions pour vivre bien, pour vivre mieux pour nous et pour les générations futures. Ce nouveau programme de développement durable intitulé aussi l'Agenda 2030 du développement durable est un plan d'action ambitieux mais incontournable pour développer la paix dans le monde, protéger la planète, enrayer la pauvreté, réduire les inégalités. C'est un ensemble d'objectifs pour les Peuples, la Planète, la Prospérité, la Paix et les Partenariats (les 5 "P") qui reprend les thèmes du développement durable : pauvreté, faim, santé et bien-être, éducation, égalité entre les sexes, eau, énergie, travail et croissance, industrie et innovation, inégalités, villes, consommation et production, changements climatiques, biodiversité aquatique et terrestre, paix et partenariats.
Ces ODD ont une portée universelle, revêtent une dimension transversale et ne sont pas dissociables les uns des autres. Ils doivent être appliqués par tous les pays sans exception. Les atteindre est un véritable défi. Afin d’être en capacité de le relever, il est important et nécessaire que l'ensemble des acteurs de la société se mobilisent : les États, les collectivités, le secteur privé, le monde de l'enseignement et de la recherche, les associations et bien entendu les citoyens.
Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, issus des pays du Nord comme des pays du Sud, nous sommes tous concernés et donc tous acteurs de ces ODD !
Ce parcours a pour ambition de vous informer, de vous sensibiliser, de vous donner envie de vous mobiliser autour de ces ODD ou, si vous l'êtes déjà, de vous encourager à vous impliquer, ou à aller plus loin dans vos engagements, dans vos réalisations, dans vos démarches.
Qu’allez-vous trouver dans ce cours ? Des clés pour vous aider à comprendre ces 17 ODD et la façon dont ils interagissent les uns avec les autres, mais aussi des outils pour vous aider à mieux les prendre en compte, des idées et des suggestions pour pouvoir agir concrètement, des initiatives et des expériences qui ont été lancées pour vous montrer que des personnes et des acteurs se sont déjà mobilisés autour de ces questions et ce qu’il est possible de faire.
Pour vous présenter tout cela, 33 experts nationaux et internationaux, du Nord comme du Sud, issus du monde académique comme du monde non-académique, ont été rassemblés. Il s’agit d’hommes et de femmes travaillant dans des disciplines et des institutions variées, tous spécialistes de la question qui ont mis les ODD au cœur de leur action.
Le cours est placé sous la responsabilité scientifique de Maria Snoussi, professeure à l’Université Mohammed V de Rabat, au Maroc, et Jean-Paul Moatti, Président-directeur général de l’IRD, et expert du groupe de scientifiques indépendants en charge de la rédaction, pour 2019, du rapport sur les progrès accomplis au niveau mondial dans la mise en œuvre des 17 ODD.
Deux niveaux de difficulté sont proposés selon les contenus de ce parcours : le niveau "Débutant" s'adresse aux apprenants de niveau Bac à Bac+3 (Licence), tandis que le niveau "Approfondi" est plutôt destiné aux apprenants de niveau Master et +.
Objectifs d’apprentissage :
- Identifier les éléments-clés sur l'histoire des ODD.
- Comprendre les cibles et les indicateurs associés aux ODD.
- Comprendre l'articulation entre les ODD et les OMD.
- Comprendre l'enjeu des synergies et des antagonismes entre les cibles des ODD.
- Comprendre la vision et les valeurs que portent les ODD.
- Comprendre l'appropriation des ODD par les acteurs publics comme les États et les collectivités territoriales.
- Comprendre l’appropriation des ODD par l’ensemble des acteurs non étatiques de la société.
- Comprendre le rôle des grandes forces mobilisatrices de la société (finance, médias...) pour la mettre en mouvement.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
- Paternité
Nature pédagogique
- Animation
- Cours
- Parcours de formation
Niveau
- Bac
- Bac+1
- Bac+2
- Bac+3
- Bac+4
- Bac+5
Types
- Parcours thématique
Mots-clés

Introduction générale aux Objectifs de Développement Durable

Les ODD : une vision commune du futur de l'Humanité

Les ODD : un agenda pour tous les pays et pour tous les secteurs

Les ODD : un défi pour l'Action publique

Les acteurs s'emparent des ODD
Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED « Objectifs de développement durable ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs.
Résilience, adaptation et vulnérabilité aux changements globaux
Magali Reghezza-Zitt,
Maître de conférences à l’École Normale Supérieure - Université PSL
Depuis plusieurs décennies, la résurgence des catastrophes naturelles et la prise de conscience des changements environnementaux globaux, notamment du changement climatique, ont fait prendre conscience à la communauté internationale et aux acteurs politiques d'une vulnérabilité croissante, ou en tout cas différente, des sociétés et des individus. Cette fragilité est particulièrement vraie lorsque l'on regarde les inégalités de développement puisqu'on se rend compte que le mal développement est un facteur d'accroissement de la vulnérabilité des populations.
1. Face au changement global, les solutions possibles
Face à ces changements globaux environnementaux, deux solutions sont possibles. La première, c'est ce qu'on appelle la mitigation ou atténuation, qui consiste à agir, essentiellement de façon technique, pour réduire les dangers qui nous menacent. C'est par exemple le seuil des deux degrés et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
De l'autre côté a émergé l'idée de ce que l'on appelle l'adaptation, c'est-à-dire une transformation des sociétés et des individus qui permet d'arriver à ce que l'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité de ces sociétés à répondre de façon appropriée au changement, faire face à ce changement, à se relever en cas de choc, à maintenir leur activité, à maintenir cette continuité d'activité.
2. Deux types d’adaptations
L'adaptation peut prendre deux formes. La première, c'est ce qu'on a appelé l'adaptation incrémentale. C'est une succession d'ajustements, de réponses ponctuelles au coup par coup, qui permettent aux sociétés ou aux individus de faire face en cas de catastrophe, en cas de crise, en cas de pression lente, par exemple une crise économique ou alimentaire. On a une autre forme d'adaptation qui est l'adaptation transformationnelle. C'est une adaptation de longue haleine qui consiste en une transformation profonde et structurelle de nos modes de vie, de nos habitudes quotidiennes, de nos systèmes productifs, de nos systèmes industriels, agricoles, etc.
Ces deux formes d'adaptation n'ont pas le même coût. L'adaptation incrémentale mobilise des coûts techniques et souvent très chers financièrement. L'adaptation transformationnelle a un coût social, immédiat, parce que souvent, ce sont les populations les plus pauvres et les plus démunies qui seront frappées par les coûts de cette adaptation.
3. La question de la résilience
La résilience est devenue, à l'échelle internationale, une injonction qui vise à proposer une autre forme de sortie de la vulnérabilité puisque même si les populations, même si les sociétés sont vulnérables, elles peuvent aussi espérer devenir résilientes, c'est-à-dire être capables de faire face aux menaces qui nous entourent. Le problème de cette résilience, c'est qu'elle prend plusieurs sens selon les acteurs concernés. Pour certains, la résilience est un retour à l'état initial, à l'état antérieur, voire parfois une détérioration de la situation. Pour d'autres, au contraire, la résilience s'appuie sur un renouvellement, une émergence qui va faire que les sociétés pourront, par des transformations successives et par l'adaptation, s'améliorer et devenir plus responsables, plus justes et plus durables. Cette résilience reste aujourd'hui incantatoire. Elle est très difficile à opérationnaliser et elle pose trois questions.
La première question, c'est qui dit ce qui est meilleur ? Qui dit, pour une société ou pour un individu, quel est l'état vers lequel il doit tendre ? On touche à un problème politique et démocratique de définition de cet état, de cette normale, puisque la résilience est un concept extrêmement normatif.
Le deuxième problème est que la résilience est un concept qui s'applique à des systèmes. La résilience des composantes du système n'implique pas forcément la résilience du système englobant. Pour le dire autrement, la résilience d'une société n'implique pas forcément la résilience des individus qui la composent. Inversement, la résilience des individus ne conduit pas forcément à la résilience de la société dans son ensemble. Ici va se poser des questions de choix politiques, à quelle échelle on va travailler, vers qui on va destiner les politiques qui visent à construire la résilience des individus.
Le troisième problème est un problème d'ordre éthique et politique au sens large du terme qui touche à la question de la justice environnementale. En effet, la résilience peut être utilisée par certains acteurs dans une ligne très conservatrice qui vise à faire peser, à transférer sur les vulnérables les coûts, extrêmement lourds parfois, de l'adaptation, de la gestion des menaces, de la mitigation, bref de tous les instruments mis en place pour lutter ou pour accompagner les changements environnementaux. Cette question du transfert des coûts et des responsabilités vers les vulnérables est particulièrement problématique dans le cadre des inégalités de développement parce que, précisément, ce sont les plus faibles et les plus démunis qui ont le moins d'accès au pouvoir, qui subiront donc les politiques dites de résilience, sans pouvoir véritablement participer et prendre la part, prendre le pouvoir par rapport à ces enjeux de résilience.
4. Conclusion
La résilience pose aujourd'hui un enjeu sociétal majeur. C'est un horizon extrêmement prometteur. C'est un terme qui, même s'il est flou, permet de faire avancer les politiques publiques, privées, nationales, internationales, locales, mais aussi un terme qui est porteur d'un certain nombre de dangers, qui doit donc être manipulé avec beaucoup de précautions parce qu'il masque des enjeux éthiques, idéologiques, politiques, au sens fort du terme, qui questionnent nos sociétés à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale.
Contributeurs
Chotte Jean-Luc
Severino Jean-Michel
Moatti Jean-Paul
Professeur Emerite , Université Aix-Marseille
Viovy Nicolas
De Vreyer Philippe
Reghezza-Zitt Magali
Merckaert Jean
Directeur Action Plaidoyer France Europe à Secours Catholique-Caritas France
Voituriez Tancrède
Caron Patrick
chercheur , CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
De Milly Hubert
Marniesse Sarah
AFD - Agence française de développement