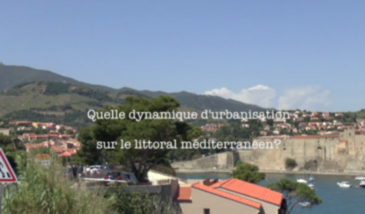En ligne depuis le 31/05/2016
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Sabine Barles, Professeur d'Urbanisme et Aménagement à Paris 1 Sorbonne,
pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé"
(Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Economie
- Génie civil
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Thèmes
- Finitude des ressources
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Barles Sabine
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Sabine Barles, Professeure à Paris 1, Sorbonne
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Quels principaux flux de matériaux dans les territoires ? Quelles pistes pour les réduire ?
Quand on essaie de regarder ce que l’on pourrait faire pour transformer le ‘métabolisme’ [des territoires], que ce soit en région méditerranéenne ou ailleurs, on se rend compte qu’il y a toute une série d’enjeux qui vont traverser l’ensemble des territoires. Ces enjeux, ce sont d’abord celui de la dématérialisation, tout simplement d’une consommation moindre de matières dans l’absolu. Un autre enjeu est celui de l’inscription du fonctionnement des sociétés dans les grands cycles biogéochimiques dont elles se sont extraites. Un troisième enjeu serait celui du rapprochement - alors un rapprochement à la fois au sens géographique et organisationnel - des lieux de production et des lieux de consommation, voire aussi des lieux d’émission. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer tout ça.
Quand on regarde, à l’échelle par exemple d’un département français, quelles sont les matières qui sont consommées -en termes de consommation nette, donc ce qui est véritablement consommé sur place- on se rend compte qu’il y a trois flux principaux, qui sont : tout d’abord les matériaux de construction, qui dépassent toujours ; ensuite, en deuxième et troisième position ou l’inverse, les combustibles fossiles et les produits agricoles et alimentaires - la position dépendra finalement du caractère plus ou moins rural du territoire que l’on étudie. A cela s’ajoute un quatrième flux, qui est généralement le plus important en masse ou en volume, c’est bien entendu le flux de l’eau qui est consommée au sein des territoires, qui bien sûr est généralement restituée ou en grande partie restituée au milieu, mais dans une forme souvent dégradée, et puis parfois dans un bassin versant autre que celui
dans lequel elle a été prélevée.
Donc finalement, on a cette combinaison du naturel et du technique, et si nous voulons essayer de comprendre la part anthropique du métabolisme, il faut que nous fassions une analyse plus approfondie de ces techniques et, bien entendu, de ce qui se cache derrière ces techniques. Ce sont des acteurs qui font des choix -ou parfois pas de choix d’ailleurs-, qui ont un certain pouvoir sur certains flux, et pas sur d’autres ; ce sont aussi des politiques, qui peuvent avoir un impact direct ou indirect sur le métabolisme [territorial], ce sont des impératifs qui peuvent être de nature économique par exemple. Et donc tout ceci est fondamental à comprendre, à interpréter, si l’on veut avoir une approche plus compréhensive du métabolisme territorial.