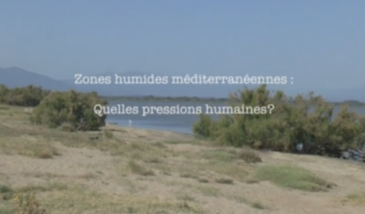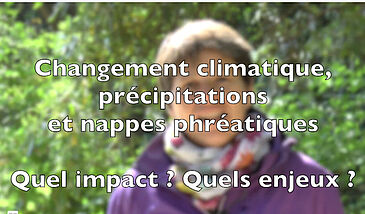En ligne depuis le 17/08/2017
0/5 (0)

Description
Question-clé posée à Florence Habets, hydrométéorologue, Directrice de recherche CNRS au METIS, pour la série vidéo "SocioEcoSystèmes - Ecosystèmes et sociétés, un futur partagé" Réduire les pressions humaines sur les écosystèmes et la biosphère - Quelles pistes pour la transition écologique?)
Conception et réalisation de cette série vidéo : Anne Teyssèdre
État
- Valorisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Nature pédagogique
- Entretiens et témoignages
Objectifs de Développement Durable
- 6. Eau propre et assainissement
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Habets Florence
hydrométéorologue, Directrice de recherche CNRS au METIS
Florence Habets, hydrométéorologue, Directrice de recherche au METIS
Question-clé transcrite et éditée par Anne Teyssèdre
Quels impacts directs des activités humaines sur les eaux douces ?
L’Homme impacte la ressource en eau, en particulier la ressource en eau d’un point de vue quantitatif. On le voit très facilement avec les rivières qui sont aménagées par l’Homme. Il y a des rivières qui ont des digues, souvent pour empêcher les crues, mais cela a un impact sur le cours d’eau : cela accélère le cours d’eau, cela va limiter également la possibilité pour les poissons de nicher, ou de circuler, et puis cela a un impact sur la quantité d’eau.
Impact qu’on peut voir aussi avec les barrages, qui servent à mobiliser l’eau un certain temps pour l’utiliser ultérieurement -ou pour l’utiliser tout de suite- donc la prélever, retirer cette ressource du milieu naturel, du cycle de l’eau.
Du point de vue ‘quantité de l’eau’, les impacts importants sont ceux qui sont liés aux prélèvements. On sait qu’une grande partie de l’eau qui est prélevée est ensuite restituée, plus loin, dans des conditions différentes, peut-être pas avec la même qualité. Cela, ça va être essentiellement, par exemple, pour produire de l’énergie : on va stocker de l’eau et la rendre plus tard, peut-être plus chaude (quand elle a servi à refroidir les centrales nucléaires, des choses comme ça. Et puis on va aussi prélever de l’eau pour irriguer par exemple; ce sont quand même de grands volumes l’eau.
L’homme a un deuxième impact, sur la qualité de l’eau. C’est-à-dire que par ses activités il génère un certain nombre de produits qui se retrouvent dans l’eau et qui modifient sa qualité, qui perturbent son équilibre et donc la rendent bien souvent polluée. L’irrigation mène souvent à des méthodes relativement intensives pour faire pousser les plantes, et s’associe généralement à des problèmes de pollution, via des transferts de nutriments ou de phytosanitaires, par exemple des herbicides ou des choses comme ça, qu’on retrouve ensuite dans les eaux.
Donc on a différents problèmes, qui sont associés un petit peu aux mêmes raisons, soit l’agriculture, soit l’industrie ou la production d’énergie.
Il y a un autre impact important sur l’eau : elle sert aussi de moyen de transport.
Typiquement, on s’en sert pour transporter nos excréments, qui vont ensuite dans les égouts, dans les stations d’épuration. Et ça c’est une part importante, à la fois des dérivations d’eau qui part vers les milieux urbains, et puis ensuite de la qualité de l’eau qui se retrouve dans les rivières après avoir été traitée…
En Europe, il y a une Directive (Directive Cadre sur l’Eau, 2001) qui nous dit qu’on doit atteindre le bon état de l’eau, le bon état qualitatif. Les États européens « rapportent » sur la qualité de l’eau, et on voit qu’en France il y a presque 70 % de ce qu’on appelle la masse d’eau qui n’ont pas atteint le bon état. Donc c’est quand même beaucoup en termes de qualité.