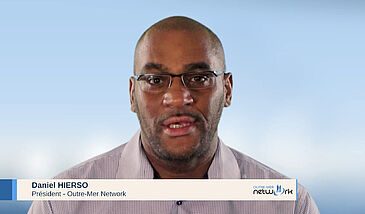En ligne depuis le 25/01/2022
0/5 (0)

Description
Charles Trottmann, directeur du département des Trois Océans au sein de l'Agence Française de Développement, discute dans cette vidéo du développement durable dans les Outre-mer. Il souligne tout d'abord que ce développement durable est à la fois une urgence et une chance, puis il rappelle que la trajectoire de durabilité doit être définie par les Outre-mer, compte tenu de leurs spécificités. Enfin, il présente la contribution de l'AFD à cette dynamique.
Objectifs d'apprentissage :
- Comprendre les atouts des Outre-mer en vue d'un développement durable.
- Distinguer, sur le plan du développement, la différence entre rattrapage et trajectoire propre.
- Appréhender le rôle d'une banque publique de développement, l'AFD, pour le développement durable des Outre-mer.
État
- Labellisé
Langues
- Français
Licence Creative Commons
- Partage des conditions à l'identique
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification
Mentions Licence
- Economie
Nature pédagogique
- Cours
Niveau
- Bac+3
Objectifs de Développement Durable
- 11. Villes et communautés durables
Types
- Grain audiovisuel
Mots-clés
Contributeurs
Trottmann Charles
directeur du département des Trois Océans , AFD - Agence française de développement
Institutions secondaires
Le développement durable par les outre-mer français
par Charles Trottmann, directeur du département des Trois Océans à l’AFD
Je voudrais commencer par vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée l'année dernière. Je discutais avec un élu polynésien, et je lui disais à quel point c'est important pour nous, Agence française de développement, de travailler, dans les territoires d'Outre-mer, sur les enjeux de développement durable. Et alors, il m'a regardé et il m'a dit : "Vous savez, pour vous, le développement durable, c'est un mot. Mais pour nous, c'est une question de survie." Et ça m'a marqué. "Survie", c'est un mot très fort, et je pense que ça nous interpelle et ça nous invite à réfléchir sur ce que veut vraiment dire le développement durable en Outre-mer.
Alors, je voudrais partager avec vous trois messages simples. Le premier, c'est que le développement durable en Outre-mer, c'est à la fois une urgence et une chance pour les territoires. Le deuxième, c'est que les ODD, le nouveau paradigme du développement durable, nous invitent à repenser le récit de développement de ces territoires tel que nous, en métropole, nous pouvons le penser. Enfin, je voudrais aussi dire que l'Agence française de développement, nous sommes là pour aider à passer de la connaissance à l'action et à faire en sorte que le développement durable devienne une réalité active dans ces territoires.
1. Le développement durable : une urgence
Le développement durable, en Outre-mer, est à la fois une urgence et une chance. Une urgence, parce que ce sont les territoires les plus vulnérables aux changements climatiques, en France et dans le monde entier parmi les territoires les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique. On pense, bien sûr, à la montée des eaux, et je parlais de la Polynésie. Il y a d'ores et déjà des territoires français qui disparaissent ou qui sont menacés de disparition. On pense aussi aux conséquences des dérèglements climatiques. Par exemple, l'ouragan Irma, dans les Caraïbes, dont on a vu les conséquences dévastatrices sur le terrain. Ce sont aussi des territoires qui recèlent une biodiversité absolument extraordinaire. La France a 10 % de la biodiversité mondiale sur son territoire. Et elle a 10 % parce que, pour l'essentiel, elle a l'Outre-mer, qui est une réserve absolument extraordinaire de biodiversité, avec des hot spots. Elle a, parmi ses écosystèmes, certains des plus menacés de la planète, et notamment les récifs coralliens. La France abrite 10 % des récifs coralliens. C'est donc une responsabilité particulière d'avoir des politiques de développement durable qui nous permettent de préserver cette richesse, ce patrimoine commun.
L'Outre-mer, ce sont aussi des territoires confrontés à des problématiques sociales extraordinaires. On a des territoires dans lesquels le taux de pauvreté est 2 à 5 fois plus élevé qu'en métropole. À Mayotte, par exemple, 77 % de taux de pauvreté monétaire. Ça doit nous interpeller sur l'enjeu de travailler également à lutter contre les inégalités, à favoriser l'accès aux services de base dans tous ces territoires.
Enfin, c'est une urgence parce que ce sont des territoires insulaires qui sont confrontés à des défis et à des difficultés spécifiques. L'éloignement de la métropole, la rareté du foncier, l'étroitesse du marché domestique, la difficulté à avoir des capacités de production locale... Ce sont des problématiques très spécifiques qui sont autant de défis quand on veut penser le développement durable.
2. Le développement durable : une chance
Alors, c'est une urgence, mais c'est aussi une chance, et de la même façon parce que puisqu'on est dans un territoire insulaire, un petit territoire, on est aussi à l'échelle pour pouvoir voir l'impact de ce que l'on fait. On est dans des territoires à taille humaine dans lesquels on peut avoir des ambitions qui se concrétisent sur le terrain. Je prends l'exemple de l'énergie renouvelable. On a fixé, pour les Outre-mer, des ambitions très fortes, particulières, en matière d'énergie renouvelable, avec la volonté d'atteindre l'autonomie énergétique en 2030. Ca en fait un terrain d'innovation formidable.
Par exemple, en Guyane, l'AFD a financé beaucoup de projets d'énergie renouvelable qui ont fait de la petite commune de Saint-Georges la première commune française autonome en énergie verte. On travaille, sur le terrain, à beaucoup de nouvelles technologies innovantes, sur le solaire en toiture, sur le stockage hydrogène, qui peuvent aussi nous inspirer pour le territoire métropolitain, et en particulier pour les territoires ruraux. Nous inspirer, c'est aussi quelque chose que peuvent faire ces territoires en tant que pionniers. Il y a des choses dont on a à apprendre d'eux, en métropole, pour notre propre développement durable.
Un autre exemple que j'aime bien prendre, c'est celui du rahui, en Polynésie, ce mode coutumier, très ancien, de gestion de la ressource naturelle. Dans une zone de pêche, quand on s'apercevait que les poissons commençaient à manquer, le rahui permettait de décréter une interdiction ou une limitation temporaire de la pêche de manière à ce que la ressource puisse se reconstituer. Quelque part, on n'a rien inventé avec nos quotas de pêche. Il y a plein de pratiques comme ça, dans ces territoires, qui sont des sources d'inspiration pour nous aider à penser ensemble notre développement durable.
3. Changer de récit politique
Le développement durable, et les ODD, tels que les Nations unies les ont définis, c'est aussi une occasion pour nous de repenser notre récit politique, notre récit stratégique avec les Outre-mer. Les ODD, ça nous interpelle en particulier, nous qui sommes les acteurs du financement du développement, parce que c'est un changement de paradigme. Jusque-là, on disait : "Il y a les pays développés qui sont là, et les pays en développement qui doivent les rejoindre, les rattraper." Or, ce que disent les ODD, c'est pas ça. Les ODD disent : "On est tous des pays en transition, des territoires en développement." Il y a des territoires qui sont développés économiquement, mais qui ne sont pas soutenables du point de vue environnemental, et il y a des territoires moins développés économiquement, mais dont l'empreinte environnementale est soutenable. Le but, c'est qu'on converge, finalement, vers un endroit où ni les uns, ni les autres ne sont aujourd'hui. Et ça, ça nous amène aussi à repenser notre récit politique pour les Outre-mer.
Parce que depuis longtemps, en France, on pensait les Outre-mer à travers l'idée du rattrapage. Les Outre-mer doivent rattraper la métropole, devenir comme la métropole. Or, les ODD nous invitent à aller au-delà de ça et à penser les trajectoires propres de chaque territoire, à penser le destin propre, le destin manifeste de chaque territoire ultramarin, avec son propre développement durable, qui peut-être sera différent, et peut-être, parfois, sera meilleur que celui de la métropole. Ça nous invite aussi à repenser ces territoires comme étant pas seulement des petits morceaux de France, mais des territoires situés géographiquement, et à penser leur développement dans le cadre d'un bassin océanique.
Nous, à l'AFD, on n'a plus de direction Outre-mer. On a une direction des Trois Océans qui couvre les océans Pacifique, Indien et Atlantique, et on traite ensemble les territoires d'Outre-mer et les États étrangers, et on essaye de penser les biens publics à l'échelle régionale. Je prends l'exemple de la lutte contre les épidémies, la surveillance épidémiologique. Bien sûr, les virus n'ont pas de frontières, et on essaie de travailler, par exemple, dans l'océan Indien avec le réseau Sega One Health, à la surveillance commune des épidémies, des épizooties, pour éviter leur émergence. On voit bien, en cette période de coronavirus, à quel point ce sont des enjeux essentiels qui ne peuvent se traiter que par la coopération.
4. Le rôle de l’Agence Française de Développement
Alors, un nouveau récit, c'est bien, mais concrètement, comment on fait ? Comment est-ce qu'on passe du récit à l'action ? C'est précisément le travail de l'Agence française de développement dans les territoires.
Pour y arriver, d'abord, on travaille sur le dialogue de politique publique, en étant auprès des acteurs locaux, des grandes collectivités, dans l'apport d'expertise, l'apport d'appuis, de solutions communes, et l'apport de ressources financières à travers nos prêts bonifiés. Par exemple, avec des prêts à taux zéro quand on a des projets contributeurs à la lutte contre le réchauffement climatique ou à l'adaptation aux conséquences du réchauffement climatique, en apportant aussi des subventions pour financer des études, de l'appui en ingénierie, pour que les projets durables puissent émerger sur les territoires.
On est là aussi auprès du secteur privé, en complément d'autres acteurs, pour pouvoir pousser l'ambition développement durable des projets. Être, dans un tour de table de financement, celui qui va apporter l'ambition supplémentaire pour arriver à un projet durable responsable environnementalement.
On est là aussi auprès de la société civile, en particulier à travers la formation Mouv'outremer, qu'on a mise en place grâce au ministère de l'Outre-mer pour faire en sorte que tous les porteurs de projets, tous les gens qui ont une initiative dans ces territoires, puissent être formés, accompagnés, pour aller jusqu'au passage à l'action.
On le fait aussi, et c'est tout l'objet de ce MOOC, au travers du partage de connaissances.
5. Conclusion
Pour conclure, je voudrais vous dire que quand on parle de développement durable, on parle d'idées, mais aussi d'actions. Bien sûr, c'est très important de diffuser les idées et de la connaissance, et ce MOOC est là pour ça, mais ce que je souhaite, c'est qu'il invite chacun d'entre vous à passer à l'action. Je voudrais vous dire que si vous êtes motivé, vous trouverez, partout dans les territoires, l'Agence française de développement pour vous accompagner dans ce passage à l'action.