Energie hydraulique : historique et ressources

Description
François Collombat propose un historique de l'usage de l'énergie hydraulique par les sociétés humaines et montre la diversité des architectures associées. Il insiste sur le développement de la filière hydroélectrique en France au cours du dernier siècle.
État
- Labellisé
Types
- Episode de podcast

La transition énergétique - Clip

Les énergies renouvelables : remise en contexte historique
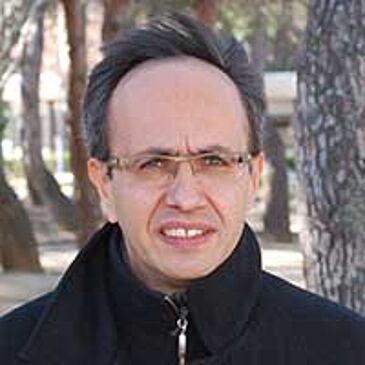
Les énergies renouvelables : enjeux et défis sociétaux

L'économie des sources renouvelables d'énergies dans les stratégies d'atténuation du…

Villes et énergies renouvelables
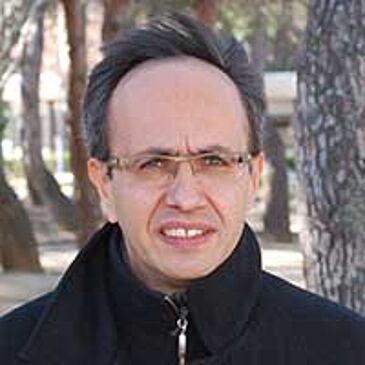
Énergies renouvelables et aménagements du territoire : des enjeux renouvelés

Géopolitique des énergies renouvelables

Les énergies renouvelables, sources de conflits

L'énergie solaire - Clip

La ressource solaire : importance et moyens de caractérisation

La conversion photovoltaïque de l'énergie solaire

Photovoltaïque : performance du système

Conversion thermodynamique de l'énergie solaire sous concentration

Chauffe-eaux solaires individuels et collectifs
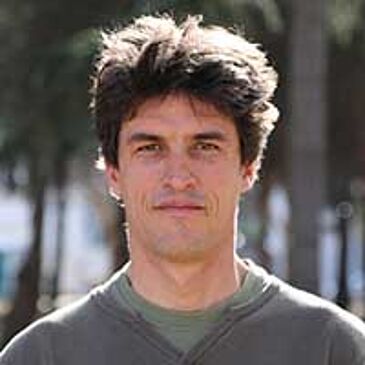
Comment traiter nos eaux par voie solaire ?

L'énergie éolienne - Clip
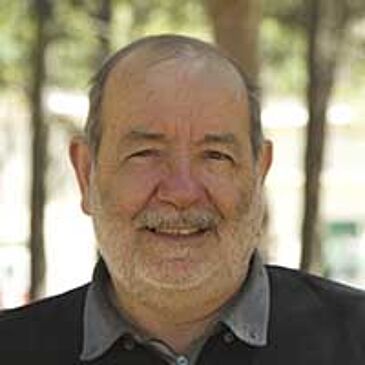
Le potentiel éolien
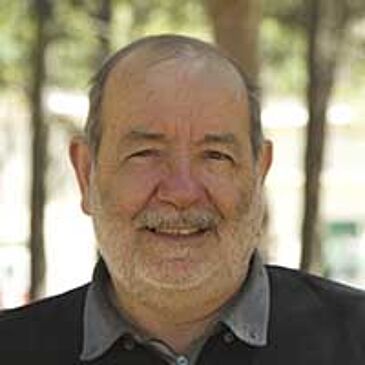
Notions d'aérodynamique
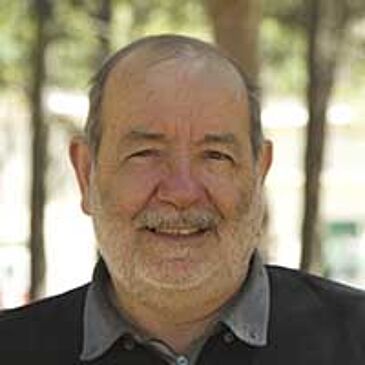
Les éoliennes à axe horizontal
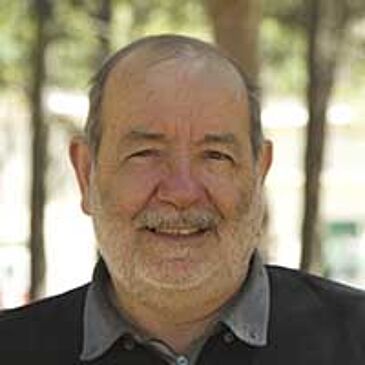
Essais en soufflerie : vrillage d'une pale d'éolienne
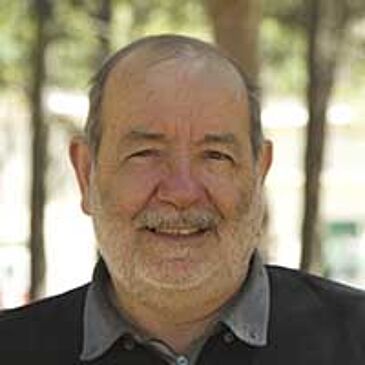
Les éoliennes à axe vertical
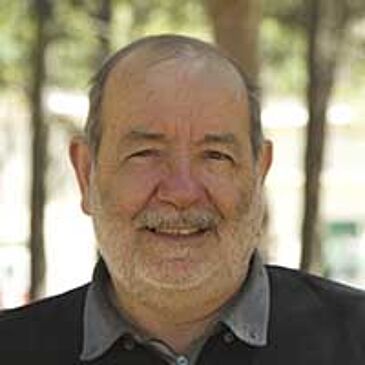
Puissance d'une éolienne
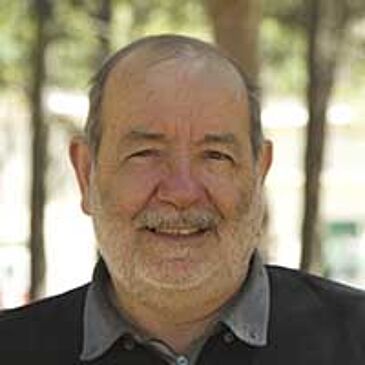
Technologie des éoliennes

L'énergie hydraulique - Clip

Energie hydraulique : caractéristiques fondamentales

Eléments constitutifs d'un aménagement hydraulique

Energie hydraulique : exploitation des aménagements

La turbine VLH : un nouveau concept

Hydroélectricité : ressources et "mix énergétique"

La sûreté hydraulique

Energie hydraulique : prise en compte de l'environnement

Les énergies marines - Clip

Contexte national et international des énergies marines renouvelables

Caractéristiques et dynamique des énergies disponibles en milieu marin

Contexte technologique des énergies marines renouvelables

Eoliennes marines et énergie thermique des mers

L'énergie marémotrice

L'énergie houlomotrice

Installation des éoliennes offshore : généralités

Eolien flottant et hydroliennes : câblage électrique et maintenance

Impacts environnementaux des dispositifs d'exploitation des énergies marines

Géothermies - Clip

L'origine de la chaleur exploitée en géothermie

Généralités sur la géothermie

Les différents types de géothermie et leur maturité

La géothermie très basse température

Les pompes à chaleur géothermique

La géothermie basse / moyenne énergie

La géothermie haute température conventionnelle

Les principes de la géothermie haute température non conventionnelle

La géothermie haute température non conventionnelle aujourd'hui : le projet ECOGI

Doit-on avoir peur de la géothermie haute température non conventionnelle ?

Comment aller vers la maturité de la géothermie haute température non conventionnelle ?

La biomasse - Clip

Définition, caractérisation et propriétés de la biomasse ligno-cellulosique

Mécanismes fondamentaux en thermochimie de la biomasse

Procédés de pyrolyse et gazéification

Gisements et filières de production de vecteurs énergétiques par voie biologique

Production d'hydrogène par voie biologique

Systèmes bio-électrochimiques microbiens pour la production d'énergie

Digestion anaérobie et biogaz : une histoire ancienne pour aujourd'hui et pour demain

Carburants de la biomasse : historique et utilisation actuelle

Carburants de la biomasse : cogénération et hybridation

Evaluation environnementale de la production d'énergie à partir de biomasse

Le mix énergétique - Clip

Généralités sur le stockage de l'énergie

La chaleur latente

La chaleur sensible

L'énergie mécanique

Le stockage chimique de l'énergie

Le stockage électrochimique de l'énergie

Hybridation et cogénération

Eau et énergie
Contributeurs
COLLOMBAT François
Énergie hydraulique : historique et ressource hydraulique
François COLLOMBAT, Chargé de mission, Division production hydraulique - EDF
1. Usages anciens de l’eau
L’eau est indispensable à la vie. Les hommes de tous temps ont cherché à l’utiliser au mieux, en particulier l'eau potable. Mais pour amener cette eau potable dans des lieux de consommation, ils ont eu l'idée de construire des canaux, des aqueducs. En France, le plus connu est le pont du Gard qui a plus de 2000 ans et qui depuis plus de 2000 ans amène de l'eau d'un point à un autre. Ces aqueducs étaient également utilisés pour l'irrigation. Les deux premiers usages que l'homme a fait de l'eau sont donc l'eau potable et l'irrigation.
Très rapidement, il a utilisé la force de l'eau pour d'autres moyens, en particulier le début de l’industrie naissante. Voilà ci-contre un croquis qui a été fait par un maître Italien qui représente la sidérurgie, c'est-à-dire à la fois l'eau qui entraîne un soufflet de forge de telle façon à pouvoir faire fondre le minerai et en même temps, des marteaux, des martinets de telle façon à forger les éléments métalliques réalisés à cette époque.
Un peu plus tard, l’homme a trouvé qu'il serait intéressant de pouvoir faire de la navigation, je dirais, dans les deux sens, c'est-à-dire que depuis, bien entendu, des millénaires on utilisait le fil de l'eau pour descendre des matériaux d'un point à un autre mais, on ne pouvait pas les remonter. Jusqu'à ce que quelqu'un ait eu l'idée de faire les écluses, de telle façon qu'avec des canaux on puisse aller d'un point à un autre et revenir. Le premier canal qui a été réalisé est le canal de Briare entre la Seine et la Loire. Paul RIQUET, qui a été mandaté par le roi pour construire un canal reliant la Méditerranée à l’océan a trouvé aussi le palliatif pour alimenter le canal considéré par un barrage, qu'il a construit à l’amont de Toulouse : le barrage de Saint-Ferréol.
Sur une gravure, Paul RIQUET explique à ses collègues comment grâce à ce barrage, on va pouvoir alimenter à la fois le côté droit et le côté gauche du canal. Ce barrage de Saint-Ferréol existe toujours. Il a été construit en 1681 et il fait 6 millions de m3. A l'époque c'était le plus grand barrage du monde. En 1737, un ingénieur, un savant français, a décidé de recenser l'ensemble des techniques utilisées dans le domaine de l'hydraulique. Il a fait un document très important qui s’appelle « Architecture hydraulique ou l’art de conduire, d'élever et de ménager les eaux pour les différents besoins de la vie ». Document de 400 pages qui est très intéressant, très bien documenté, aussi bien sur des formules mathématiques déjà de très haut niveau et des gravures très précises.
En partie haute de la figure ci-dessous vous voyez un système de pompage d'eau grâce à une vis d'Archimède et en partie droite, j'ai tenu à mettre cette petite gravure parce qu'elle est vraiment l'archétype de ce qu’est un aménagement hydraulique à l'heure actuelle. Vous voyez un canal, vous voyez une vanne qui permet de moduler le débit dans le canal, vous voyez une turbine en partie basse et vous voyez cette turbine qui entraîne un moulin mais on pourrait très bien imaginer qu'à la place du moulin, on ait un alternateur électrique.
2. Développement de l’hydroélectricité
Le problème, c'est que jusqu'à ces époques-là, personne ne pouvait utiliser l'eau sous pression et donc les forces en jeu étaient relativement faibles. Aristide BERGES a eu l’idée de mettre l’eau dans un tuyau avec une forte chute dans les environs de Grenoble. Il a créé le premier alternateur électrique et il a aussi inventé le terme de houille blanche. Il a présenté son principe lors de l'exposition universelle de Paris en 1889 sous la tour Eiffel et, à partir de là, ça a été le développement de l'hydroélectricité.
Pendant la guerre, on a beaucoup utilisé ce moyen pour réaliser différents moyens de guerre : la sidérurgie pour les canons, on a fait aussi tous les gaz comme le gaz moutarde qui était fait avec de l'électricité. Dès la fin de la guerre, on a légiféré en France sur le fait que nul ne peut disposer de l'énergie, des marais, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement sans une autorisation ou une concession de l'État. Cela permettait à l'État français de vraiment juguler et de maîtriser la production hydroélectrique.
Après la guerre, de 1919 à 1939, il y a eu vraiment un très gros développement de l'énergie hydroélectrique. Les sociétés privées se sont emparées de ce concept, ont travaillé sur leur pré carré, ont développé leur propre réseau et la particularité, c'est que chacun avait des caractéristiques différentes de l’électricité. Certains étaient en courant continu, courant alternatif, fréquence 25 hertz, fréquence 50 hertz. Ils étaient très différents et c’était donc impossibilité de relier ces réseaux. Ce n'était pas très embêtant à l'époque puisque l'industrie hydroélectrique était surtout tournée vers la production d'électricité pour la sidérurgie, pour le transport, pour les systèmes chimiques. Entre 39 et 45, la France a été rasée et toutes les sociétés ont périclité.
En particulier, en 1946, le 8 avril, il a été décidé de nationaliser l'ensemble des moyens de production et de transport d'électricité. EDF a été créée et il a été décidé de lancer un vaste projet hydroélectrique en France. C'est là où on a construit tous les grands barrages dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans le Massif central. En même temps on a aménagé le Rhin et le Rhône qui permettaient à la fois de faire de la navigation et de la production électrique. On a aussi aménagé la Durance de telle façon à faire de la production électrique et de l’irrigation dans l'ensemble du bassin de la Durance. Tous ces aménagements ont été construits jusque vers les années 60 - 65. Ensuite, le fioul étant devenu un combustible très peu cher, on a plutôt développé des centrales à fioul pour produire l'électricité en France.
Puis en 73, avec le choc pétrolier, il y eut la décision de lancer le programme nucléaire français et parallèlement de relancer l'hydraulique en faisant de très grands aménagements hydrauliques dits de pompage qui permettent d'absorber la puissance nucléaire la nuit pour pomper l'eau dans un réservoir comme on le voit dans l’illustration ci-dessus. Cette eau est ensuite turbinée la journée pour pallier le manque d'électricité. Dans le même temps également, au fil du temps, les loisirs d'eau se sont développés, la partie halieutique s'est développée sur les retenues qui avaient été créées par les barrages, s'est développée sur les torrents à l’aval de ces barrages dont le débit était maîtrisé grâce aux aménagements hydrauliques, le rafting s'est développé également, le canoë, le kayak, le canyoning.
Tous ces usages de l’eau doivent être pris en compte lorsqu'on aménage un aménagement hydraulique : l’eau potable, l’irrigation, les eaux industrielles, la navigation, les loisirs. Il faut bien intégrer tout cela dans l'exploitation des aménagements hydrauliques pour éviter les accidents. Au-delà de ces activités humaines, il faut aussi prendre en compte l'environnement, la vie existante aux abords de l'eau et en particulier le transit sédimentaire et la circulation piscicole.
